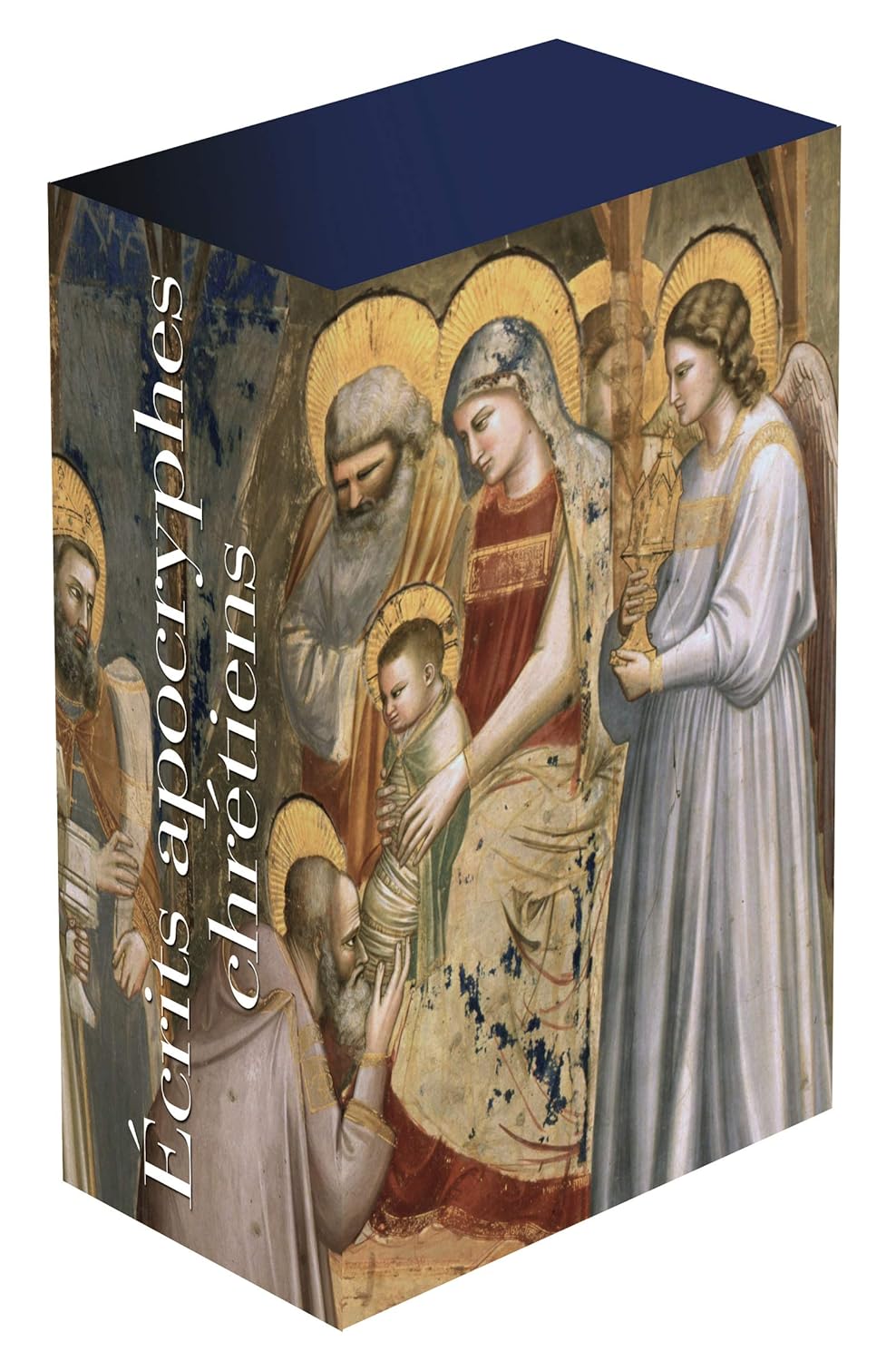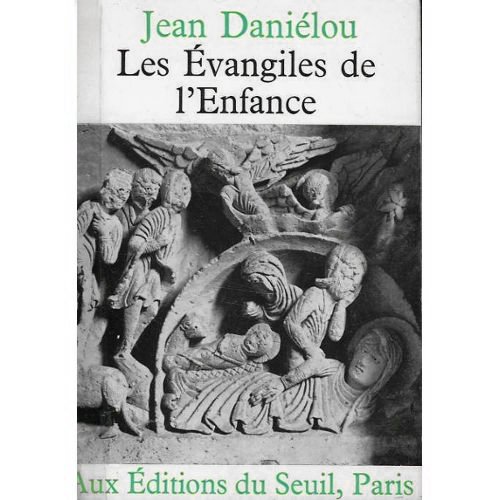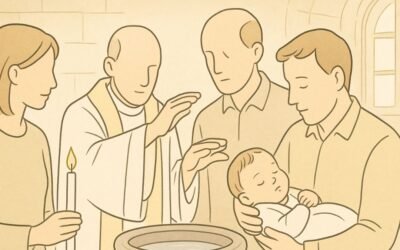On connaît les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais d’autres textes, souvent plus anciens qu’on ne le pense, racontent eux aussi la vie de Jésus, transmettent ses paroles ou rapportent les actes de ses disciples. Ces écrits, qu’on appelle textes apocryphes, n’ont pas été retenus dans la Bible. Ils ont pourtant circulé, inspiré, dérangé, parfois fasciné.
Qu’ils soient évangiles, actes, lettres ou visions, ces textes ouvrent une fenêtre sur les débuts du christianisme, bien plus mouvants et pluriels qu’on l’imagine. On y lit une autre manière de croire, de penser Dieu, de raconter le Christ.
Ce dossier vous propose de comprendre ce que sont les textes apocryphes, pourquoi ils ont été écartés, ce qu’ils contiennent, et ce qu’ils continuent à dire à ceux qui les lisent.
Découvrir les textes apocryphes : une autre mémoire du christianisme
Ce dossier explore les écrits religieux anciens non retenus dans la Bible, leur origine, leur contenu, et l’intérêt qu’ils suscitent encore aujourd’hui.
Définition de « apocryphe » :
Apocryphe (du grec apokryphos, « caché ») désigne un texte ancien qui traite de sujets religieux mais qui n’est pas reconnu comme officiel par une tradition religieuse donnée. Dans le contexte chrétien, le terme s’applique à des écrits qui parlent de Dieu, de Jésus, des apôtres ou de récits bibliques, mais qui n’ont pas été retenus dans le canon de la Bible.
Ces textes peuvent avoir été populaires dans certaines communautés, parfois utilisés dans la prière ou l’enseignement, mais ils ont été écartés des Écritures reconnues, soit à cause de leur date tardive, de leur origine incertaine, de leur contenu théologique jugé problématique, ou simplement parce qu’ils n’étaient pas considérés comme inspirés.
Définition d’un texte apocryphe en religion
1. Que veut dire le mot “apocryphe” dans la Bible ?
Le terme “apocryphe” vient du grec apokryphos, qui signifie “caché” ou “tenu secret”. Dans un contexte religieux, il désigne des écrits anciens qui évoquent Dieu, Jésus, les apôtres ou des récits bibliques, mais qui ne font pas partie des livres officiellement reconnus dans la Bible.
Ces textes ne sont pas anonymes ou récents. Beaucoup ont circulé dans les premiers siècles du christianisme, parfois même avec un certain prestige dans certaines communautés. Ils ressemblent à des évangiles, des lettres, des actes ou des révélations, mais n’ont pas été intégrés au canon biblique. On les appelle donc “apocryphes” pour signaler qu’ils restent en marge de l’autorité reconnue par les Églises.
2. Quelle est la différence entre texte apocryphe et texte canonique ?
Un texte canonique est un texte officiellement admis dans la Bible par une tradition religieuse donnée. Le canon désigne la liste fermée des livres jugés inspirés, c’est-à-dire considérés comme porteurs d’une autorité divine. Cette liste varie selon les traditions : catholique, protestante, orthodoxe ou juive.
Un texte apocryphe, en revanche, n’a pas été retenu dans ce cadre. Il peut contenir des récits proches, parfois même très proches des textes bibliques, mais il n’est pas reconnu comme référence théologique. Certains de ces textes ont été vivement rejetés, d’autres simplement ignorés ou oubliés. Il existe aussi des textes qualifiés de “déutérocanoniques” : acceptés dans certaines traditions mais refusés dans d’autres.
L’opposition entre canonique et apocryphe ne repose donc pas uniquement sur le contenu du texte. Elle dépend aussi de son usage, de sa réception historique, et des décisions prises par les autorités religieuses.
3. Pourquoi certains textes sont-ils considérés comme apocryphes ?
Plusieurs raisons expliquent pourquoi certains écrits ont été classés comme apocryphes. Certains sont apparus trop tard pour être considérés comme authentiques. D’autres contiennent des idées jugées incompatibles avec la doctrine chrétienne telle qu’elle s’est structurée dans les premiers siècles.
Certains textes ont été attribués à tort à des apôtres ou à des figures bibliques. D’autres encore présentent un Jésus très différent de celui des Évangiles retenus, parfois plus ésotérique, ou porteur de révélations réservées à un cercle initié. Ce genre de contenu a inquiété les autorités religieuses, qui ont préféré le mettre à l’écart.
Il ne s’agit pas forcément de livres illisibles ou incohérents. Beaucoup sont riches, bien écrits, spirituellement profonds. Mais leur vision du monde ou leur usage liturgique ne correspondait pas aux orientations prises par les Églises. C’est ce qui a mené à leur exclusion.
Comment les textes apocryphes ont été exclus de la Bible
1. Quels critères ont servi à choisir les livres bibliques ?
Les textes qui composent aujourd’hui la Bible n’ont pas été choisis au hasard. Plusieurs critères ont guidé ce processus, en particulier pour le Nouveau Testament. D’abord, les communautés chrétiennes ont cherché des écrits directement liés aux apôtres, ou à leurs proches. L’autorité apostolique était un gage de fiabilité.
La cohérence avec la foi transmise oralement et partagée dans les églises comptait aussi. Un texte devait être en accord avec ce que les fidèles reconnaissaient déjà comme essentiel : la vie, la mort et la résurrection de Jésus, sa mission, sa divinité, et la promesse du salut. Enfin, l’usage liturgique a joué un rôle : les textes régulièrement lus pendant les rassemblements avaient plus de chances d’être intégrés au canon.
Un évangile peu connu, marginal ou porteur d’une théologie très différente, même ancien, avait donc peu de chances d’être reconnu officiellement.
2. Comment le canon de la Bible a-t-il été établi ?
La Bible ne s’est pas constituée en un seul moment. Le processus s’est étalé sur plusieurs siècles, par étapes, avec des débats parfois vifs. Pour le judaïsme, le canon de la Bible hébraïque s’est peu à peu stabilisé entre le Ier et le IIe siècle. Dans le christianisme, les premières listes claires du Nouveau Testament apparaissent au IVe siècle.
C’est au Concile de Laodicée (vers 363), puis surtout au Concile de Carthage (en 397), que l’on trouve des listes proches de celles que nous connaissons aujourd’hui dans la tradition catholique. D’autres traditions, comme l’Église éthiopienne, ont retenu des textes supplémentaires, dont certains apocryphes.
Ces décisions n’étaient pas arbitraires. Elles reflétaient des choix théologiques, pastoraux, mais aussi politiques. Il s’agissait de garantir une certaine unité dans la foi et d’éviter la dispersion des croyances.
3. Pourquoi certains textes ont été rejetés par l’Église ?
Certains textes ont été écartés pour des raisons doctrinales : ils contenaient des idées qui s’éloignaient trop de l’enseignement des apôtres, tel qu’il était compris dans l’Église. D’autres proposaient une vision du salut très différente, parfois gnostique, reposant sur une connaissance cachée réservée à quelques élus.
Il y avait aussi des préoccupations pratiques. Certains écrits étaient trop tardifs ou trop fantaisistes pour être pris au sérieux. On y trouvait des dialogues improbables entre Jésus et ses disciples, des révélations cosmologiques complexes, ou encore des récits où les miracles prenaient un tour extravagant.
Le rejet ne signifiait pas que ces textes étaient dénués d’intérêt. Mais ils ne répondaient pas aux attentes liturgiques, catéchétiques ou théologiques des communautés qui cherchaient à structurer leur foi autour de textes communs, reconnus et partagés.
Découvrir les apocryphes chrétiens en lecture :
1. Écrits apocryphes chrétiens – Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard)
Ce volume monumental, dirigé par François Bovon et Pierre Geoltrain, est une référence incontournable. Il rassemble des évangiles, actes, apocalypses et lettres apocryphes traduits du grec, du latin, du syriaque ou du copte, accompagnés de présentations historiques et de notes précises. L’ouvrage est exigeant mais accessible, idéal pour qui souhaite une lecture rigoureuse et complète.
Dernière mise à jour le 2025-09-28 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires
2. Les évangiles apocryphes – Jean Danielou (Desclée De Brouwer)
Théologien et académicien, Jean Daniélou propose ici une lecture engagée mais très documentée des évangiles apocryphes. Il montre comment ces textes éclairent la foi des premiers chrétiens, tout en analysant leur théologie propre. L’approche est spirituelle autant qu’historique, avec un regard cultivé et critique.
Dernière mise à jour le 2025-09-28 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires
Exemples célèbres de textes apocryphes bibliques
1. L’Évangile selon Thomas et ses paroles mystérieuses
L’Évangile selon Thomas est sans doute le plus connu des évangiles apocryphes. Il a été découvert en 1945 en Haute-Égypte, près de Nag Hammadi, dans une jarre contenant une collection de textes en copte. Ce manuscrit date du IVe siècle, mais le texte lui-même pourrait remonter au IIe siècle, voire plus tôt.
Il se présente sous la forme de 114 paroles attribuées à Jésus, sans récit, sans miracles, sans passion ni résurrection. Le ton est sobre, parfois énigmatique. Certains logions (paroles) ressemblent à ceux des Évangiles canoniques, d’autres sont plus obscurs, chargés d’une dimension intérieure ou ésotérique.
Ce texte a intéressé de nombreux chercheurs car il donne à voir un christianisme des origines moins centré sur l’événement, plus sur la parole vive et l’expérience personnelle de la vérité.
2. L’Évangile de Marie et la figure effacée de la disciple
L’Évangile de Marie a été découvert en partie au XIXe siècle, puis dans d’autres fragments au XXe. Il est attribué à Marie de Magdala, disciple proche de Jésus. Il ne s’agit pas d’un récit de sa vie, mais d’un échange entre Marie et les disciples après la mort du Christ.
Elle y transmet un enseignement secret que Jésus lui aurait confié. Ce contenu provoque un conflit : certains disciples (notamment Pierre) contestent sa légitimité. Le texte met en scène une autorité spirituelle féminine, à une époque où elle était peu reconnue.
Cet évangile a suscité un regain d’intérêt avec les recherches sur le rôle des femmes dans les débuts du christianisme. Il soulève aussi la question de l’expérience spirituelle individuelle face aux structures d’autorité.
3. Le Livre d’Hénoch et ses visions des anges déchus
Le Livre d’Hénoch est un texte apocalyptique d’origine juive, rédigé entre le IIIe siècle avant notre ère et le Ier siècle. Il n’a jamais été inclus dans la Bible hébraïque ni dans le canon chrétien occidental, mais il figure dans la Bible éthiopienne.
Le livre raconte des visions célestes, des voyages dans l’au-delà, la chute d’anges rebelles (les “Veilleurs”) qui s’unissent à des femmes humaines, et la naissance de géants destructeurs. Ces récits cherchent à expliquer le mal dans le monde, à travers une mythologie complexe.
Le Livre d’Hénoch a influencé certains passages du Nouveau Testament, notamment dans l’Épître de Jude. Il donne une idée de la diversité des croyances apocalyptiques au sein du judaïsme ancien.
4. Les Actes de Paul et Thècle, entre foi et liberté
Les Actes de Paul et Thècle forment un récit captivant sur une jeune femme païenne, Thècle, convertie par Paul à la foi chrétienne. Contre la volonté de sa famille, elle renonce au mariage, se fait baptiser elle-même et échappe à plusieurs condamnations grâce à des interventions miraculeuses.
Ce texte, daté du IIe siècle, met en avant la force de la conviction personnelle, la chasteté volontaire et la possibilité pour une femme de prêcher, enseigner et même baptiser.
Longtemps populaire dans certaines communautés, ce récit a été écarté des textes officiels, mais Thècle est restée une figure vénérée dans certaines traditions, en particulier en Orient chrétien.
Que disent les textes apocryphes sur Jésus et les apôtres ?
1. Une autre image de Jésus dans les évangiles non retenus
Les évangiles apocryphes proposent parfois une image très différente de celle transmise par les quatre évangiles canoniques. Dans certains textes, Jésus parle davantage en énigmes, insiste sur la connaissance intérieure, et guide ses disciples vers une vérité cachée plutôt que vers une prédication publique.
Dans l’Évangile selon Thomas, par exemple, il ne fait pas de miracles spectaculaires et ne meurt pas sur une croix. Son message est concentré sur l’éveil de chacun à la lumière qui est en lui. Dans l’Évangile de Judas, c’est Judas lui-même qui apparaît comme celui qui a compris la volonté réelle du Christ, en l’aidant à “se libérer” de son enveloppe corporelle.
Ces visions n’ont rien d’uniforme, mais elles montrent un Christ plus intérieur, plus mystique, souvent détaché du monde matériel, voire hostile à la création, comme dans certains courants gnostiques.
2. Des récits nouveaux sur Pierre, Paul ou Marie-Madeleine
Les Actes apocryphes des apôtres racontent des épisodes que l’on ne trouve pas dans le Nouveau Testament. Les Actes de Pierre, les Actes de Paul et Thècle, ou les Actes de Jean multiplient les récits de voyages, de prédications, de miracles, mais dans un style souvent plus libre, voire romancé.
Dans ces textes, Marie-Madeleine prend parfois un rôle central. Dans l’Évangile de Marie, elle discute de théologie avec les autres disciples. Dans d’autres fragments, elle est présentée comme une initiée de premier plan. Ce contraste avec son rôle marginalisé dans la tradition occidentale a nourri des relectures contemporaines de son importance.
Ces écrits explorent aussi des figures moins connues comme Thaddée, Philippe ou Thomas, présentés parfois comme de puissants thaumaturges ou de véritables maîtres spirituels.
3. Des révélations sur le ciel, l’enfer, les anges ou la fin du monde
Plusieurs textes apocryphes sont de nature apocalyptique ou visionnaire. Ils cherchent à décrire les réalités invisibles : ce qu’il y a après la mort, comment fonctionnent les sphères célestes, ou quels sont les mystères du jugement final.
Le Livre d’Hénoch en est un exemple majeur, avec ses descriptions des anges déchus, des cieux multiples et de la punition des méchants. L’Apocalypse de Pierre, moins connue que celle de Jean, décrit de manière très imagée les supplices des damnés et la félicité des justes. Ces visions ont marqué l’imaginaire chrétien, bien au-delà de leur statut canonique.
Ces écrits donnent à voir une diversité de croyances sur le destin de l’âme, la nature du monde spirituel, ou encore le rôle des entités célestes, souvent absents ou à peine évoqués dans les textes reconnus.
Intérêt des textes apocryphes pour comprendre le christianisme
1. Ce qu’ils révèlent sur les débuts de la foi chrétienne
Les textes apocryphes ouvrent une fenêtre précieuse sur les premiers siècles du christianisme. À cette époque, il n’y avait pas encore de doctrine unique ni de corpus fixé. Des évangiles circulaient, parfois très différents les uns des autres. On priait, on croyait, on écrivait… mais sans cadre définitif.
On y découvre des manières diverses de parler du Christ, d’expliquer sa mission ou de comprendre les Écritures juives. Certains groupes insistaient sur la résurrection, d’autres sur la sagesse cachée. Ce foisonnement montre que la foi chrétienne s’est formée par des choix, des exclusions, mais aussi par des oublis.
Ces textes gardent la trace de cette pluralité d’approches. Ils ne décrivent pas un christianisme déjà figé, mais un monde où l’on cherche encore à dire ce qu’est le salut, la vérité, le sens de la vie humaine.
2. Comment ils éclairent les tensions entre courants anciens
Certains écrits apocryphes sont des textes de résistance. Ils contestent l’autorité montante des structures ecclésiales. L’Évangile de Marie montre une parole spirituelle portée par une femme, écoutée un moment… puis mise en doute. L’Évangile de Judas inverse les rôles et place celui qu’on accuse au centre de la compréhension spirituelle.
Derrière ces récits, on sent des tensions réelles entre courants. Ce ne sont pas de simples divergences d’opinion. Ce sont des visions du monde différentes, parfois incompatibles. L’enjeu dépasse la doctrine. Il touche au pouvoir, à la légitimité, à la manière d’incarner l’autorité dans une communauté croyante.
Certains textes ont été écartés, non pas parce qu’ils étaient incohérents, mais parce qu’ils remettaient en question une manière de gouverner l’Église ou de transmettre la foi. C’est en cela qu’ils restent parlants.
3. Pourquoi ils continuent d’inspirer chercheurs et croyants
L’étude des apocryphes intéresse les historiens, les théologiens, mais aussi de plus en plus de lecteurs en quête d’une lecture différente de la tradition chrétienne. Ces textes, justement parce qu’ils n’ont pas été normés, laissent une place au questionnement.
Ils fascinent aussi par leur style, parfois dépouillé, parfois mystique. On y lit une parole directe, sans dogme formel, qui touche à l’expérience intérieure plus qu’à la conformité. Ce type de rapport au sacré trouve un écho dans certaines démarches spirituelles contemporaines.
On les retrouve aussi dans la culture : romans, films, expositions. Ils nourrissent l’imaginaire collectif, même en dehors de toute foi. Ce sont des récits puissants, souvent dérangeants, qui continuent à travailler les représentations.
Où lire les textes apocryphes et comment les comprendre
1. Quels livres et traductions consulter aujourd’hui
On trouve aujourd’hui les principaux textes apocryphes dans des éditions accessibles au grand public. La Bibliothèque de Nag Hammadi, traduite en français sous la direction de Jean-Pierre Mahé et Paul-Hubert Poirier, est une référence incontournable. Elle rassemble les écrits découverts en 1945 en Égypte, traduits du copte avec rigueur et clarté.
D’autres recueils proposent une sélection plus resserrée. Le volume Évangiles apocryphes publié aux éditions Cerf, ou les traductions du Livre d’Hénoch disponibles chez Bayard ou La Différence, permettent d’explorer ces textes dans de bonnes conditions
Les introductions critiques permettent de replacer chaque texte dans son contexte sans surcharger la lecture
2. Comment lire ces textes sans les confondre avec la Bible
Un texte apocryphe n’a pas été retenu dans le canon biblique, mais il a souvent circulé dans des milieux chrétiens ou juifs pendant plusieurs générations. Il ne faut pas le prendre comme un prolongement direct des Évangiles, ni comme une version alternative
La lecture demande une certaine distance. Certains textes adoptent un ton visionnaire, d’autres un style de discours spirituel. Le vocabulaire, les images et l’intention ne sont pas les mêmes que dans les livres liturgiquement reconnus
On y trouve des figures familières – Jésus, Marie, les apôtres – dans des situations ou des discours inhabituels. Il ne s’agit pas d’y chercher une vérité cachée, mais d’écouter une voix différente issue des mêmes origines
3. Conseils pour une lecture personnelle ou en groupe
Les textes apocryphes se prêtent à une lecture lente, parfois fragmentaire. Certains peuvent être lus en parallèle avec les Évangiles canoniques, pour observer les écarts de ton, de contenu, de structure. D’autres demandent une lecture plus attentive au symbolisme ou aux allusions
Ils peuvent être explorés seul, avec l’aide de notes, ou en petit groupe. Certains cours de théologie, ateliers bibliques ou lectures universitaires en font un objet de travail commun
Rien n’oblige à les aborder dans un ordre précis. On peut commencer par l’Évangile de Thomas, souvent cité, ou par un récit plus narratif comme les Actes de Paul et Thècle. L’important est d’accepter leur étrangeté et de ne pas chercher à les faire entrer de force dans un cadre doctrinal
Liste des textes apocryphes chrétiens connus et leur contenu
Évangiles apocryphes
Évangile selon Thomas
Recueil de 114 paroles attribuées à Jésus, sans récit narratif, d’inspiration mystique.Évangile de Marie-Madeleine
Dialogue entre Marie de Magdala et les apôtres, centré sur une révélation intérieure reçue du Christ.Évangile selon Philippe
Texte gnostique traitant du mariage spirituel, du sacré dans le corps et de la connaissance cachée.Évangile selon Judas
Judas y est présenté comme le disciple privilégié à qui Jésus confie un savoir caché.Évangile selon Pierre
Récit de la Passion et de la Résurrection, avec des éléments miraculeux absents des canoniques.Protévangile de Jacques
Récit de la naissance de Marie, de son enfance et de la nativité de Jésus.Évangile de l’enfance selon Thomas
Histoires légendaires sur l’enfance de Jésus, avec des miracles parfois violents.Évangile des Égyptiens
Texte gnostique centré sur l’âme, le silence et la parole de Jésus à des disciples initiés.Évangile des Hébreux
Texte fragmentaire cité par des auteurs anciens, probablement en araméen ou hébreu, évoquant une christologie très judaïque.Évangile des Nazaréens
Adaptation du récit évangélique à une communauté judéo-chrétienne proche du judaïsme.Évangile selon les Ébionites
Texte fragmentaire où Jésus est vu comme un prophète inspiré, non comme Fils de Dieu.
Actes apocryphes
Actes de Pierre
Récits de miracles et du martyre de Pierre à Rome, avec des éléments symboliques.Actes de Paul
Histoires édifiantes sur les voyages de Paul, son enseignement et ses confrontations.Actes de Paul et Thècle
Jeune femme noble convertie par Paul, qui défie les normes sociales et religieuses.Actes de Jean
Mélange de récits de miracles et d’enseignements mystiques attribués à Jean l’apôtre.Actes de Thomas
Voyage missionnaire en Inde attribué à Thomas, avec des discours sur le salut intérieur.Actes d’André
Récits sur la prédication et le martyre de l’apôtre André, souvent de ton ascétique.Actes de Barnabé
Évangélisation attribuée à Barnabé, compagnon de Paul, dans des terres païennes.
Lettres et textes doctrinaux
Lettre des apôtres
Texte didactique où le Christ ressuscité répond aux questions de ses disciples.Lettre de Pilate
Lettre apocryphe prétendument écrite par Ponce Pilate à l’empereur, pour justifier la crucifixion.Correspondance entre Paul et Sénèque
Échange fictif entre l’apôtre Paul et le philosophe romain Sénèque, cherchant à concilier foi chrétienne et sagesse antique.
Apocalypses et révélations
Apocalypse de Pierre
Vision détaillée de l’au-delà, avec des descriptions des peines des damnés et des joies des justes.Apocalypse de Paul
Texte sur l’élévation de l’âme et les punitions de l’enfer, influent sur l’imaginaire chrétien médiéval.Apocalypse de Thomas
Révélation sur les signes annonçant la fin du monde, en lien avec la résurrection des morts.Apocalypse de Jean (apocryphe)
À ne pas confondre avec celle du Nouveau Testament, ce texte existe en plusieurs versions visionnaires.Révélation de Jean le Théologien
Texte ésotérique conservé en grec et en slave, centré sur des mystères célestes.Livre des secrets de Jean
Texte gnostique majeur expliquant la création du monde par des entités inférieures et la mission du Sauveur.Ascension d’Ésaïe
Texte judéo-chrétien décrivant la montée du prophète Ésaïe à travers les cieux.
Questions fréquentes sur les textes apocryphes
1. Les textes apocryphes sont-ils tous chrétiens ?
Non. Certains textes apocryphes viennent du judaïsme ancien, comme le Livre d’Hénoch ou le Testament des douze patriarches. D’autres sont d’origine chrétienne, produits entre le IIe et le IVe siècle, dans des milieux très variés.
2. Est-ce que Jésus est mentionné dans tous les textes apocryphes ?
Non. Tous ne parlent pas directement de Jésus. Certains se concentrent sur les apôtres, d’autres sur des visions célestes ou des récits symboliques. Plusieurs textes juifs apocryphes ont été écrits avant la naissance de Jésus.
3. Les textes apocryphes sont-ils considérés comme hérétiques ?
Certains ont été qualifiés d’hérétiques par les autorités religieuses, surtout ceux associés aux mouvements gnostiques. D’autres ont simplement été écartés sans condamnation explicite, pour des raisons de cohérence doctrinale ou liturgique.
4. Pourquoi ces textes ont-ils refait surface au XXe siècle ?
Des découvertes archéologiques comme celle de Nag Hammadi en 1945 ont permis de retrouver des textes longtemps disparus ou connus seulement par des citations. Ces manuscrits ont été conservés dans des jarres, à l’abri du sable égyptien.
5. Existe-t-il des textes apocryphes dans la tradition musulmane ?
Non dans le sens chrétien du terme. Mais certains récits présents dans les textes islamiques, comme ceux concernant Jésus enfant, ont des parallèles avec des écrits apocryphes chrétiens. L’islam s’est aussi nourri de traditions extra-canoniques circulant au Proche-Orient.
6. Peut-on croire aux textes apocryphes si l’on est chrétien ?
Certains croyants les lisent comme des écrits spirituels, sans leur accorder le statut d’Écriture. Ils peuvent nourrir la réflexion, éveiller des questions, offrir un regard ancien mais libre sur la foi. Leur usage dépend du cadre dans lequel on les aborde.
7. Y a-t-il des textes apocryphes dans la Bible catholique ?
Ce qu’on appelle “livres deutérocanoniques” sont considérés comme apocryphes par les protestants, mais intégrés dans la Bible catholique. C’est le cas de Tobie, Judith, Sagesse, Siracide, Baruch, et de certains passages de Daniel et Esther.
8. Pourquoi certains textes apocryphes parlent-ils de magie ou de géants ?
Parce qu’ils s’inscrivent dans un univers symbolique ou mythologique plus large. Le Livre d’Hénoch, par exemple, reprend des traditions sur des anges déchus et des êtres hybrides. Ce type de récit servait à penser le mal, l’origine du chaos ou l’attente d’un jugement.
9. Quels textes apocryphes ont influencé l’art ou la littérature ?
De nombreux artistes se sont inspirés de l’Évangile de Thomas, du Livre d’Hénoch, ou des récits autour de Marie-Madeleine. On les retrouve dans des romans, des tableaux, des œuvres mystiques, ou plus récemment dans le cinéma et les séries.
10. Peut-on encore découvrir de nouveaux textes apocryphes ?
C’est possible. Des fragments inconnus peuvent surgir dans des collections privées ou lors de fouilles. La majorité a sans doute été retrouvée, mais les recherches continuent, notamment dans les manuscrits coptes, araméens, syriens ou gréco-latins conservés dans les bibliothèques anciennes.
Ressources en ligne pour explorer les textes apocryphes
1. Une autre vision de Jésus dans les évangiles apocryphes
Certains textes écartés du canon, comme l’Évangile de Thomas ou l’Évangile de Philippe, proposent une représentation de Jésus très différente de celle des évangiles officiels. Le site Livres Interdits présente ces écrits comme des fenêtres sur un christianisme plus mystique, plus intérieur, et montre comment ils ont influencé la culture contemporaine.
2. Une introduction claire par Yohan Picquart
Sur la page dédiée à son ouvrage, Yohan Picquart propose une présentation pédagogique des apocryphes bibliques. Il y évoque des textes comme l’Évangile de Judas, le Protévangile de Jacques, ou le Livre d’Hénoch, et explique les critères qui ont conduit à leur mise à l’écart.
3. Les écrits apocryphes chrétiens dans la Pléiade
La prestigieuse collection de la Bibliothèque de la Pléiade rassemble plusieurs textes apocryphes chrétiens, traduits du grec, du copte ou du syriaque. Elle permet une lecture sérieuse de ces documents, souvent méconnus, avec des notes détaillées et un appareil critique de haut niveau.
4. Miroir des christianismes anciens
Dans un article publié sur Nonfiction.fr, les textes apocryphes sont analysés comme des témoins de la richesse et de la diversité du christianisme des origines. L’auteur y montre comment ces écrits éclairent des courants oubliés, parfois concurrents, parfois complémentaires des grandes traditions.
5. Une liste complète et commentée par Michael Langlois
Le bibliste Michael Langlois propose une liste des textes apocryphes, classés et expliqués en fonction des traditions religieuses. On y retrouve des titres connus comme Tobie ou Judith, mais aussi des textes bien plus rares, issus du judaïsme ancien ou du christianisme primitif.