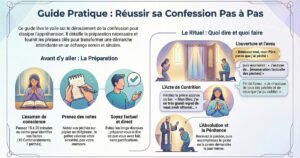Comment se lavait-on au temps de Jésus ? Quels produits étaient utilisés ? À quelle fréquence se nettoyait-on les dents, les cheveux, les vêtements ? Et comment étaient perçues les maladies liées au manque d’hygiène ? Loin de nos habitudes modernes, l’hygiène corporelle à l’époque du Nouveau Testament reposait sur des gestes simples, souvent rituels, enracinés dans une culture religieuse structurée. Entre bains rituels, huiles parfumées et soins naturels contre les poux, cet article explore en détail la vie quotidienne d’un peuple soucieux de pureté, de respect du corps et de santé dans un monde sans savon industriel, ni antibiotique.
Hygiène et soins du corps à l’époque de Jésus : pratiques, symboles et réalités
Dans la Judée du Ier siècle, se laver relevait autant de la purification religieuse que de l’entretien corporel. Loin des normes modernes, l’hygiène quotidienne était marquée par des gestes simples, une forte charge symbolique et une adaptation aux ressources disponibles.
L’importance de l’hygiène dans la société juive antique
1. Une propreté liée au culte autant qu’à la santé
Au temps de Jésus, l’hygiène ne relevait pas seulement de la santé physique. Elle avait une portée religieuse et symbolique majeure. Se laver n’était pas une habitude privée ou hygiéniste au sens moderne, mais un geste de purification, en lien avec la Loi.
Dans la tradition juive antique, la propreté corporelle participait à un état de pureté rituelle. On ne pouvait entrer dans le Temple, toucher certaines personnes, ou accomplir des actes sacrés qu’après s’être purifié selon les règles. Le Livre du Lévitique en décrit de nombreux exemples. Se laver était donc un acte spirituel, communautaire et culturel autant que corporel.
2. Les ablutions rituelles dans la vie religieuse
Les ablutions rituelles étaient codifiées : on se lavait les mains, les pieds, parfois tout le corps. Cela pouvait se faire avant un repas, avant la prière, ou après un contact jugé impur (comme un mort, une maladie, un accouchement).
Les pharisiens, par exemple, attachaient une grande importance à ces pratiques. On en retrouve la trace dans les Évangiles, où ils reprochent parfois à Jésus et à ses disciples de ne pas se laver les mains selon la tradition (Marc 7,1-5). Jésus ne nie pas la valeur de l’hygiène, mais il critique ceux qui en font un formalisme vide, sans souci intérieur.
Ces ablutions étaient souvent faites dans un mikveh, un bassin d’eau courante ou stagnante construit à cet effet. Ces bains rituels, encore présents dans le judaïsme aujourd’hui, existaient déjà en Galilée et en Judée à l’époque de Jésus. On en retrouve les traces archéologiques à Qumrân, Jérusalem ou Capharnaüm.
3. La propreté comme signe de respect et de pureté
Se laver n’était pas seulement un acte cultuel. Dans les milieux populaires comme dans les cercles religieux, la propreté extérieure était une marque de respect — envers Dieu, les autres et soi-même.
Accueillir un hôte, par exemple, impliquait de lui laver les pieds (Luc 7,44), geste d’hospitalité et d’humilité. Porter des vêtements propres, se parfumer, se raser ou s’enduire d’huile témoignaient d’une attention à la dignité humaine.
Autrement dit, l’hygiène au temps de Jésus n’était pas un luxe. Elle s’inscrivait dans une vision globale de l’homme, où le corps était un lieu de relation : à Dieu, à la communauté, à la Loi.
Comment se lavait-on à l’époque de Jésus ?
1. Baignades, jarres, bassins : les moyens disponibles
Au Ier siècle, se laver nécessitait d’abord un accès à l’eau, qui restait un bien précieux, souvent rare et difficile à transporter. L’eau courante n’existait pas dans les maisons ordinaires. On dépendait des citernes, des puits ou des sources naturelles.
Les habitants des campagnes se lavaient souvent au seau ou dans une jarre. Dans les villes, certaines maisons plus aisées disposaient de bassins ou de petits réservoirs. En milieu rural, les rivières ou les points d’eau naturels étaient les lieux privilégiés pour la toilette.
Dans certains contextes communautaires ou religieux (notamment chez les Esséniens ou dans les milieux pharisiques), on trouvait des installations plus élaborées, comme les mikva’ot : des bassins en pierre destinés aux purifications rituelles. Ils servaient aussi à se laver de manière plus complète.
2. Se laver sans savon : sable, huile, argile
Il n’y avait pas de savon au sens moderne, mais plusieurs méthodes de nettoyage étaient utilisées. Les plus courantes :
Le sable ou la cendre, pour frotter le corps et détacher la saleté ;
L’huile, qui servait à enduire puis gratter la peau (comme dans les bains grecs et romains) ;
Des pâtes d’argile, parfois parfumées, utilisées comme produits nettoyants ou adoucissants.
Ces pratiques permettaient de retirer la sueur, la poussière et les odeurs, même sans mousse. Après le frottement, on se rinçait abondamment avec de l’eau.
Les classes aisées pouvaient s’offrir des huiles parfumées, à base de myrrhe, de nard ou d’olives. Ces produits étaient autant des cosmétiques que des éléments de soin ou de statut.
3. Hygiène personnelle et collective : familles, villages, temples
La toilette était en général personnelle, mais dans certains contextes, elle pouvait devenir collective. Lors des grands rassemblements religieux à Jérusalem, ou dans des communautés rurales, on pouvait assister à des lavages en groupe, notamment pour les rites de purification.
Dans les familles juives, se laver faisait partie des gestes de préparation au sabbat, aux fêtes, ou à un événement religieux important. Mais cela restait fonction de l’accès à l’eau et au temps disponible.
Les enfants, les personnes âgées ou les malades dépendaient souvent des autres pour leur hygiène. On se lavait surtout les pieds, les mains et le visage, les parties du corps les plus exposées à la poussière ou au contact rituellement impur.
Découvrez également les versets sur l’amité Islam
À quelle fréquence, et où se lavait-on ?
1. L’eau comme bien précieux : pas de bains quotidiens
Au temps de Jésus, la toilette quotidienne telle que nous la concevons aujourd’hui était impossible pour la majorité de la population. L’eau devait être tirée à la main, transportée, stockée avec soin. Dans un climat sec et chaud, elle était d’abord réservée à la cuisson, à l’irrigation, et à l’abreuvement des animaux.
Se laver intégralement le corps n’était donc ni fréquent, ni attendu dans les milieux ordinaires. On se contentait souvent de lavages partiels (mains, pieds, visage) à raison de quelques fois par semaine, et plus systématiquement avant les fêtes religieuses, les repas sacrés ou le sabbat.
Les personnes vivant près d’un point d’eau pouvaient bien sûr se laver plus facilement. Mais pour beaucoup, l’accès à l’eau conditionnait la fréquence des lavages.
2. Les lieux : maisons, citernes, mikveh, rivières
L’endroit où l’on se lavait dépendait du lieu de vie et du statut social.
Dans les maisons simples, on utilisait une jarre ou un bassin mobile dans une pièce retirée, parfois à l’extérieur. Il n’y avait pas de salle d’eau au sens moderne.
Les villages disposaient souvent d’un puits ou d’un point d’eau partagé où l’on se rinçait les mains ou les pieds.
Les rivières, comme le Jourdain, servaient à la fois aux ablutions, aux lessives et aux immersions rituelles.
Dans les milieux religieux, on trouvait des mikva’ot, bassins rituels souvent creusés dans la pierre, avec un escalier pour descendre et se plonger entièrement.
Le Temple de Jérusalem lui-même était entouré de dispositifs d’eau pour permettre aux prêtres et aux pèlerins de se purifier avant d’entrer dans l’enceinte sacrée.
3. Les jours particuliers : sabbat, fêtes, puretés rituelles
Certaines dates ou événements imposaient une purification spécifique :
Avant le sabbat, on se lavait pour se présenter devant Dieu dans un état de propreté.
À l’occasion des fêtes religieuses (Pâque, Yom Kippour, Souccot…), les pèlerins montés à Jérusalem pratiquaient des ablutions obligatoires.
Les situations dites d’impureté rituelle (pertes corporelles, contact avec un mort, accouchement, lèpre…) nécessitaient des bains prescrits par la Loi de Moïse.
Ces moments rituels ont structuré une forme d’hygiène qui, même si elle n’était pas quotidienne, reposait sur une logique régulière et codifiée, vécue dans le cadre de la foi.
Existait-il des savons ou shampoings au temps de Jésus ?
1. Le savon végétal ou la cendre : nettoyage rudimentaire
À l’époque de Jésus, le savon tel que nous le connaissons aujourd’hui n’existait pas encore sous forme solide parfumée. Mais certaines formes rudimentaires de nettoyage étaient bien connues.
Les populations du Proche-Orient utilisaient un mélange de cendres végétales (souvent de bois de tamaris ou d’olivier) et de graisse animale ou végétale. Ce mélange, alcalin, produisait une pâte nettoyante qui permettait de retirer les impuretés du corps ou des vêtements.
D’autres pratiques consistaient à frotter la peau avec du sable, de la terre fine, ou même des fragments d’argile sèche, qui agissaient comme un exfoliant naturel. On utilisait ensuite de l’eau pour se rincer, parfois en se servant de feuilles ou de morceaux de tissu.
Ces gestes étaient efficaces pour enlever la saleté visible, mais ils laissaient le corps sans parfum ni sensation de fraîcheur durable, contrairement à nos savons modernes.
2. Huiles parfumées, onguents et onctions
Pour compenser l’absence de savon parfumé, on utilisait souvent des huiles parfumées. L’huile d’olive était omniprésente : elle servait à la cuisine, à l’éclairage, mais aussi à l’hygiène. Après le bain ou le lavage, on s’en enduisait le corps. Cela protégeait la peau, faisait briller les cheveux, et laissait une odeur agréable.
Des essences de myrrhe, de nard, d’encens ou de cannelle pouvaient être ajoutées à ces huiles. Les femmes (et parfois les hommes) utilisaient aussi des onguents pour adoucir la peau ou soigner les plaies. Le célèbre passage où une femme verse du nard sur les pieds de Jésus (Jean 12,3) en est un exemple : ces produits étaient précieux, réservés aux grandes occasions.
L’onction (verser de l’huile sur la tête ou le corps) avait aussi une dimension symbolique et religieuse : signe de consécration, d’hospitalité ou de guérison.
3. Soins des cheveux et du cuir chevelu dans l’Antiquité
Il n’existait pas de shampoing au sens moderne, mais les cheveux faisaient l’objet de soins particuliers.
On les enduisait d’huile, pour les nourrir, les démêler et les faire briller.
On les peignait régulièrement avec des peignes en bois ou en os, souvent pour retirer la poussière ou les parasites.
En cas de grande chaleur ou d’impureté, il arrivait qu’on se rase la tête, notamment chez les hommes ou les prêtres.
Les femmes laissaient souvent pousser leurs cheveux, qu’elles nouaient ou couvraient. Elles pouvaient aussi parfumer leur chevelure avec des huiles spécifiques, comme signe de beauté ou de respect lors des cérémonies.
L’hygiène dentaire au temps de Jésus
1. Que savait-on des dents et de leur entretien ?
Dans l’Antiquité, l’hygiène dentaire n’était ni ignorée, ni systématisée. On savait que les dents pouvaient se gâter, tomber ou faire souffrir, mais les moyens de les entretenir restaient très rudimentaires. Le lien entre alimentation sucrée et carie n’était pas connu, mais l’importance de nettoyer la bouche était comprise dans de nombreuses cultures, y compris dans le judaïsme ancien.
Les textes bibliques n’abordent pas directement les soins dentaires, mais l’état des dents est souvent associé à la force, la beauté ou la santé morale (par exemple, dans le Cantique des Cantiques ou certains psaumes). Une dentition abîmée pouvait être vue comme une faiblesse ou un signe de déchéance.
2. Utilisait-on des bâtons à mâcher ou des poudres ?
Oui, il existait des pratiques naturelles pour nettoyer les dents et rafraîchir l’haleine. Plusieurs objets et substances étaient utilisés :
Des bâtons à mâcher (souvent de bois tendre ou de racines aromatiques), à l’extrémité effilochée, servaient à frotter les dents et les gencives. C’est une pratique qu’on retrouve encore aujourd’hui au Moyen-Orient avec le siwak ou l’arak.
Des poudres abrasives, à base de cendre, de sel ou de coquille broyée, pouvaient être appliquées pour frotter les dents.
Certains se rinçaient la bouche avec de l’eau salée, parfois tiède, pour désinfecter ou soulager des douleurs.
Ces gestes n’étaient pas codifiés comme aujourd’hui, mais ils témoignent d’une volonté de conserver un minimum de propreté buccale.
3. L’état dentaire retrouvé chez les squelettes antiques
Les fouilles archéologiques en Israël, en Égypte ou en Syrie montrent que l’état dentaire des populations du Ier siècle était très variable. On observe :
De nombreuses usures dentaires, dues à des aliments durs, aux grains de sable dans la farine ou à l’absence de cuisson douce.
Des caries fréquentes chez les personnes âgées, mais aussi chez les enfants dans les milieux urbains.
Des abcès, parfois mortels, car aucune solution chirurgicale fiable n’existait.
Et surtout une perte régulière des molaires, souvent dès 30 ou 40 ans.
Ces données confirment que, sans hygiène moderne, les dents souffraient très tôt. Mais la rareté des aliments sucrés limitait tout de même les dégâts. Le pain complet, les légumes secs et l’huile d’olive formaient l’essentiel du régime, ce qui protégeait en partie les dents de la carie massive.
Les maladies liées au manque d’hygiène dans la Bible
1. Lèpre, parasites, infections de la peau
Dans le monde de Jésus, le manque d’hygiène favorisait plusieurs types de maladies. La plus emblématique dans la Bible reste la lèpre, bien que ce terme recouvre en réalité un ensemble d’affections cutanées : ulcères, croûtes, décolorations, eczémas graves…
La lèpre biblique (hébreu : tsaraat) n’est pas forcément la lèpre bactérienne moderne. C’est un mot générique qui désignait toute altération visible de la peau, jugée inquiétante, contagieuse ou impure. Les personnes atteintes étaient exclues du camp ou du village, tenues à l’écart, souvent sans soins.
Les parasites cutanés comme les gales, les mycoses ou les infections mal soignées étaient aussi courants. En l’absence de savons désinfectants ou d’antibiotiques, une simple coupure pouvait devenir dangereuse.
La peau, exposée au soleil, à la poussière, aux insectes et au contact animal, était un terrain propice aux infections. Le rôle de l’eau dans la prévention était donc important, mais son accès restait limité.
2. Eau stagnante, blessures non soignées, mouches
Le manque d’hygiène des points d’eau favorisait aussi la prolifération des maladies. Une eau mal stockée, souillée par des animaux ou utilisée par des malades devenait vite un vecteur d’épidémie.
Les blessures – fréquentes en milieu rural ou artisanal – s’infectaient facilement. L’absence de pansements, de désinfection ou de sutures sérieuses conduisait à des abcès, des septicémies, parfois mortelles.
La présence constante de mouches, de vers ou de moustiques favorisait la propagation de certaines maladies intestinales ou parasitaires. Les enfants et les personnes âgées étaient les plus vulnérables.
Même si les textes bibliques ne décrivent pas en détail toutes ces affections, ils reflètent un monde familier de la souffrance corporelle, des corps abîmés, et d’une santé toujours précaire.
3. La réaction sociale : isolement, purification, exclusion
La réponse à la maladie, dans la société juive du Ier siècle, était souvent rituelle autant que médicale. Une personne malade était considérée comme impure. Elle devait se montrer, si possible, à un prêtre, qui constatait la gravité des symptômes (cf. Lévitique 13-14).
L’impureté n’était pas une punition morale, mais un état temporaire, qui empêchait la participation au culte ou à la vie communautaire. Pour retrouver sa place, il fallait :
Guérir physiquement
Se laver
Et parfois offrir un sacrifice de purification au Temple
Jésus, dans les Évangiles, guérit souvent des malades exclus pour des raisons d’impureté. Il touche les lépreux, les hémorroïsse, les paralytiques. Ce n’est pas seulement un acte médical : c’est un geste de réintégration sociale et spirituelle.
Avaient-ils des poux au temps de Jésus ?
1. Parasites capillaires et corporels : une réalité constante
Oui, les poux faisaient partie du quotidien au temps de Jésus. Ils étaient omniprésents dans toutes les couches sociales, même les plus aisées. La présence de parasites corporels était un fait admis, bien que gênant. On distingue principalement :
Les poux de tête (Pediculus humanus capitis), fréquents chez les enfants et les femmes aux cheveux longs ;
Les poux de corps, qui vivent dans les vêtements et provoquent des démangeaisons ;
Les lentes, faciles à repérer dans la chevelure sombre et abondante des populations du Moyen-Orient.
La chaleur, les vêtements peu lavés, la promiscuité dans les maisons et l’absence de traitements efficaces favorisaient leur prolifération. Les mentions de poux, puces, gales ou teignes ne manquent pas dans les écrits antiques, et parfois même dans les textes religieux.
2. Se débarrasser des poux : peignes, huiles, rasages
Pour lutter contre les poux, plusieurs méthodes étaient utilisées :
Le peigne à poux, très fin, fabriqué en bois ou en os. On en a retrouvé dans de nombreuses fouilles archéologiques, y compris en Galilée.
Les huiles (souvent d’olive ou de cèdre), appliquées sur le cuir chevelu pour étouffer les parasites et faciliter leur retrait.
Le rasage partiel ou complet de la tête, en particulier chez les hommes ou dans certains rites de purification. Se couper les cheveux était parfois un acte de santé autant que de piété.
Ces gestes n’étaient pas marginaux. Ils faisaient partie des soins courants, au même titre que se laver les pieds ou s’enduire d’huile.
3. Mention des poux et maladies dans les écrits bibliques
Même si les poux ne sont pas cités nommément dans les Évangiles, ils apparaissent dans l’Ancien Testament comme une punition symbolique : l’une des dix plaies d’Égypte (Exode 8,12-15) est l’invasion de la vermine, parfois traduite par « poux », « moustiques » ou « moucherons ».
Leur évocation renvoie à un monde sans produits chimiques ni hygiène moderne, où la lutte contre les parasites était constante, mais jamais complètement gagnée.
Ce contexte rend d’autant plus frappants les gestes de Jésus qui touchait les corps, guérissait les malades, s’approchait des exclus. Il assumait cette humanité fragile, blessée, vulnérable, avec dignité et compassion.

Le Mercredi des Cendres : Quand la poussière nous rappelle qui nous sommes
Questions complémentaires sur l’hygiène au temps de Jésus
1. Les Romains avaient-ils une influence sur l’hygiène des Juifs en Galilée ou en Judée ?
Oui, dans certaines villes de Galilée romanisée (comme Tibériade ou Césarée maritime), la présence romaine a introduit des infrastructures plus élaborées : thermes, aqueducs, latrines publiques. Mais les Juifs pratiquants restaient attachés à leurs propres normes rituelles d’hygiène, très différentes de la culture du bain collectif romain, souvent jugé immoral en contexte juif. Il y a donc eu cohabitation de deux systèmes : l’hygiène romaine publique, et l’hygiène juive privée et rituelle.
2. Quelle était la place de l’hygiène dans la pédagogie de Jésus ?
Jésus ne prône pas directement une hygiène physique, mais il utilise le langage de la pureté pour parler du cœur. Dans Marc 7, par exemple, il remet en cause les ablutions rituelles imposées par certains pharisiens, en disant : « Ce n’est pas ce qui entre dans l’homme qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur ». Il ne nie pas la propreté, mais il recentre la question : la vraie impureté vient du mal intérieur, pas de l’extérieur.
3. Comment gérait-on l’hygiène féminine à l’époque ?
Les femmes utilisaient probablement des linges réutilisables, lavés à la main, pour gérer les menstruations. La Loi de Moïse (Lévitique 15) prévoyait une période d’isolement rituel pendant les jours d’écoulement, suivie d’un bain purificateur. L’hygiène intime était donc mêlée à des pratiques religieuses précises. Le sujet n’était pas tabou, mais intégré à une vision globale du corps féminin dans le cycle de la pureté.
4. Comment faisaient les voyageurs ou les pèlerins pour se laver ?
Les voyageurs, nombreux à l’époque (notamment pour les montées à Jérusalem), se lavaient en route avec ce qu’ils trouvaient : eau des puits, sources, ou ruisseaux. Certains aubergistes proposaient des bassins pour se rincer les pieds (Luc 7,44). Les lavages étaient sommaires mais jugés essentiels avant les repas ou la prière. L’hospitalité comprenait souvent l’offre d’eau pour se laver dès l’arrivée.
5. Les enfants recevaient-ils une éducation à l’hygiène ?
Oui, l’hygiène faisait partie de l’éducation religieuse. Les garçons, en particulier, apprenaient très tôt les gestes de purification (ablutions, respect des lois de propreté, lavage des mains avant les repas). Ce n’était pas enseigné comme une science du corps, mais comme une obéissance à la Loi. L’imitation des parents, surtout du père, jouait un grand rôle.