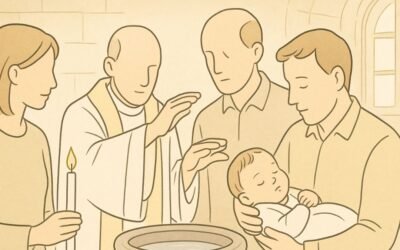Un texte chrétien apocryphe attribué à Jean l’Évangéliste
La Révélation de Jean le Théologien est un écrit apocryphe chrétien, probablement composé entre le IVe et le VIe siècle, dans un contexte marqué par la piété monastique et les interrogations sur la destinée des âmes après la mort.
Ce texte ne doit pas être confondu avec l’Apocalypse de Jean, dernier livre du Nouveau Testament, bien qu’il revendique la même autorité en se plaçant sous la figure de Jean le Théologien (autre nom de Jean l’Évangéliste dans la tradition orientale).
Il s’agit d’un texte de révélation posthume, qui développe des visions de l’au-delà, des dialogues entre l’âme et les puissances célestes, et des descriptions du jugement dernier.
Il a été largement diffusé dans les Églises d’Orient, surtout en copte et en slave.
Origine, langue et transmission de la Révélation de Jean le Théologien
Le texte a été composé en milieu chrétien oriental, probablement en Égypte ou en Palestine, dans un contexte marqué par une forte attente eschatologique.
Il a été transmis en copte, grec, géorgien, slavon, et arménien. Il ne figure dans aucun canon officiel, mais il a été lu dans certains milieux ascétiques et mystiques, comme un guide pour penser la purification de l’âme.
Il s’agit d’un texte pseudépigraphe, c’est-à-dire attribué à un auteur célèbre pour renforcer son autorité, sans lien réel avec Jean.
Le contenu : voyage de l’âme, jugement et intercession
Le récit commence au moment où Jean approche de sa mort. Le Christ lui apparaît et lui révèle ce qui adviendra après la mort des justes et des pécheurs.
Jean est ensuite transporté par des anges dans les différents lieux célestes et infernaux, où il voit :
des anges qui guident les âmes,
des démons qui réclament les pécheurs,
des supplices attribués à certains vices,
des prières pour les morts,
des interventions du Christ en faveur de certaines âmes.
Le texte insiste sur la justesse du jugement, mais aussi sur la possibilité de miséricorde. Il développe une théologie de la responsabilité personnelle, mais aussi de l’intercession.
Pourquoi ce texte n’a pas été intégré au canon
La Révélation de Jean le Théologien a été exclue du canon pour plusieurs raisons :
Sa date tardive,
Son contenu très imagé, souvent plus proche du folklore que de la tradition biblique,
Son attribution fictive à Jean,
Son absence dans les listes anciennes des textes reçus par l’Église.
Il a toutefois été toléré dans plusieurs traditions orthodoxes orientales, parfois lu dans les monastères ou copié à des fins catéchétiques.
Ce que ce texte révèle sur la foi et l’au-delà dans l’Antiquité chrétienne
Ce texte montre que les premiers chrétiens ne se contentaient pas de concepts. Ils avaient besoin de représentations concrètes : anges, chemins, épreuves, voix divines, lieux symboliques.
Il témoigne d’un christianisme pratique, tourné vers la vie éternelle, la préparation à la mort, et la souffrance des âmes non purifiées.
Il a nourri les représentations populaires du ciel et de l’enfer, et influencé la littérature eschatologique médiévale, bien au-delà de son usage originel.
Questions fréquentes sur la Révélation de Jean le Théologien
1. Ce texte fait-il partie du Nouveau Testament ?
Non. Il s’agit d’un texte apocryphe, distinct de l’Apocalypse de Jean. Il n’a jamais été reconnu comme canonique.
2. Est-il attribué au même Jean que l’Apocalypse biblique ?
Le texte se réclame de Jean le Théologien, nom donné à Jean l’Évangéliste dans la tradition orientale. L’attribution est pseudonyme, sans lien réel avec l’apôtre.
3. Quand ce texte a-t-il été écrit ?
Il a été composé entre le IVe et le VIe siècle, dans un milieu chrétien oriental, influencé par les courants monastiques.
4. Quelle est sa langue d’origine ?
La version originale semble avoir été en grec, mais il a surtout été transmis en copte, slavon, arménien et géorgien.
5. Que raconte ce texte ?
Il décrit le voyage de l’âme après la mort, les rencontres avec les anges, les épreuves du jugement, et les supplices infligés aux pécheurs, avec parfois des gestes de miséricorde accordés par le Christ.
6. Ce texte a-t-il été utilisé dans la liturgie ?
Non. Il a été copié et lu dans certains milieux ascétiques, mais jamais intégré à la liturgie officielle.
7. Ce texte parle-t-il du paradis et de l’enfer ?
Oui. Il décrit les destinées opposées des âmes, avec des images symboliques et marquantes qui ont influencé la représentation chrétienne de l’au-delà.
8. Pourquoi ce texte a-t-il été exclu du canon ?
À cause de son origine tardive, de son style populaire, et de son attribution fictive à Jean. Il ne répondait pas aux critères fixés pour les textes bibliques.
9. Peut-on le lire aujourd’hui en français ?
Oui. Il figure dans des recueils comme les Écrits apocryphes chrétiens (Pléiade) ou d’autres traductions chez Cerf ou Bayard.
10. À quoi sert ce texte aujourd’hui ?
Il éclaire la vision chrétienne ancienne de la mort, la valeur morale du jugement, et la manière dont les fidèles étaient instruits par des images fortes, en dehors des textes canoniques.