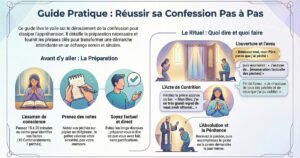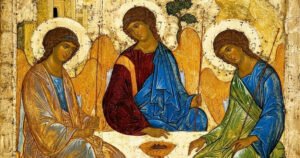Comprendre Léon XIV : le pape venu du terrain et tourné vers les périphéries
Ce condensé vous permet de découvrir l’essentiel sur le parcours, les convictions et les défis du nouveau pape Léon XIV, premier pontife américain de l’histoire, élu en mai 2025.
Une chanson en hommage au pape Léon XIV : “Pontife des ponts”
Découvrez cette chanson qui a été écrite pour saluer le début du pontificat de Léon XIV. Elle évoque, avec poésie et foi, les ponts qu’il bâtit entre les peuples, les cultures et les âmes. Un chant d’espérance, porté par une voix qui rassemble, dans la fidélité à l’Évangile et l’ouverture au monde.
Pour vous abonner à notre nouvelle chaîne Youtube Voxenigma cliquez ici
Léon XIV : Un parcours atypique, entre Chicago et le Pérou
1. Un Américain devenu pape : une première historique
Ce n’est pas tous les jours que l’Église catholique élit un pape américain. C’est même une première. Jusqu’ici, le pontificat avait toujours été confié à des Européens ou à des Sud-Américains. Alors quand le nom de Robert Francis Prevost a été annoncé au balcon de la basilique Saint-Pierre, le 8 mai 2025, beaucoup ont d’abord été surpris. Et pour cause : né à Chicago en 1955, il n’était pas considéré comme un « papabile » évident.
Il faut dire qu’il n’a jamais fait partie des figures médiatiques du Vatican. Il n’a pas enchaîné les postes à Rome pendant vingt ans. Ce n’était pas un nom qui circulait beaucoup dans la presse spécialisée. Mais dans les cercles ecclésiastiques, sa réputation était solide : celle d’un homme humble, rigoureux, marqué par une vraie expérience pastorale sur le terrain.
Il est aussi membre de l’ordre des Augustins, ce qui le distingue encore un peu plus de ses prédécesseurs récents, issus d’ordres plus présents dans les structures du pouvoir romain. Ce détail peut sembler anecdotique, mais dans l’univers très symbolique de l’Église, cela compte : cela dit quelque chose de sa spiritualité, de son rapport au pouvoir, de sa manière d’envisager la charge pontificale.
2. Une vie au service des plus pauvres au Pérou
C’est peut-être l’aspect de son parcours qui explique le mieux son élection. Dans les années 1980, il quitte les États-Unis pour partir en mission au nord du Pérou, dans la région de Trujillo, puis à Chiclayo. Il ne s’agit pas d’un simple séjour ponctuel. Il y restera plus de vingt ans. Il vit avec les gens, partage leur quotidien, apprend leur langue, adopte leur culture. Ce n’est pas un évêque étranger parachuté pour gérer un diocèse : c’est un homme qui s’enracine, qui s’engage durablement. Il finit d’ailleurs par demander et obtenir la nationalité péruvienne.
Ce choix n’est pas neutre. Il révèle une vision très claire de ce que doit être un pasteur : quelqu’un qui marche avec le peuple, pas au-dessus. Il vit dans des quartiers pauvres, dans une région marquée par la violence et les inégalités, parfois oubliée du pouvoir central. Il y organise des actions sociales, soutient des projets éducatifs, encourage la formation des jeunes prêtres locaux.
Les fidèles qui l’ont connu sur place parlent d’un homme discret mais à l’écoute, ferme sur ses convictions mais toujours bienveillant dans ses relations. Cette proximité avec les périphéries, chère au pape François, a sans doute beaucoup pesé dans les choix des cardinaux.
3. Un poste-clé à Rome, juste avant son élection
Ceux qui suivent la politique vaticane savent que certaines nominations en disent long sur les dynamiques en cours. Et justement, en 2023, Robert Prevost est appelé à Rome pour diriger le Dicastère pour les évêques. C’est un poste très stratégique, car ce dicastère supervise toutes les nominations épiscopales à travers le monde. C’est une fonction à la fois spirituelle, diplomatique et politique. Y être nommé, c’est entrer dans le cercle très resserré des personnes de confiance du pape.
Ce passage par la Curie, même bref, a permis à Prevost de faire la transition entre sa vie pastorale et les rouages institutionnels du Saint-Siège. Il n’y est resté que deux ans, mais cela a suffi pour qu’il imprime sa manière de faire : rigueur, sens du discernement, peu d’intérêt pour les jeux d’influence.
C’est aussi à ce moment-là qu’il commence à apparaître comme un possible successeur de François. Il n’en donne pas l’image classique – pas d’ambition affichée, pas de lobbying visible – mais certains cardinaux cherchent justement ce profil-là. Quelqu’un de stable, d’expérimenté, de profondément croyant, capable de continuer le chemin ouvert sans tout bouleverser.

Source wiki commons, auteur: Edgar Beltrán / The Pilla
Une ligne entre tradition et volonté d’ouverture
1. Lutte contre la pauvreté et souci des laissés-pour-compte
Ce qui frappe d’abord, chez Léon XIV, c’est cette attention constante pour les personnes qu’on n’écoute jamais. Les pauvres, les migrants, les populations indigènes, les victimes de violence ou d’injustice – ce sont elles qu’il cite spontanément quand il parle de l’Église. Pour lui, la foi n’est pas une affaire abstraite. Elle se joue dans la manière dont on traite les plus vulnérables.
Il reprend d’ailleurs, presque mot pour mot, certaines expressions du pape François : « l’Église des périphéries », « une Église hôpital de campagne », « une Église qui sort ». Ce n’est pas une posture. Ce sont des mots qu’il connaît de l’intérieur, parce qu’il les a vécus. Il sait ce que c’est, une paroisse sans électricité. Il sait ce que c’est, une famille qui ne peut pas enterrer ses morts dignement. Et il pense que la mission de l’Église est d’aller là, précisément là.
Cela se voit dans ses premières prises de parole comme pape. Il ne commence pas par évoquer la doctrine, les dogmes ou l’unité théologique. Il parle de paix, de faim dans le monde, de justice sociale. Il rappelle que la crédibilité de l’Église dépend aussi – et peut-être surtout – de son engagement réel pour soulager la souffrance humaine.
2. Des positions prudentes mais ouvertes sur les sujets sensibles
C’est probablement ici que les regards sont les plus attentifs. Sur les sujets dits « sensibles » – les droits des personnes homosexuelles, le rôle des femmes dans l’Église, la place des divorcés remariés – Léon XIV avance avec une certaine prudence. Mais cette prudence n’est pas un refus de bouger. C’est une façon de tenir ensemble plusieurs exigences : fidélité à la tradition d’un côté, conscience du monde contemporain de l’autre.
Par exemple, il ne remet pas en cause l’enseignement officiel sur le mariage ou la sexualité. Mais il insiste sur l’accueil inconditionnel, sur le respect de chaque personne, sur l’importance d’écouter les parcours de vie. Il rappelle que la première mission de l’Église est d’accompagner, pas de juger.
Concernant les femmes, il n’ouvre pas la porte à l’ordination. Il dit même clairement qu’il n’en voit pas la possibilité aujourd’hui. Mais dans le même souffle, il affirme que les femmes doivent prendre toute leur place dans les décisions, la gouvernance, l’enseignement, la formation. Il parle d’une Église qui ne peut plus fonctionner « à moitié », avec la moitié de ses membres dans l’ombre.
Il ne cherche pas à provoquer, ni à faire des annonces spectaculaires. Il avance lentement, parfois en reprenant les mots de ses prédécesseurs, mais toujours en laissant entendre que le dialogue est possible. Cela suffit, pour certains, à voir en lui un pape d’ouverture. Pour d’autres, c’est encore trop timide. Mais dans les faits, il dessine un pont entre des camps qui s’opposaient frontalement.
3. Une critique assumée des politiques migratoires sévères
On ne peut pas dire qu’il ait évité le sujet. Même avant son élection, Robert Prevost s’est exprimé plusieurs fois sur les politiques migratoires, notamment aux États-Unis. Il a dénoncé les discours de peur, les murs, les expulsions brutales. Il ne parle pas comme un responsable politique, mais comme un pasteur. Pour lui, la question migratoire est d’abord une question de dignité humaine.
Il cite souvent le Livre de l’Exode ou l’Évangile selon Matthieu, quand Jésus dit : « J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. » Ce n’est pas une opinion. C’est un fondement biblique, à ses yeux. Et il attend de l’Église qu’elle soit cohérente avec ce message.
Il sait que c’est un sujet clivant. Il sait aussi qu’il y a des catholiques, y compris très pratiquants, qui rejettent l’accueil des migrants. Mais cela ne le pousse pas à arrondir les angles. Il préfère rappeler que la foi chrétienne ne peut pas s’accommoder d’un nationalisme dur. Même si cela déplaît. Même si cela dérange.
Un pape face à des dossiers lourds
1. Le scandale des abus sexuels dans l’Église
Ce sujet ne quitte jamais vraiment l’agenda d’un pape. Depuis plus de vingt ans, l’Église catholique est confrontée à une crise profonde liée aux abus sexuels commis par des membres du clergé. Et cette crise n’est pas seulement morale ou judiciaire. Elle touche la confiance, la mémoire, la parole des victimes. Elle oblige à repenser la manière dont l’institution fonctionne, protège, ou parfois se protège.
Léon XIV n’arrive pas les mains vides sur ce terrain. Il a lui-même eu à gérer plusieurs situations complexes au Pérou, notamment dans le diocèse de Chiclayo. Ce qu’on lui reproche parfois – surtout de la part d’associations de victimes – c’est d’avoir mis du temps à réagir, ou d’avoir manqué de transparence sur certains cas précis. Ces critiques existent, elles ne sont pas anecdotiques, et elles ont été relayées dans des médias internationaux dès l’annonce de son élection.
Mais on trouve aussi un autre discours : celui de prêtres, de juristes et même de victimes qui ont vu en lui quelqu’un de profondément à l’écoute, soucieux de clarifier les procédures, de faire remonter les signalements. Ce n’est pas un militant. Ce n’est pas non plus un pape qui cherche à faire de grands gestes. Mais il sait que cette question est devenue centrale pour la crédibilité de l’Église. Il a déjà annoncé vouloir renforcer encore la formation des prêtres, revoir les mécanismes de contrôle dans les diocèses, et créer une cellule de réponse rapide aux alertes venues du terrain.
Tout cela reste à observer dans les mois qui viennent. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’aura pas d’état de grâce sur ce point. Il sera attendu, très vite, très concrètement.
2. Maintenir l’unité dans une Église divisée
L’Église d’aujourd’hui n’est plus un bloc monolithique. Elle est traversée par des tensions fortes, parfois même violentes dans le ton : entre les tenants d’une tradition rigide et ceux qui veulent ouvrir de nouveaux chemins. Certains refusent catégoriquement toute évolution. D’autres demandent des changements en profondeur, y compris sur le célibat des prêtres, la bénédiction des couples homosexuels, la participation des laïcs à la gouvernance.
Léon XIV le sait, et il connaît ces débats de l’intérieur. En tant que préfet du dicastère pour les évêques, il a côtoyé des profils très variés, parfois même opposés. Son style, jusqu’ici, a toujours été celui du dialogue. Il écoute. Il consulte. Il tranche peu, mais il avance. Cette manière de faire peut sembler trop lente à ceux qui voudraient des gestes plus forts. Mais elle a l’avantage de ne pas rompre le lien avec une partie du clergé, très attachée à la tradition.
Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il cherche à maintenir le lien. Il sait que s’il pousse trop vite, une partie de l’Église peut se crisper. Et il sait aussi que s’il ne bouge pas, une autre partie peut se détourner. Il marche donc sur une ligne de crête, avec la conscience très nette que l’unité de l’Église est une condition de sa survie à long terme.
3. Une Église présente sur la scène internationale
Le rôle du pape ne se limite pas à diriger l’institution catholique. Il est aussi, dans une certaine mesure, un acteur diplomatique. Les prises de position du Saint-Siège sur des conflits armés, sur la faim dans le monde, sur la situation des minorités religieuses, pèsent dans les équilibres géopolitiques. Léon XIV hérite d’un contexte complexe : la guerre en Ukraine, les tensions entre Israël et la Palestine, les persécutions des chrétiens au Nigeria, les relations compliquées avec la Chine.
Sur tous ces sujets, il va devoir prendre la parole, parfois même s’exposer. Jusqu’à présent, il n’a pas multiplié les déclarations tonitruantes. Mais ceux qui le connaissent disent qu’il a une vision très claire : le rôle du pape, dans ce domaine, c’est de rappeler l’humain. De ramener les puissants à la réalité des plus faibles. De rappeler que le pouvoir politique ne justifie pas tout.
Il ne se posera pas en chef d’État. Ce n’est pas son tempérament. Mais il a une autorité morale. Et cette autorité, il compte l’exercer surtout là où les autres ne vont pas : dans les zones grises, les silences diplomatiques, les impasses humaines.
Une personnalité sobre, ancrée dans le réel
1. Une simplicité qui tranche avec les habitudes romaines
Il y a parfois, dans les premiers gestes d’un nouveau pape, des signes qui disent beaucoup. Le soir de son élection, Léon XIV n’a pas cherché à impressionner. Il n’a pas allongé son discours, ni multiplié les bénédictions. Il s’est présenté sobrement, avec un habit liturgique plutôt traditionnel, mais sans dorures inutiles. Il a demandé qu’on prie pour lui. Et il est reparti.
Ce n’est pas un détail. À Rome, le rituel compte. La manière dont un pape se tient au balcon, les vêtements qu’il choisit, la tonalité de ses mots – tout cela est lu, commenté, parfois disséqué. Chez Léon XIV, il n’y avait pas d’effet de style. Pas de slogan. Juste une présence calme, posée, presque effacée.
Plusieurs observateurs y ont vu une forme de retour aux sources : pas une rupture spectaculaire avec François, mais une continuité dans la modestie, dans l’humilité. Ce style peut désarçonner. Il ne séduit pas par le charisme ou la formule. Il invite plutôt à regarder dans la durée.
2. Une continuité assumée avec le pape François
Ce lien est évident. Léon XIV a été l’un des proches collaborateurs de François pendant les dernières années de son pontificat. Il a été nommé à Rome par lui. Il a porté ses orientations, notamment dans la réforme des nominations épiscopales. Mais cette continuité ne signifie pas qu’il en sera une copie.
Il partage la même attention pour les périphéries, la même insistance sur le service, la même méfiance envers les privilèges. Mais il semble moins porté sur les grandes formules, plus attentif aux processus discrets, plus réservé aussi dans ses manières.
Le choix de son nom, « Léon XIV », n’est pas neutre. Il fait bien sûr écho à Léon XIII, pape à la fin du XIXe siècle, très engagé sur les questions sociales, notamment les droits des travailleurs et les conditions de vie dans un monde industriel en mutation. C’est une référence forte. Cela situe son pontificat dans une certaine lignée : celle d’un christianisme ancré dans la réalité du monde, engagé dans les débats de société, mais sans compromis sur sa foi.
Ce nom, il l’a choisi seul. Et à travers lui, il donne une orientation claire : pas de révolution de surface, mais une fidélité active à une Église qui parle aux vivants, pas aux musées.
3. Un homme de terrain devenu pape
Il y a quelque chose d’assez déroutant, au fond, dans le parcours de Léon XIV. Il ne sort pas des grandes écoles romaines. Il n’a pas passé vingt ans à diriger des congrégations. Il n’a pas bâti sa réputation à coups de tribunes ou de conférences. Il a vécu dans la poussière des campagnes péruviennes, il a appris à écouter plus qu’à parler, et il n’a jamais vraiment cherché à gravir les échelons.
Cette trajectoire-là change le regard qu’on peut porter sur lui. C’est un pape qui vient d’un quartier modeste de Chicago. Un homme qui connaît les tensions raciales, les inégalités d’accès aux soins, la fatigue d’une Église vieillissante dans les zones populaires. Et c’est un homme qui a ensuite passé des années dans des villages andins, à marcher, célébrer, accompagner.
Ce passé n’est pas effacé par la fonction. Il l’habite. Il façonne ses priorités. Et c’est peut-être pour cela que, malgré son calme apparent, il est déjà perçu comme un pape qui pourrait transformer l’Église en profondeur – non pas en la réformant par décret, mais en la recentrant, doucement, sur ce qu’elle est censée être : une présence humaine, enracinée, fidèle à l’Évangile.
Pour aller plus loin : des lectures solides pour mieux cerner Léon XIV
Si vous avez envie d’élargir un peu le regard ou de creuser certains aspects que l’on ne trouve pas toujours dans les annonces officielles, ces quelques articles valent le détour. Ce sont des sources sérieuses, bien documentées, qui permettent d’approcher le nouveau pape sous d’autres angles.
On peut commencer par un portrait très fouillé publié par The Times : l’article retrace son parcours depuis Chicago jusqu’au Vatican, en passant par ses années au Pérou, et met en lumière ses convictions, ses hésitations, mais aussi ce qu’il doit à son frère, religieux lui aussi. Ce n’est pas un texte hagiographique, au contraire : on y voit ses forces comme ses silences.
Pour comprendre d’où viennent certaines polémiques, notamment autour de ses prises de position passées, il faut lire cette enquête de l’Associated Press sur une ancienne vidéo de 2012. Il y parle des « modes de vie homosexuels » avec une distance qui a choqué, mais ce texte montre aussi comment sa posture a pu évoluer avec le temps.
Son rapport à la migration a aussi été très commenté, notamment aux États-Unis. Ce sujet est exploré dans un article du Guardian, qui cite son propre frère affirmant que Léon XIV refusera de se taire sur ces questions. Là encore, l’enjeu n’est pas théorique : il connaît la réalité des frontières et les discours politiques qui s’en emparent.
Il y a aussi, plus délicat, la question des abus sexuels dans l’Église. Léon XIV n’échappe pas aux critiques. ABC7 Chicago revient en détail sur plusieurs cas qui lui sont reprochés, notamment pour avoir réagi trop lentement lorsqu’il était supérieur religieux. Ce sont des accusations sérieuses, documentées, et qui pèseront sur les premiers mois de son pontificat.
Enfin, si vous voulez prendre un peu de recul sur sa place dans le monde, je vous conseille cet article du New Yorker. Il s’interroge sur sa capacité à être un « pape de la paix » dans un monde fragmenté, en s’appuyant sur son histoire personnelle, sa double culture, et sa manière de parler des conflits internationaux.

Comprendre la Trinité : 10 analogies et leurs limites théologiques
Foire aux questions sur le pape Léon XIV
1. Pourquoi a-t-il choisi de s’appeler Léon XIV ? Ce nom a-t-il une signification particulière ?
Oui, c’est un clin d’œil direct à Léon XIII, pape de la fin du XIXe siècle, souvent considéré comme le père de la doctrine sociale de l’Église. Ce choix indique une volonté de se situer dans une tradition très engagée sur les questions de justice, de travail, de dignité humaine. C’est un nom qui évoque à la fois l’histoire et une ligne claire, tournée vers les réalités sociales.
2. Est-ce vrai qu’il avait un compte Twitter avant d’être élu pape ?
Oui, et c’est une première. Léon XIV utilisait activement X (anciennement Twitter) sous le nom @drprevost. Ce compte, lancé bien avant son élection, contenait des messages à tonalité pastorale, mais aussi des commentaires plus personnels ou politiques, notamment sur la situation migratoire aux États-Unis ou certains débats sociaux. Depuis son élection, le compte est devenu inactif, mais il reste en ligne et consultable. Cela donne un accès rare à ses idées exprimées de manière directe, avant d’endosser le rôle de pape.
3. A-t-il des positions différentes du pape François sur certains sujets ?
Sur l’ensemble, il s’inscrit dans la continuité de François, notamment sur les priorités sociales, le souci des pauvres et la nécessité d’une Église moins centrée sur elle-même. Mais certains observateurs notent un ton plus mesuré, un style plus discret. Sur les sujets liturgiques ou doctrinaux, il est un peu plus réservé. Il ne cherche pas à provoquer, ni à trancher rapidement. Il préfère poser les conditions du dialogue.
4. Est-ce qu’il a été impliqué dans des controverses avant son élection ?
Oui, plusieurs médias ont évoqué son rôle dans la gestion de certains cas d’abus sexuels, notamment à Chicago ou au Pérou. On lui a reproché, dans certains cas précis, d’avoir tardé à réagir ou manqué de clarté dans ses décisions. D’autres voix soulignent au contraire ses efforts pour renforcer les protocoles internes. Le débat reste ouvert, et il sera jugé aussi sur la manière dont il agit désormais, comme pape.
5. Va-t-il poursuivre la réforme de la Curie initiée par François ?
Pour l’instant, il ne semble pas vouloir remettre en cause les grands équilibres créés sous François. La nouvelle organisation des dicastères, le rôle accru des laïcs, la décentralisation partielle de certaines décisions – tout cela semble maintenu. Mais il pourrait ajuster certaines fonctions, surtout en lien avec la nomination des évêques, domaine qu’il connaît bien.
6. Quel rôle a joué son passage au Pérou dans sa formation spirituelle ?
Un rôle immense. Il y a passé plus de vingt ans, appris la langue, vécu dans des conditions modestes, accompagné des communautés rurales et pauvres. Cette immersion n’était pas une simple mission temporaire. Elle a façonné sa vision de l’Église : incarnée, proche, simple, attentive aux blessures sociales. Ce n’est pas une biographie exotique : c’est la base de sa spiritualité et de son style.
7. Comment est-il perçu en Amérique latine aujourd’hui ?
Avec beaucoup d’attentes. D’un côté, il est très respecté pour son travail au Pérou, son respect des cultures locales, son sens du terrain. De l’autre, certains groupes attendent des gestes plus forts sur des sujets comme l’Amazonie, les droits des peuples autochtones ou l’écologie. Il devrait se rendre assez rapidement sur place : son lien avec cette région est personnel et profond.
8. Est-ce qu’il pourrait reprendre personnellement la parole sur son ancien compte Twitter ?
C’est peu probable. Une fois élu pape, la communication passe par les canaux officiels du Vatican. Il est désormais représenté sur le compte @Pontifex, traduit en plusieurs langues. Mais le fait d’avoir eu un compte personnel, actif et expressif, reste une singularité. Cela montre qu’avant d’être pape, il s’exprimait comme un homme de terrain, engagé dans les débats du temps.