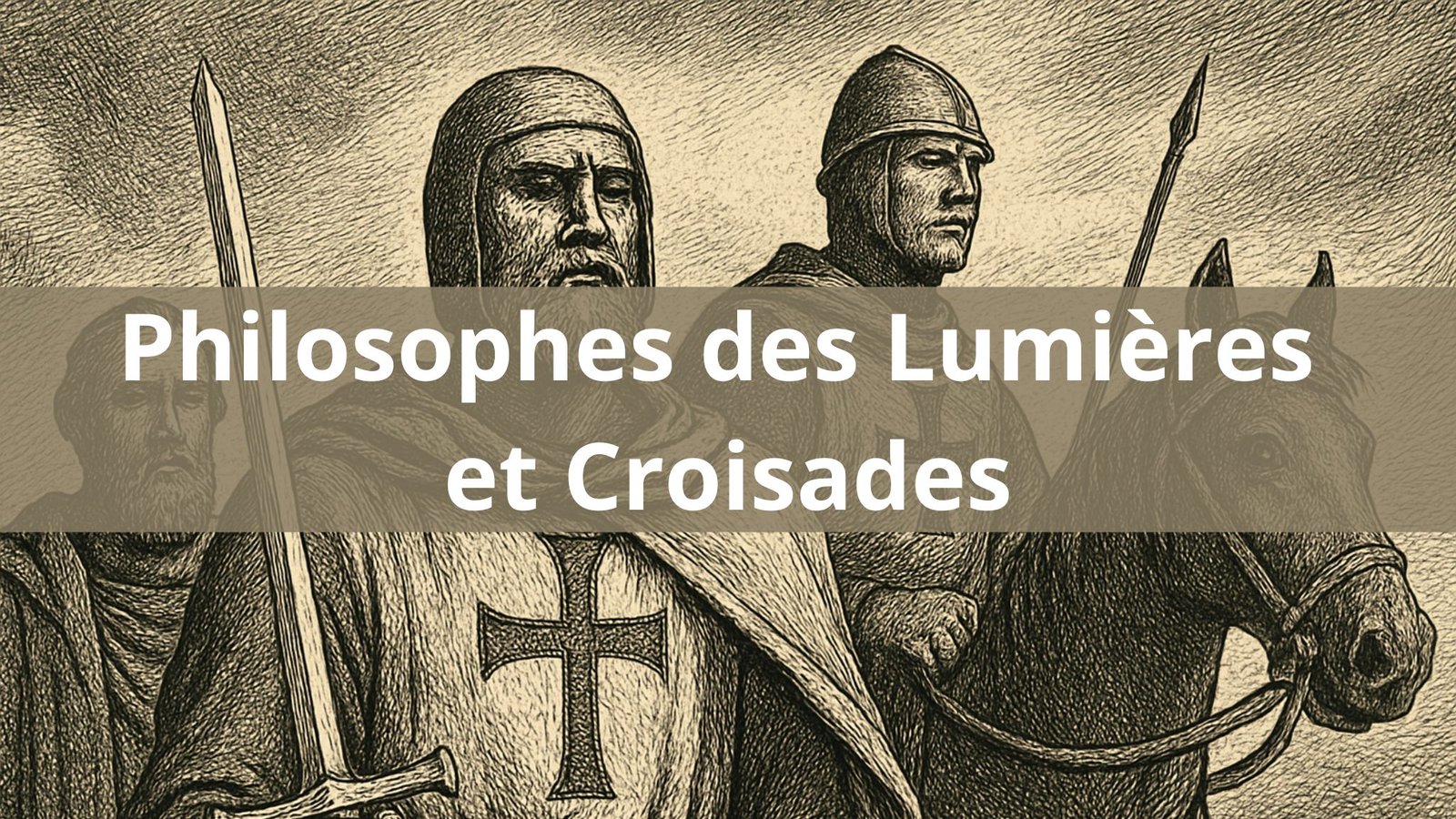Au XVIIIe siècle, les grandes figures de la pensée dite « des Lumières » ont profondément modifié la manière dont on regarde les croisades. À leurs yeux, ces expéditions n’étaient pas des actes de foi, mais des manifestations de fanatisme, de superstition et de violence religieuse.
Voltaire, Montesquieu, Diderot et d’autres ont ainsi contribué à forger une image très critique de ces événements médiévaux, en les plaçant au cœur de leur combat contre l’Église et le passé chrétien.
Cet article revient sur ce tournant intellectuel, examine les discours des philosophes, et montre comment leur lecture a influencé durablement l’histoire enseignée, jusqu’à brouiller aujourd’hui encore notre regard sur ce pan complexe du Moyen Âge.
Philosophes des Lumières et croisades : comprendre une réécriture historique
Ce résumé met en lumière la manière dont les penseurs des Lumières ont influencé la perception moderne des croisades, souvent en rupture avec les faits historiques établis par les chercheurs contemporains.
Pourquoi les penseurs des Lumières ont critiqué les croisades
1. Le contexte intellectuel du XVIIIe siècle : un rejet du passé chrétien
Au XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières, la manière dont on regarde le passé change radicalement. Pour beaucoup de philosophes de l’époque, la religion n’est plus une source d’autorité ni un cadre de pensée acceptable. Ce qui vient du Moyen Âge est suspect, parfois moqué, souvent rejeté. L’Église, en particulier, est perçue comme un frein au progrès, un pouvoir arbitraire qui a trop longtemps dominé la société.
Les croisades, dans ce contexte, deviennent un symbole commode. Elles concentrent tout ce que les penseurs des Lumières veulent dénoncer : le fanatisme, la violence religieuse, l’intolérance. Peu importe que ces expéditions aient eu des origines complexes ou des buts défensifs, ce n’est pas ce que l’époque cherche à entendre. Ce qui compte, c’est l’image qu’on en donne.
La figure du chevalier croisé, autrefois liée à l’idéal chrétien, est transformée en exemple d’aveuglement collectif. On y voit des foules poussées par des prêtres, des massacres commis au nom de Dieu, des peuples opprimés. Cette lecture devient dominante dans les cercles intellectuels et philosophiques.
Tout ce qui touche à la chrétienté médiévale est ramené à une logique d’irrationalité. On ne distingue plus l’élan spirituel sincère de certains croisés, ni les débats qui agitaient déjà le monde chrétien à l’époque. L’histoire est lue à travers une grille idéologique très marquée, où l’homme des Lumières s’oppose à l’homme du Moyen Âge.
2. Voltaire, Montesquieu, Diderot… : que disaient-ils vraiment ?
Voltaire, dans son Essai sur les mœurs, parle des croisades comme d’un délire collectif. Pour lui, ces expéditions n’ont rien de noble. Il y voit surtout des exemples de cruauté inutile, d’intolérance, de manipulation religieuse. Il raille les croyances, dénonce les violences, et traite les croisés de barbares ignorants. Ce ton sarcastique n’est pas un simple style : c’est un choix volontaire pour tourner en dérision ce que l’Église considérait jusque-là comme des actes de foi.
Montesquieu adopte une approche plus politique. Dans L’Esprit des lois, il n’écrit pas une critique directe des croisades, mais on sent que la vision du Moyen Âge comme un système déséquilibré, dominé par la féodalité et la superstition, traverse son raisonnement. Les croisades y apparaissent comme un produit de leur temps, déconnecté de toute logique rationnelle.
Diderot, de son côté, participe à la rédaction de l’Encyclopédie, où l’article « croisades » reprend ces idées. Le ton est volontiers ironique, parfois sec. L’ensemble du projet encyclopédique vise à combattre l’obscurantisme, et les croisades sont utilisées pour illustrer à quel point la religion, selon eux, a pu pervertir le jugement humain.
Ces auteurs veulent aussi, à travers les croisades, disqualifier une certaine vision du monde encore très présente à leur époque. Ils s’opposent à l’Église, mais aussi à la mémoire collective qu’elle a façonnée.
3. Une vision qui influencera durablement la mémoire historique
Ce regard posé par les Lumières ne va pas rester cantonné aux cercles philosophiques. Il va influencer durablement l’enseignement, la culture, les livres d’histoire, les récits populaires. Peu à peu, l’image des croisades change dans les esprits. Elles ne sont plus perçues comme des expéditions pieuses ou courageuses, mais comme les premiers exemples d’intolérance organisée à l’échelle d’un continent.
Le XIXe siècle, avec ses conflits idéologiques entre laïcité et cléricalisme, va reprendre cette grille de lecture. Certains historiens vont chercher à redresser cette image, mais l’idée d’un fanatisme chrétien responsable de violences injustifiées est déjà bien ancrée.
La simplification est parfois frappante. On ne parle plus de pèlerins, de débats théologiques, de diversité des acteurs. On ne retient que les massacres, les pillages, la conquête. Cette vision va se renforcer au fil du temps, au point de rendre difficile toute tentative de relecture plus équilibrée.
Les croisades de par les interprétations faites se situent souvent entre mythe et réalité, il est dès-lors important d’apporter un regard particulièrement critique sur cette période pour éviter l’amalgame et les erreurs populaires.
Peut-on encore parler des croisades sans héritage idéologique ?
1. Ce que disent les historiens
Depuis quelques décennies, les chercheurs qui travaillent sur les croisades ont repris les choses depuis le début. En se détachant des jugements modernes, ils essaient de comprendre ce que ces expéditions signifiaient pour les hommes et les femmes de l’époque. Et leurs conclusions sont souvent très éloignées des clichés du XVIIIe ou du XIXe siècle.
La première chose qui ressort, c’est que la plupart des croisés ne partaient pas pour conquérir des terres ou faire fortune. Ce qui les poussait, c’était surtout la foi. Le voyage vers Jérusalem était vu comme un pèlerinage difficile, un acte de pénitence, parfois même un sacrifice. Les sources de l’époque, très nombreuses, insistent sur cette dimension religieuse. On y lit les doutes, les espérances, les prières.
Les chercheurs soulignent aussi que la première croisade, en particulier, s’est construite comme une réponse à des appels à l’aide. Ce ne sont pas les chrétiens d’Occident qui ont attaqué en premier, mais les Byzantins qui ont demandé du soutien face aux armées turques. Dans ce contexte, l’objectif n’était pas d’envahir, mais de protéger ce qui était perçu comme menacé.
Les études récentes insistent sur la diversité des situations sur place. Il y a eu des combats, mais aussi des périodes de paix. Des traités signés entre croisés et chefs musulmans. Des échanges culturels, commerciaux, parfois même des alliances. Ce genre de complexité ne rentre pas dans un récit idéologique simple, et c’est justement ce que l’historiographie actuelle cherche à montrer.
2. Ce que l’héritage des Lumières empêche parfois de voir
Le problème, c’est que cette nouvelle lecture passe difficilement dans l’espace public. Beaucoup d’idées installées au XVIIIe siècle restent encore dans les mentalités. Dès qu’on parle de croisade, l’image d’un fanatique en armure revient immédiatement. On pense à des foules en délire, à des violences absurdes, à une foi aveugle. Ces images sont devenues des réflexes.
Cette grille de lecture laisse peu de place à la nuance. Elle bloque le regard sur ce que les acteurs médiévaux pensaient réellement. Elle fait aussi oublier les discussions qu’il y avait déjà à l’époque, y compris au sein de l’Église, sur la légitimité de ces expéditions, sur leurs limites, ou sur la manière de les mener.
Le terme même de « croisade » est devenu piégé. Il est souvent utilisé dans les discours politiques ou dans les médias comme une accusation. Il suffit de dire que quelqu’un mène « une croisade » pour le présenter comme intolérant ou dangereux. On ne pense plus à l’histoire, on pense à un symbole.
Ce blocage rend difficile un travail de compréhension honnête. Il empêche aussi parfois les dialogues, notamment entre cultures, car chacun arrive avec des représentations héritées, souvent déformées. Et dans ce climat, toute tentative d’explication historique est vite perçue comme une prise de position.
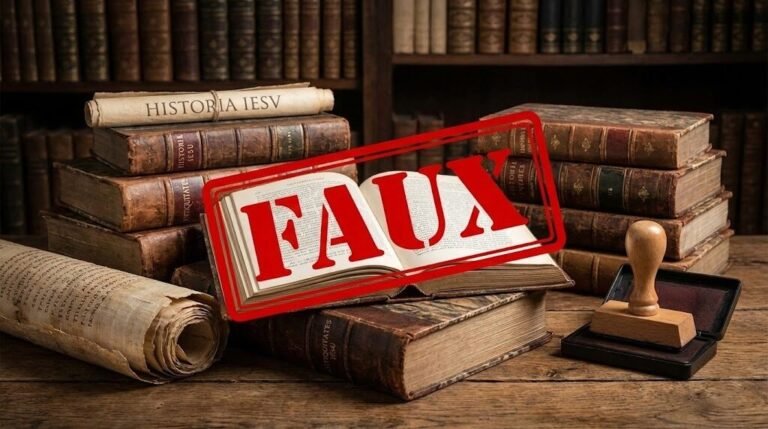
L’effet Lincoln : La thèse de Richard Carrier sur Jésus s’effondre
Pour aller plus loin : d’autres éclairages pour comprendre l’image des croisades
Si le sujet vous intéresse, plusieurs lectures en ligne permettent de prolonger cette réflexion sur la manière dont les croisades ont été perçues, racontées, et parfois déformées au fil des siècles.
Un très bon point de départ est l’article proposé par Histoire & Civilisations sur l’évolution de l’historiographie des croisades. Il permet de voir comment l’image des croisades a changé entre le Moyen Âge, l’époque moderne et notre temps, en s’appuyant sur les grands noms de la recherche historique, de René Grousset à Jean Flori.
Pour comprendre les tensions entre récit occidental et mémoire orientale, un article publié sur HAL-SHS s’intéresse à la manière dont les croisades ont été intégrées dans la conscience politique du monde arabe. On y voit comment la mémoire d’un conflit ancien peut rester vivante, en particulier quand elle est nourrie par des lectures modernes très idéologisées.
Le site Histoire pour Tous propose une synthèse bien faite sur la réalité des pèlerinages et des croisades, avec une attention particulière à ce que les sources médiévales disent réellement des motivations des croisés. Cette approche permet de mieux saisir ce que représentait, au XIIe siècle, le fait de « prendre la croix ».
Enfin, pour replacer tout cela dans un cadre plus large, l’article général de Wikipédia sur les croisades donne un aperçu utile des débats historiographiques actuels, des sources disponibles, et des multiples interprétations proposées selon les époques et les traditions.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.