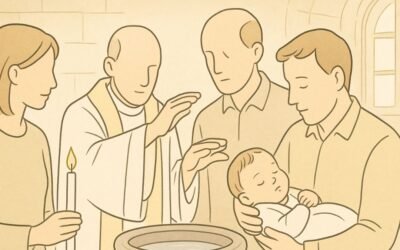La philosophie n’est pas née d’un coup, mais d’un glissement lent entre récits et raison. Dans un monde encore peuplé de dieux, certains hommes ont commencé à chercher des explications sans recourir au mythe. Ce geste, aussi simple que bouleversant, marque la naissance d’un nouveau regard sur le réel. Cet article retrace cette transition décisive, des premiers penseurs de la nature jusqu’à Socrate, en passant par Thalès, Héraclite, Parménide ou Démocrite. Ce n’est pas une histoire figée, mais une aventure de l’esprit, encore vivante, toujours inachevée.
Ce qu’il faut savoir sur les débuts de la philosophie : un condensé éclairant
Vous n’avez pas le temps de tout lire ? Voici les points essentiels pour comprendre comment la philosophie a vu le jour, qui étaient ses premiers penseurs, et pourquoi leurs questions résonnent encore aujourd’hui.
D’où vient l’idée même de philosopher ?
1. Pourquoi les humains ont-ils commencé à questionner le monde ?
Avant de chercher qui a été le premier philosophe, il faut se poser une question plus simple et plus ancienne encore : qu’est-ce qui fait qu’un jour, quelqu’un a eu envie de comprendre autrement ?
Imaginez : vous êtes un être humain il y a plusieurs milliers d’années. Le ciel change, la terre tremble, les saisons passent, des maladies apparaissent, et personne ne sait pourquoi. Pendant longtemps, on a répondu à ces mystères par des récits. Des mythes. Des histoires où les dieux sont responsables des vents, des éclairs, des famines.
Et puis un jour — ou plutôt peu à peu — quelqu’un commence à se demander si le monde ne pourrait pas s’expliquer autrement.
Non plus avec des dieux qui s’envolent, s’énervent ou se vengent. Mais avec des forces naturelles, visibles, constantes. Avec des causes qu’on pourrait peut-être observer, comparer, interroger.
C’est là que naît le geste philosophique. Pas avec une idée compliquée. Mais avec un doute, une question, une autre manière de voir.
2. Mythe, religion, observation : ce qui existait avant la philosophie
Il faut comprendre que la philosophie n’a pas “remplacé” la religion ou les mythes. Elle est née à côté d’eux, parfois contre eux, parfois grâce à eux. Les premiers textes grecs que nous connaissons — comme ceux d’Homère ou d’Hésiode — sont remplis de cosmogonies, c’est-à-dire de récits sur l’origine du monde.
Ces récits ne sont pas idiots. Ce sont des tentatives de compréhension, adaptées à ce qu’on savait à l’époque. Les Grecs n’avaient ni microscope, ni satellite, ni calcul formel. Mais ils avaient déjà ce besoin très humain de chercher un ordre derrière ce qui semble chaotique.
Quand la philosophie commence à apparaître, ce n’est donc pas dans un vide. C’est une nouvelle réponse à une vieille question : d’où venons-nous, et pourquoi le monde est-il comme il est ?
3. Quand la raison commence à remplacer les récits mythiques
Ce que les premiers philosophes font, c’est changer le langage qu’on utilise pour parler du monde. Ils ne racontent plus des histoires avec des dieux, des serpents, des géants. Ils posent des hypothèses.
Ils disent : “Et si tout venait de l’eau ?” (Thalès). Ou bien : “Et si c’était une matière infinie, indéfinie, qui se transforme tout le temps ?” (Anaximandre). Ce sont encore des idées très brutes, très naïves parfois. Mais ce sont des idées qu’on peut discuter, critiquer, compléter. Et c’est cela qui change tout.
Le passage du mythe au logos — c’est-à-dire à un discours logique, argumenté — marque le vrai début de la pensée philosophique. Et ce tournant, on le situe dans un petit coin du monde, sur les rives de la mer Égée, autour du VIe siècle avant notre ère. C’est là que, pour la première fois, quelqu’un s’est dit : “Et si je pouvais comprendre sans croire ?”
Y-a-t-il eu un “premier” philosophe ?
1. Pourquoi Thalès est souvent cité comme le tout premier
Dans la plupart des manuels ou des cours de philo, on commence par lui : Thalès de Milet. Et ce n’est pas par hasard. D’après Aristote lui-même, Thalès serait le premier à avoir cherché un principe unique à l’origine de toutes choses, sans s’appuyer sur des récits religieux.
Pour Thalès, ce principe fondamental, c’est l’eau. L’eau comme source de vie, comme matière première. Cela peut sembler enfantin aujourd’hui, mais à l’époque, penser que tout pouvait s’expliquer par une seule substance naturelle, c’était une vraie révolution.
Mais ce n’est pas tout. Thalès aurait aussi prédit une éclipse de soleil, conseillé des ingénieurs, réfléchi à la géométrie. Il incarne cette figure nouvelle d’un homme qui cherche à comprendre par lui-même, en observant le monde et en formulant des hypothèses. Ce n’est pas un prêtre, ce n’est pas un poète : c’est un penseur rationnel.
2. D’autres penseurs oubliés qui l’ont peut-être précédé
Mais peut-on vraiment être sûr que Thalès est “le premier” ? Pas totalement. Nous ne connaissons aucun texte de sa main. Tout ce que nous savons vient d’auteurs plus tardifs, en particulier Aristote, qui a vécu deux siècles après lui.
Et il se peut très bien que d’autres penseurs — moins connus, non grecs, ou tout simplement oubliés — aient commencé à réfléchir de manière similaire. Par exemple, certains chercheurs évoquent des influences venues d’Égypte, de Babylonie, ou d’Inde, où des formes de spéculation cosmique et logique existaient déjà.
On sait, par exemple, que les Grecs ont beaucoup voyagé et échangé avec d’autres cultures. Thalès lui-même aurait appris en Égypte certaines connaissances en géométrie. Alors peut-être faut-il voir en lui non pas un créateur, mais un passeur. Quelqu’un qui a synthétisé des influences pour proposer une pensée nouvelle.
3. L’invention grecque de la philosophie : un contexte très particulier
Ce qui est sûr, c’est que la philosophie — au sens où on l’entend aujourd’hui — naît dans un contexte bien précis : celui des cités grecques d’Asie mineure (comme Milet, Éphèse, Samos), entre le VIIe et le Ve siècle avant notre ère.
Ces cités sont commerçantes, ouvertes, souvent maritimes. On y échange des idées, des biens, des cultures. Elles sont aussi moins dominées par des religions centralisées ou des monarchies absolues. Il y a donc de l’espace pour penser autrement, pour contester, pour discuter.
C’est ce mélange — liberté politique relative, contact avec d’autres mondes, absence de dogme — qui rend possible cette “invention” de la philosophie. Pas en une nuit. Pas par un seul homme. Mais par une dynamique collective, qui commence avec Thalès, Anaximandre, Héraclite… et se prolonge jusqu’à Socrate, Platon et Aristote.
Qui sont les grands noms des débuts ? Et que pensaient-ils vraiment ?
1. Thalès de Milet : tout vient de l’eau
Thalès ne nous a laissé aucun écrit, mais sa réputation est immense. Ce qu’il propose, c’est simple et puissant : tout ce qui existe vient de l’eau. Non pas parce que l’eau serait magique, mais parce qu’elle est présente partout, transformable, vitale, et qu’elle semble être un point commun à toutes les formes de vie.
Il ne raconte pas une histoire de dieux, il ne moralise pas. Il observe, il déduit. C’est ce geste-là — chercher une explication rationnelle du monde — qui en fait un philosophe. Et ce qu’il amorce, c’est surtout une manière de penser par le naturel, pas par le sacré.
2. Anaximandre : l’idée vertigineuse de l’infini
Anaximandre, élève de Thalès, pousse le raisonnement plus loin. Pour lui, le principe de toute chose ne peut pas être un élément concret comme l’eau. Il doit être plus vaste, plus indéfini. Il l’appelle : l’apeiron, ce qui veut dire “l’illimité”, “l’indéfini”.
C’est une idée incroyablement audacieuse pour l’époque : le monde viendrait de quelque chose qui n’a pas de forme, pas de limite, pas de nom précis. Une sorte de chaos originel, mais ordonné. On peut presque y voir un ancêtre de nos idées modernes sur la matière noire, le vide quantique, ou les origines indéterminées de l’univers.
3. Anaximène : l’air comme souffle fondamental
Un peu oublié aujourd’hui, Anaximène propose une version plus concrète de l’apeiron : pour lui, c’est l’air qui est à l’origine de tout. L’air peut se condenser, se dilater, se transformer. Il devient eau, terre, feu. Il est invisible mais présent. Il fait le lien entre le vide et le plein.
Anaximène propose ici une vision dynamique du réel, où les choses se forment par degrés, par transitions. Ce n’est pas du mythe, ce n’est pas encore de la physique, mais c’est déjà une manière d’imaginer le monde comme un grand système cohérent.
4. Pythagore : quand tout devient nombre et harmonie
Avec Pythagore, on entre dans un autre monde : celui des formes, des proportions, des nombres. Pour lui, l’univers est une construction mathématique, et tout peut s’expliquer à travers l’harmonie des rapports numériques.
C’est une pensée presque mystique, mais aussi fondatrice pour la science. Pythagore croit que l’ordre du cosmos est lisible — à condition d’en connaître le langage : les mathématiques. Cela influencera Platon, Kepler, Galilée… et toute la physique moderne.
Mais Pythagore, c’est aussi une communauté, une éthique, une discipline de vie. Être philosophe, chez lui, ce n’est pas juste réfléchir. C’est vivre selon un ordre intérieur et cosmique.
5. Héraclite : rien ne dure, tout se transforme
Célèbre pour avoir dit : “On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve”, Héraclite est le penseur du mouvement, du changement, de la tension. Pour lui, tout ce qui vit, change. Tout ce qui existe est pris dans un flux, une lutte, une polarité.
Il parle souvent par aphorismes, comme un poète obscur. Il écrit que le feu est le principe de toutes choses — non pas le feu au sens strict, mais comme symbole du changement constant. Rien n’est fixe, tout est dynamique, même l’identité.
C’est une pensée exigeante, qui rejette les illusions de stabilité. Et pourtant, elle entre en résonance directe avec le monde moderne, fait de transformations rapides, d’équilibres fragiles, de tensions permanentes.
6. Parménide : rien ne change, tout est un
À l’opposé total d’Héraclite, Parménide affirme que le changement est une illusion. Ce que nous appelons le “devenir” ou la “multiplicité” n’est qu’apparence. La seule réalité, dit-il, c’est l’Être : immobile, éternel, unique. Tout ce qui naît ou disparaît n’a pas vraiment d’existence.
Il ne s’agit pas d’un délire mystique. Parménide part d’un raisonnement très rigoureux : si l’être est, le non-être ne peut pas être. Et donc, rien ne peut véritablement apparaître ou disparaître. Tout est. Point.
C’est une idée très abstraite, mais elle va profondément influencer la métaphysique occidentale, jusqu’à Heidegger, en passant par Platon et toute la scolastique médiévale.
7. Les premiers atomistes : Démocrite et l’idée d’un monde fait de particules
Moins connus du grand public, Leucippe et Démocrite vont proposer une idée qui ressemble étonnamment à nos conceptions actuelles de la matière : tout est fait d’atomes et de vide. Ces atomes sont indivisibles, éternels, en mouvement constant. C’est leur combinaison qui forme la réalité visible.
Ils rejettent l’idée d’un ordre divin ou finalisé. Pour eux, le monde n’a pas de but. Il existe par hasard, par collision, par nécessité mécanique. C’est une pensée très moderne, très radicale, presque matérialiste avant l’heure.
Ce que nous retenons de leurs idées
1. Leurs intuitions face au cosmos, à la nature, à l’être
Ce qui frappe quand on lit les fragments des premiers philosophes, c’est la force de leurs intuitions. À une époque où il n’y avait ni microscope ni satellite, ils s’interrogeaient déjà sur l’origine du monde, la matière, le mouvement, le temps.
Anaximandre parle d’un infini indéterminé à l’origine de tout ? Cela évoque presque le vide quantique. Héraclite voit dans le feu l’image du devenir constant ? Nous vivons dans un monde de flux, d’impermanence, de transitions climatiques et technologiques. Parménide défend une réalité unique, sans apparence ? Certains courants contemporains de la physique théorique, comme ceux autour de l’espace-temps ou de la structure du réel, posent des questions similaires.
Ces penseurs ne donnaient pas des “réponses”, au sens scientifique. Mais ils osaient poser des questions fondamentales, sans chercher refuge dans une autorité divine ou culturelle. Et cela, ça reste un modèle.
2. Ce qu’ils avaient compris… bien avant la science moderne
On a parfois l’impression que la philosophie ancienne serait dépassée, un peu poussiéreuse. Et pourtant, beaucoup d’idées qui fondent notre modernité sont déjà là, en germe.
L’idée que le monde est régi par des lois ? Elle vient des Ioniens, comme Thalès et Anaximandre. L’idée que les mathématiques peuvent expliquer le réel ? C’est Pythagore. L’idée que le changement est au cœur de l’univers ? C’est Héraclite. L’idée que les apparences sont trompeuses et qu’il faut chercher la structure sous-jacente du réel ? C’est Parménide et Démocrite.
On peut même dire que la science moderne n’est qu’une branche tardive de ce tronc philosophique, qui a d’abord été nourri de doutes, de raisonnements, de visions du monde.
3. Une pensée sans dogme, ouverte et audacieuse
Il faut aussi souligner leur liberté. Les présocratiques — qu’on appelle ainsi parce qu’ils précèdent Socrate — n’ont pas fondé d’école fermée. Ils ne prétendaient pas détenir une vérité absolue. Ils cherchaient. Ils expérimentaient par la pensée. Chacun proposait une vision du monde, parfois contradictoire avec celle des autres, sans qu’on les oblige à trancher.
Ce refus du dogme, cette confiance dans la pensée individuelle, c’est exactement ce que la philosophie peut encore offrir aujourd’hui. Un espace pour penser autrement. Pour mettre en question. Pour essayer, sans avoir forcément raison.
Ils n’avaient pas toutes les clés, mais ils ont ouvert toutes les portes.
Est-ce qu’on peut encore parler de philosophie sans parler de Socrate ?
1. Pourquoi Socrate change profondément la manière de philosopher
Avant Socrate, la majorité des philosophes s’intéressaient au monde, à la nature, à l’origine des choses. Avec lui, le centre de gravité bascule : ce n’est plus le cosmos qui est au cœur de la réflexion, mais l’être humain lui-même.
Socrate ne propose pas de théorie sur l’eau, l’air ou les atomes. Il ne cherche pas non plus à écrire des traités. Il pose des questions. Il interroge. Il dérange. Ce qu’il veut, ce n’est pas imposer une vision, mais pousser chacun à penser par lui-même, jusqu’au bout.
Il demande : Qu’est-ce que la justice ? Qu’est-ce que le bien ? Qu’est-ce que la vérité ? Et surtout : que veut-on dire quand on emploie ces mots ? Sa méthode, c’est celle du dialogue, de l’ironie, de la maïeutique — faire accoucher les esprits de ce qu’ils portent sans le savoir.
C’est une révolution intérieure : la philosophie ne devient pas seulement un discours sur le monde, mais un chemin de vie, un exercice de lucidité.
2. Ce que Platon et Aristote ont ensuite bâti à partir de ces premières bases
Socrate n’a rien écrit. Ce que nous savons de lui, nous le devons à ses disciples — en particulier Platon, qui a transformé ses dialogues en œuvre fondatrice. À travers ses textes, Platon invente la philosophie comme système, avec ses concepts, ses formes, ses visions de l’âme, de la cité, de la vérité.
Puis vient Aristote, qui reprend tout cela, mais avec un regard plus ancré, plus empirique, plus structuré. Il crée les premières grandes classifications de la pensée : logique, éthique, politique, physique, métaphysique. Il pose des définitions, des distinctions, des méthodes d’analyse.
Avec ces deux penseurs, la philosophie quitte les éclats des intuitions présocratiques pour devenir une discipline à part entière. Et pourtant, sans Thalès, Héraclite, Parménide, Démocrite… rien de cela n’aurait été possible.
3. La naissance d’un dialogue entre les idées, qui continue encore aujourd’hui
Ce qui s’invente à cette époque, c’est le dialogue dans le temps. Chaque philosophe ne pense pas à partir de rien : il répond à d’autres, il contredit, il reprend, il approfondit. La philosophie devient une conversation millénaire, où une question en appelle une autre, où les réponses sont toujours provisoires.
Quand on lit aujourd’hui un fragment de Parménide ou un aphorisme d’Héraclite, on peut y entendre des échos très contemporains. Parce que les questions qu’ils ont posées sont encore là : qu’est-ce qui change ? qu’est-ce qui demeure ? comment savoir ? que veut dire “être” ?
En ce sens, on ne peut pas séparer Socrate des présocratiques, ni Platon d’Anaximandre. Ils sont tous dans la même aventure, celle d’un questionnement humain qui n’a jamais cessé.
Foire aux questions sur les premiers philosophes
1. Pourquoi la philosophie a-t-elle émergé en Grèce, et pas ailleurs ?
Ce n’est pas que d’autres civilisations n’ont pas pensé. L’Égypte, l’Inde, la Chine ont produit des réflexions très profondes. Mais ce qu’on appelle “philosophie” dans son sens occidental — c’est-à-dire un questionnement rationnel, sans fondement religieux, qui cherche des principes universels — a pris forme pour la première fois en Grèce, autour du VIe siècle avant notre ère. Cela tient à plusieurs facteurs : la structure des cités, un certain rapport au langage, des échanges culturels très denses… et sans doute une part de hasard historique aussi.
2. Est-ce que les philosophes présocratiques ont influencé la science moderne ?
Oui, de manière indirecte mais réelle. Même si leurs idées étaient parfois erronées sur le fond, leur démarche consistait déjà à chercher des causes naturelles aux phénomènes. Ils ont été les premiers à penser que l’univers pouvait être compris par la raison, par des lois, par des principes. C’est exactement cette intuition qui est à la base de la méthode scientifique, même si elle s’est développée bien plus tard.
3. Peut-on encore lire les textes des présocratiques aujourd’hui ?
Pas vraiment sous forme complète. Ce qu’on a conservé d’eux, ce sont des fragments — parfois une phrase, parfois quelques lignes — souvent transmis par d’autres auteurs (comme Aristote ou Simplicius). Il faut donc les lire avec prudence, dans des éditions sérieuses, accompagnées de commentaires. Mais ces fragments, malgré leur brièveté, ont une force étonnante.
4. Les présocratiques étaient-ils tous d’accord entre eux ?
Pas du tout. C’est même l’un des traits fascinants de cette époque : chaque philosophe proposait une vision très différente du monde. Pour Thalès, tout vient de l’eau. Pour Anaximène, c’est l’air. Pour Héraclite, tout est changement ; pour Parménide, rien ne change. Il n’y avait pas encore de consensus, ni d’école unique. Chacun pensait librement, parfois en opposition frontale avec son prédécesseur. C’est cela aussi, la naissance de la philosophie.
5. Pourquoi les appelle-t-on “présocratiques” alors que certains ont vécu après Socrate ?
C’est une convention assez imparfaite, mais largement utilisée. Le terme “présocratique” ne désigne pas seulement une période chronologique, mais surtout une manière de penser : centrée sur la nature, l’origine du monde, les principes fondamentaux du réel. Même si certains, comme Démocrite, ont été contemporains ou postérieurs à Socrate, leur style de pensée reste ancré dans cette première phase de la philosophie, avant que l’homme et l’éthique deviennent le centre du questionnement.