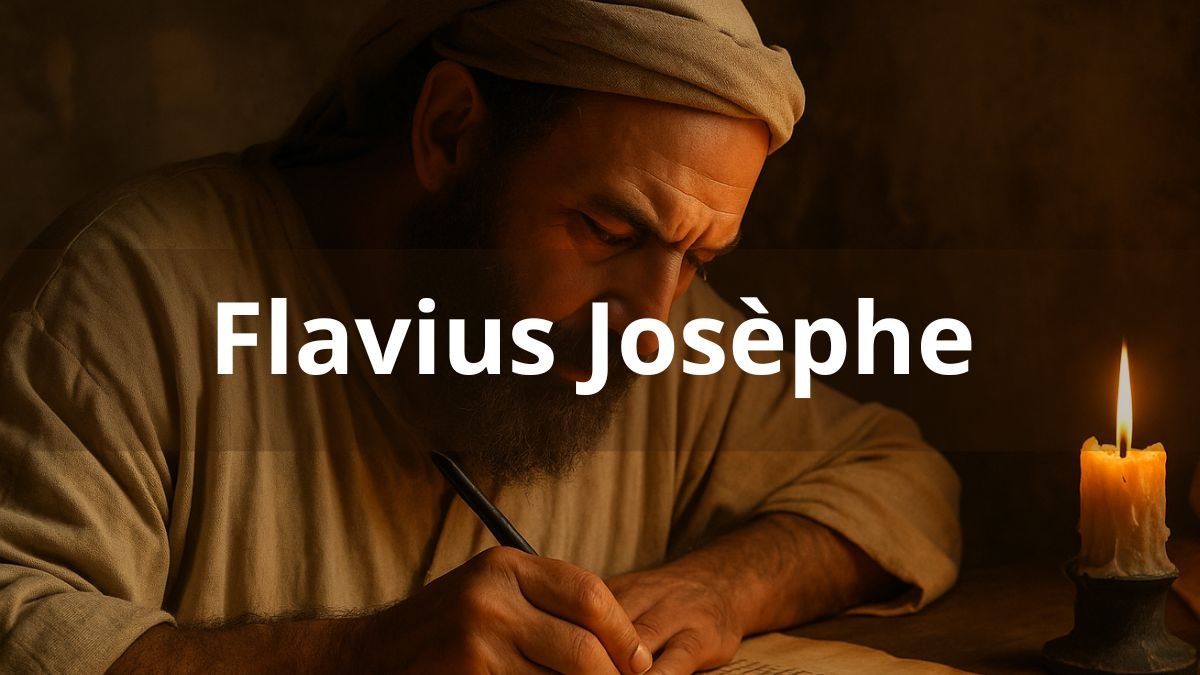Flavius Josèphe, historien juif du Ier siècle, offre un éclairage précieux sur la Judée romaine, la chute du Second Temple et les débuts du christianisme. À travers ses œuvres majeures, il devient une source incontournable pour comprendre les tensions religieuses, les conflits politiques et les figures fondatrices telles que Jésus, Jean-Baptiste et Jacques. Cet article explore son parcours, ses écrits et son rôle unique d’intermédiaire entre judaïsme, Empire romain et christianisme naissant.
Flavius Josèphe, un témoin crucial des origines du christianisme et de la judée romaine
À la croisée du judaïsme ancien, de l’Empire romain et de l’émergence du christianisme, Flavius Josèphe livre un témoignage historique unique, façonné par son parcours atypique et ses écrits majeurs.
La vie d’un historien entre Jérusalem et l’Empire romain
1. Origines sacerdotales et formation pharisienne
Flavius Josèphe naît à Jérusalem, vers 37 après J.-C., dans une famille appartenant à l’aristocratie sacerdotale. Par sa mère, il descend des Hasmonéens, dynastie royale issue des Maccabées. Son père est prêtre, membre de l’élite religieuse du Temple. Il grandit au cœur d’un judaïsme ritualisé, encore debout, mais traversé de tensions.
Dès l’adolescence, Josèphe s’intéresse aux courants religieux de son temps. Il observe les Pharisiens, les Sadducéens, et les Esséniens, vivant même quelque temps dans le désert avec un maître ascétique. Il choisit finalement d’adhérer à la doctrine pharisienne, qu’il juge la plus équilibrée.
Formé à la rhétorique grecque autant qu’à l’exégèse juive, il incarne une génération d’intellectuels tiraillés entre fierté religieuse et influence culturelle de Rome. Cette double compétence jouera un rôle décisif dans sa carrière.
2. Son rôle dans la première guerre juive contre Rome
Lorsque la guerre éclate en 66, entre les Juifs de Judée et l’Empire romain, Josèphe est envoyé comme commandant militaire en Galilée, à la tête de la résistance locale. Il organise la défense de plusieurs villes, notamment Jotapata, mais subit rapidement des revers.
Lors du siège de Jotapata, il est capturé par les troupes du général Vespasien. C’est un moment décisif. Plutôt que de résister jusqu’à la mort, il affirme, selon son propre récit, avoir eu une révélation prophétique : Vespasien deviendra empereur. Cette déclaration intrigue le commandant romain, qui choisit de le garder en vie.
Josèphe entre alors dans un statut ambigu : prisonnier protégé, intermédiaire cultivé, spectateur privilégié de la suite du conflit. Il assiste à la guerre depuis les camps romains, notamment lors du siège de Jérusalem en 70.
3. Capture, prophétie et ralliement à Vespasien
Lorsque Vespasien devient effectivement empereur, en 69, Josèphe est libéré et intégré dans sa maison impériale. Il adopte le nom de Flavius, en référence à la dynastie régnante, les Flaviens. Il obtient la citoyenneté romaine, un logement à Rome, et la possibilité d’écrire.
Cette transition, de chef rebelle à historien officiel, lui attire la suspicion des Juifs restés fidèles, mais aussi l’écoute des Romains. Il devient un témoin utile, à la fois pour raconter la guerre et pour expliquer le judaïsme à un public gréco-romain.
À partir de là, sa vie se déroule à Rome, dans un espace de relative sécurité, mais dans une position toujours fragile, entre intellectuel hébreu et protégé du pouvoir impérial.
De soldat juif à citoyen romain : un parcours controversé
1. Le passage au service de l’Empire
Après la guerre, Flavius Josèphe s’installe à Rome, sous la protection de l’empereur Vespasien, puis de ses successeurs Tite et Domitien. Il bénéficie d’un logement, d’une pension et d’un statut protégé, ce qui lui permet de se consacrer à l’écriture.
Il devient un auteur juif écrivant en grec pour un lectorat romain. Cette situation est inédite : aucun autre survivant de la révolte n’a accès à une telle visibilité. Mais ce privilège a un coût. Aux yeux de nombreux juifs, Josèphe est un traître, un renégat qui a retourné sa veste au moment le plus critique.
Dans ses ouvrages, il s’efforce de justifier son comportement. Il ne nie pas sa reddition, mais la présente comme une décision inspirée : s’opposer à Rome, selon lui, revenait à défier la volonté divine. En se ralliant à l’Empire, il aurait préservé la mémoire du peuple juif plutôt que de contribuer à sa ruine totale.
2. Le nom « Flavius » et la protection impériale
Le nom « Flavius » est une marque claire de son allégeance aux empereurs Flaviens. En l’adoptant, Josèphe s’inscrit dans une logique de filiation symbolique : il devient, par ce geste, une sorte de client intellectuel de la dynastie. Ce lien lui assure un accès à la cour, mais aussi des ennemis chez ceux qui voient en Rome une force d’oppression.
Ce double ancrage fait de lui un intermédiaire culturel. Il explique aux Romains ce qu’est le judaïsme, ses lois, son histoire, ses révoltes. Il tente aussi de corriger les malentendus fréquents, comme ceux propagés par des auteurs gréco-romains hostiles (Tacite, Apion…).
Sa position reste délicate : ni pleinement romain, ni prophète reconnu dans son propre peuple, ni converti, il occupe un espace limite, d’où il tire une œuvre unique mais ambiguë.
3. Une position ambivalente dans la mémoire juive
Pendant des siècles, Flavius Josèphe a été méprisé ou ignoré dans les cercles juifs traditionnels. Il était vu comme un instrument de l’Empire, celui qui avait assisté au siège de Jérusalem sans combattre, et qui avait même décrit la destruction du Temple à un public romain.
Ce n’est qu’à partir du Moyen Âge, et surtout à l’époque moderne, que certains lettrés juifs le relisent autrement : comme un témoin, un historien utile, capable de transmettre aux générations suivantes le récit de la catastrophe de 70.
Son œuvre a alors été traduite, étudiée, réinterprétée, non sans débat, mais avec une reconnaissance croissante de son importance historique. Il reste aujourd’hui une figure controversée, mais incontournable, dans le patrimoine juif comme dans l’historiographie du christianisme naissant.
Les grandes œuvres historiques de Flavius Josèphe
1. La Guerre des Juifs : récit d’un siège et d’une chute
Première grande œuvre de Flavius Josèphe, La Guerre des Juifs (Bellum Judaicum) est rédigée vers 75-79 après J.-C., en grec, avec l’objectif de relater la révolte juive de 66 à 70. Il s’appuie sur ses propres souvenirs, ses notes de campagne, et sur des documents officiels romains auxquels il a accès.
L’ouvrage couvre l’histoire du peuple juif depuis l’époque des Maccabées, mais se concentre sur la montée du conflit, les divisions internes, et surtout sur le siège de Jérusalem par Tite. Il décrit avec force les combats, la famine dans la ville assiégée, les massacres, la destruction du Temple.
Cette œuvre, tragique et détaillée, est une source inestimable sur le judaïsme du Second Temple, sur les différentes factions juives (Zélotes, Sicaires, Pharisiens), et sur la logique militaire romaine.
Elle a été lue comme une mise en garde, un plaidoyer pour la paix, mais aussi comme un acte de loyauté envers Rome, ce qui en a fait un texte longtemps suspect dans les milieux juifs.
2. Les Antiquités juives : une histoire biblique pour les Romains
Les Antiquités juives (Antiquitates Judaicae), rédigées vers 93-94, est l’œuvre la plus longue et ambitieuse de Josèphe. Elle retrace l’histoire du peuple juif depuis la création du monde jusqu’à la veille de la guerre contre Rome.
L’objectif est clair : faire comprendre aux lecteurs gréco-romains l’ancienneté, la sagesse et la cohérence de la tradition juive. Josèphe y paraphrase en grec les récits de la Genèse, de l’Exode, des Juges, des Rois, mais y ajoute aussi des éléments historiques extrabibliques.
L’ouvrage est à la fois une histoire religieuse et une œuvre d’apologétique politique. Il présente Moïse comme un législateur rationnel, les lois juives comme compatibles avec la raison, et les figures bibliques comme modèles de vertu.
Il s’adresse à un public lettré non-juif, mais il est aussi une tentative de rétablir la dignité du judaïsme dans un monde où il est souvent caricaturé ou accusé d’obscurantisme.
3. Contre Apion : défense de la tradition juive face aux accusations grecques
Dans Contre Apion, Josèphe adopte un ton polémique. Il répond aux accusations d’Apion d’Alexandrie, un écrivain grec qui avait ridiculisé les mœurs juives et accusé leur religion d’être archaïque et misanthrope.
Ce texte, bref mais dense, est une défense passionnée du judaïsme. Josèphe y revendique :
la profondeur morale de la Torah,
l’antiquité des traditions hébraïques,
la cohérence de la foi juive,
et la dignité d’un peuple souvent méconnu.
Il y exprime aussi une certaine fierté culturelle, rare dans ses autres œuvres. Il s’y montre plus libre, plus engagé, avec une parole moins soumise à la diplomatie romaine.
Que dit Josèphe de Jésus, Jean-Baptiste et Jacques ?
1. Le Testimonium Flavianum : une mention problématique de Jésus
Dans Les Antiquités juives (Livre XVIII, §63–64), Flavius Josèphe fait une brève mention de Jésus, connue sous le nom de Testimonium Flavianum. Ce passage a été largement débattu, car certaines phrases semblent trop chrétiennes pour un auteur juif du Ier siècle.
Voici le texte dans sa version la plus transmise (traduction usuelle) :
« Vers ce temps-là, parut Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l’appeler un homme. Car il accomplissait des choses prodigieuses, était maître des gens qui reçoivent avec plaisir la vérité. Il attira à lui beaucoup de Juifs, et aussi beaucoup de Grecs. Il était le Christ. Et, sur la dénonciation de nos chefs, Pilate l’avait condamné à la croix. Mais ceux qui l’avaient aimé dès le début ne cessèrent pas de l’aimer. Car il leur apparut vivant le troisième jour. […] »
La plupart des chercheurs considèrent aujourd’hui que le noyau du texte est authentique, mais que des ajouts chrétiens ont probablement été insérés au cours de la transmission. Certains manuscrits arabes ou syriaques proposent d’ailleurs des versions plus neutres, où Josèphe ne reconnaît pas Jésus comme le Messie, mais comme un homme marquant.
Ce passage, même discuté, est la plus ancienne référence non chrétienne à Jésus dans un texte historique.
2. Le rôle de Jean-Baptiste dans les Antiquités
Josèphe évoque également Jean-Baptiste, dans Antiquités juives, Livre XVIII, §116-119. Cette fois, le passage est considéré comme authentique et sans retouche.
« Hérode craignait que l’influence considérable que Jean exerçait sur le peuple ne provoquât une révolte. Il pensa qu’il valait mieux l’éliminer par précaution. Ainsi Jean fut envoyé à la forteresse de Machéronte et y fut exécuté. »
Josèphe ne relie pas Jean à Jésus. Il décrit un prédicateur charismatique, qui baptisait pour la purification morale, et qui inquiétait le pouvoir par l’afflux de ses disciples. Il confirme donc l’existence de Jean, son impact populaire, et sa mort sur ordre d’Hérode Antipas.
Ce témoignage indépendant est essentiel pour attester l’importance de Jean-Baptiste en Judée, même en dehors du cadre chrétien.
3. La mort de Jacques, frère de Jésus, selon Josèphe
Un autre passage, dans Antiquités juives Livre XX, §200, mentionne Jacques, appelé frère de Jésus, dit le Christ. Ce texte est largement considéré comme authentique et non interpolé.
« Anan, le grand prêtre, fit comparaître Jacques, frère de Jésus, qu’on appelait le Christ, et quelques autres. Il les accusa d’avoir transgressé la Loi, et les fit lapider. »
Il s’agit ici d’un épisode politique : profitant d’un vide de pouvoir à Jérusalem, le grand prêtre Anan procède à une exécution sans autorisation romaine, ce qui entraînera sa destitution.
Ce passage est important à deux titres :
– Il confirme l’existence historique d’un personnage appelé Jésus, surnommé le Christ.
– Il fait de Jacques une figure réelle du judaïsme de son temps, indépendante de la narration chrétienne.
Josèphe, sans être chrétien, mentionne ces figures avec neutralité, ce qui renforce leur poids historique pour les chercheurs.
Pourquoi Flavius Josèphe reste une source incontournable
1. Comprendre la Judée au Ier siècle
Aucun autre auteur n’a laissé une description aussi précise et étendue de la Judée à l’époque du Second Temple. Josèphe documente les structures religieuses, les groupes influents, les tensions internes, les rapports avec Rome, et surtout la destruction de Jérusalem en 70.
Ses écrits permettent de saisir le contexte dans lequel est né le christianisme, mais aussi de comprendre le judaïsme ancien dans toute sa diversité : entre loi, Temple, résistances et réformes.
Les évangiles racontent des événements religieux. Josèphe, lui, donne les noms, les dates, les fonctions, et une vision plus large du monde juif au moment où il entre dans une crise irréversible.
2. Un regard de l’intérieur sur les tensions religieuses
Josèphe a été acteur, témoin, puis analyste. Il a vu les divisions entre Sadducéens, Pharisiens, Zélotes, les rivalités entre les grands prêtres, les manipulations romaines, les fausses attentes messianiques, les révoltes locales, les calculs politiques des gouverneurs.
Il ne se contente pas de juger les faits : il analyse les raisons de l’effondrement, et dénonce surtout la violence fratricide, qu’il considère plus grave encore que la conquête étrangère.
Sa lecture de l’histoire juive mêle mémoire spirituelle et vision pragmatique du pouvoir, ce qui en fait un interprète unique de la transition entre judaïsme ancien et judaïsme post-temple.
3. Une passerelle historique entre judaïsme, christianisme et Rome
Josèphe est lu par les juifs, analysé par les chrétiens, consulté par les historiens romains. Sa position marginale lui donne une portée exceptionnelle. Il appartient à toutes les histoires à la fois, sans être capturé par aucune.
Les chrétiens, dès l’Antiquité, ont utilisé ses écrits pour confirmer les figures évangéliques. Les juifs modernes l’ont relu pour comprendre les causes de la catastrophe. Les historiens l’ont convoqué comme source-clé sur le Proche-Orient romain.
Sa voix, même controversée, n’a pas d’équivalent. Elle reste indispensable pour quiconque cherche à relier les textes religieux à l’histoire concrète.
Passages essentiels tirés des écrits de Flavius Josèphe
1. Sur la destruction du Temple de Jérusalem (La Guerre des Juifs, VI, 271–273)
« On eût dit que le Temple brûlait de lui-même, sans qu’on l’eût allumé. Un soldat, sans en avoir reçu l’ordre, lança une torche dans une fenêtre dorée ; en un instant, le feu embrasa le sanctuaire. Titus accourut, ordonnant qu’on l’éteigne, mais ses cris furent couverts par le tumulte. Le Temple était déjà perdu. »
Ce passage est le témoignage le plus célèbre sur la fin du Second Temple, en l’an 70. Josèphe y exprime l’idée que la destruction échappa à tout contrôle humain, y compris celui de Tite, le général romain. Le Temple, pour lui, brûle par fatalité, non par calcul.
2. Sur la mission de Jean-Baptiste (Antiquités juives, XVIII, 117)
« Jean, surnommé Baptiste, était un homme bon, qui incitait les Juifs à pratiquer la vertu, à exercer la justice les uns envers les autres, et à venir se faire baptiser dans le Jourdain. Il disait que l’immersion ne devait être pratiquée qu’une fois le cœur purifié. »
Josèphe confirme ici l’existence de Jean-Baptiste, ainsi que le sens moral de son message. Il insiste sur la valeur éthique du baptême, plus que sur un symbolisme religieux. Ce texte est souvent cité comme preuve indépendante de la présence de Jean à cette époque.
3. Sur Jésus, dit le Christ (Antiquités juives, XVIII, 63–64)
« En ce temps-là vécut Jésus, un homme sage, si tant est qu’on puisse l’appeler un homme. Il accomplissait des œuvres étonnantes, était maître de ceux qui reçoivent la vérité avec joie. […] Sur la dénonciation de nos chefs, Pilate le fit crucifier. Ceux qui l’avaient aimé ne cessèrent de le suivre. Il leur apparut trois jours après sa mort, vivant. »
Ce passage, connu comme le Testimonium Flavianum, est la première mention extra-biblique de Jésus. Il fait débat pour ses ajouts supposés chrétiens. Néanmoins, même épuré, il constitue un repère historique essentiel dans les études sur Jésus de Nazareth.
4. Sur la mort de Jacques, frère de Jésus (Antiquités juives, XX, 200)
« Anan, devenu grand prêtre, réunit le Sanhédrin et fit comparaître Jacques, frère de Jésus, que l’on appelait le Christ. Il les accusa d’avoir enfreint la Loi et les fit lapider. »
Ce passage atteste l’existence d’un groupe de disciples liés à Jésus, encore actifs après sa mort, et désigne Jacques comme une figure importante dans la communauté juive. Il offre une preuve indépendante de la persécution exercée par les autorités religieuses.
5. Sur les causes de la guerre juive (La Guerre des Juifs, Préface, 4)
« Ce ne furent pas les Romains, mais la folie des hommes de notre nation, qui fut la cause de la ruine de Jérusalem. Aucun malheur ne fut plus grand, mais aucun peuple ne l’a plus attiré sur lui-même. »
Josèphe exprime ici sa lecture morale de l’histoire. Il rend les Zélotes et extrémistes juifs responsables de la catastrophe, non Rome. Cette position explique en partie son rejet par les milieux juifs traditionnels, mais souligne aussi son souci d’analyse interne des échecs.

L’odeur du soufre et du sang : les 10 remèdes les plus toxiques de l’histoire
Questions fréquentes sur Flavius Josèphe
1. Flavius Josèphe est-il une source fiable sur Jésus ?
Il est le premier auteur non chrétien à mentionner Jésus. Le Testimonium Flavianum, bien que partiellement modifié par la tradition chrétienne, contient un noyau historiquement crédible selon la majorité des chercheurs.
2. Quelle est l’importance de Josèphe pour comprendre la destruction du Temple en 70 ?
Josèphe est le seul témoin oculaire à avoir laissé un récit complet du siège de Jérusalem et de la destruction du Second Temple. Son œuvre La Guerre des Juifs est une source historique majeure sur cet événement.
3. Quelle était la religion de Flavius Josèphe ?
Il est resté juif, attaché à la Loi de Moïse et à l’histoire d’Israël. Bien qu’ayant vécu sous protection romaine, rien n’indique qu’il se soit converti au paganisme ni au christianisme.
4. Pourquoi Flavius Josèphe est-il controversé ?
Parce qu’il a collaboré avec les Romains après sa capture, ce qui lui a valu d’être perçu comme traître par certains Juifs. Il est aussi critiqué pour sa vision favorable à l’ordre impérial.
5. Que contient l’œuvre Contre Apion ?
C’est une défense du judaïsme contre les calomnies de penseurs grecs, notamment Apion. Josèphe y vante l’ancienneté, la rationalité et la moralité de la religion juive, face aux stéréotypes hostiles.
6. Où Flavius Josèphe a-t-il terminé sa vie ?
Il a vécu à Rome, sous la protection des empereurs Vespasien, Titus et Domitien. Il y meurt probablement vers 100 après J.-C., dans un contexte paisible, mais en marge de sa communauté d’origine.
7. Quelle est la langue des écrits de Josèphe ?
Ses œuvres ont été écrites en grec, parfois avec des sources araméennes ou hébraïques à l’origine. Il visait un public hellénisé, cultivé, souvent non juif.
8. Quelle place occupe Josèphe dans l’histoire du judaïsme ?
Longtemps ignoré ou rejeté, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des rares témoins directs de la Judée du Ier siècle. Son travail est essentiel pour comprendre le contexte du Talmud, du christianisme et de l’occupation romaine.
9. Quelle est la meilleure édition en français des œuvres de Josèphe ?
Les éditions Cerf, Robert Laffont (Bouquins), ou la collection de La Pléiade proposent des traductions annotées de référence. Elles permettent d’aborder Josèphe dans un cadre historique sérieux.
10. Pourquoi les historiens lisent-ils encore Flavius Josèphe aujourd’hui ?
Parce qu’il est la principale source historique du judaïsme du Ier siècle, une période où se croisent Rome, Jérusalem et les origines du christianisme. Il reste indispensable pour toute recherche sur cette époque.