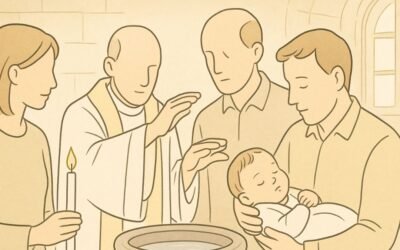Le mal n’est pas une idée lointaine, ni un concept réservé aux livres. C’est une réalité qui traverse la vie humaine, parfois comme un fracas, parfois comme un murmure qui ronge. Il blesse, divise, détruit ce qu’il y a de plus beau. Et pourtant, la foi chrétienne ose l’affronter. Non pas pour l’expliquer, mais pour s’y tenir debout. Dans ce chemin, la Bible ne propose pas une théorie, mais un récit, une histoire habitée. Elle montre un Dieu qui ne détourne pas le regard, qui ne reste pas à distance, mais qui rejoint l’humanité jusque dans ses ténèbres. Ce texte vous invite à parcourir les grandes lignes de cette compréhension théologique du mal : sa source, ses formes, et ce que la foi peut encore dire, là où les mots semblent parfois s’effondrer.
Résumé clair : les grandes clés pour penser le mal dans la foi chrétienne
Le mal interroge, bouleverse, et revient sans cesse dans l’histoire humaine. Ce résumé propose les idées essentielles de l’article pour mieux comprendre ce que le christianisme en dit.
Pourquoi cette question revient toujours, génération après génération
On ne peut pas vraiment l’éviter. À un moment ou un autre, cette question du mal surgit. Parfois de façon brutale, après un drame personnel. Parfois plus en douceur, au détour d’une réflexion sur l’injustice ou la souffrance du monde. Pourquoi le mal existe-t-il ? Pourquoi certains vivent l’horreur pendant que d’autres semblent épargnés ? Et surtout : comment croire en Dieu, ou lui parler, face à tout cela ?
Ce n’est pas une question réservée aux philosophes ou aux théologiens. C’est une question de vie. Elle traverse les deuils, les douleurs, les colères, les révoltes silencieuses. Elle vient quand on perd un proche, quand on voit la guerre frapper des innocents, quand on se heurte à une maladie injuste. Elle revient aussi dans des moments plus discrets : quand on culpabilise, quand on en veut à Dieu ou au destin, quand on cherche du sens là où il semble ne plus y en avoir.
La question du mal est universelle. Ce qui change, c’est la manière dont on y répond, selon sa culture, sa foi, ses blessures, son histoire.
Dans la tradition chrétienne, elle a donné lieu à des réflexions d’une profondeur bouleversante. Pas pour effacer le scandale du mal, mais pour chercher à y faire face. Non pas en trouvant « une explication », mais en cherchant comment tenir debout malgré tout. Comment continuer à croire, à espérer, à aimer, dans un monde qui peut faire mal.
C’est à ce chemin-là que l’article vous invite : pas une démonstration abstraite, mais une traversée. Avec la foi comme compagne, parfois comme question elle-même. Et toujours, cette conviction discrète mais tenace : même dans la nuit, il peut y avoir une lumière.
Est-ce que le mal vient de Dieu ? Une question qui secoue la foi
Quand on parle du mal, la première tentation, c’est souvent de regarder vers le ciel. Comme pour demander des comptes. Et c’est humain. Parce que si Dieu existe, s’Il est vraiment bon, s’Il est vraiment tout-puissant… alors pourquoi ne fait-Il rien ? Pourquoi laisse-t-Il certaines personnes souffrir autant, sans prévenir, sans raison apparente ?
Ce n’est pas une révolte d’athée. C’est une question que se posent beaucoup de croyants. Et souvent, c’est dans la douleur qu’elle surgit : après une injustice qu’on n’arrive pas à digérer, après une perte qui nous arrache le cœur. On croit, on prie, mais on ne comprend pas. Et cette incompréhension peut devenir un vertige.
Faut-il croire que Dieu permet le mal ? Qu’Il l’utilise ? Qu’Il le veut ?
Dans la foi chrétienne, ce n’est pas si simple. Non, Dieu ne veut pas le mal. Il n’en est pas la source. Il ne l’a pas “inventé” pour punir ou pour faire peur. Le mal, c’est ce qui blesse, ce qui détruit, ce qui sépare. Et Dieu, dans la Bible, est présenté comme celui qui guérit, qui relève, qui rassemble. Il est du côté de la vie, pas du chaos.
Mais alors, pourquoi ne l’empêche-t-Il pas ? C’est là que la question se complique. Beaucoup de croyants répondent : parce qu’Il nous laisse libres. Parce que l’amour, pour être vrai, doit être libre. Et qu’une liberté réelle implique la possibilité de faire le mal — ou d’en subir les conséquences dans un monde où d’autres peuvent faire le mal.
Cela n’enlève rien à la douleur. Mais ça ouvre une piste : et si Dieu n’était pas absent dans le mal, mais présent d’une autre manière ? Pas comme celui qui contrôle tout, mais comme celui qui accompagne. Qui souffre avec. Qui, au lieu de supprimer la douleur par magie, choisit de marcher avec ceux qui la vivent.
C’est une réponse qui ne rassure pas toujours, mais qui permet parfois de ne pas sombrer. De tenir debout, même quand le sol se dérobe.
Le regard biblique sur le mal : entre récit fondateur et éclairage spirituel
Pour comprendre ce que la foi chrétienne dit du mal, on peut commencer par là où elle commence : la Bible. Non pas comme un manuel explicatif, mais comme un miroir de l’expérience humaine. Dans les premiers chapitres de la Genèse, ce n’est pas un traité de métaphysique qu’on trouve, mais une histoire. Celle d’Adam, d’Ève, d’un jardin, d’un fruit défendu, et d’un choix.
Ce choix, c’est celui de désobéir. De vouloir “être comme des dieux”, de prendre la place du Créateur. Et c’est ce qui introduit le mal dans le récit : pas une force mystérieuse tombée du ciel, mais une rupture, un détournement de la liberté. L’humanité, dans cette lecture, est faite pour le bien, mais elle peut s’en détourner. Elle est libre — et donc fragile.
Ce qui est frappant dans ce récit, c’est qu’il ne cherche pas à excuser, ni à accuser trop vite. Il montre une chaîne : une parole qui séduit (le serpent), un désir qui trouble, un acte qui fracture. Et très vite, les conséquences apparaissent : la honte, la peur, la séparation. Le mal n’est pas seulement une faute morale. Il est ce qui coupe, ce qui abîme les relations : avec Dieu, avec soi-même, avec les autres.
Et puis il y a cette autre figure, plus sombre, plus complexe : Satan. Le “diviseur”. L’adversaire. Dans certains passages bibliques, il est présenté comme celui qui tente, qui pousse à douter, à accuser. Là encore, on ne parle pas d’un monstre baroque, mais d’un symbole très fort : celui de tout ce qui déforme, détourne, détruit ce qui est bon.
Mais la Bible n’en reste pas là. Elle raconte aussi une promesse. Celle d’un chemin de retour, d’un relèvement. D’un Dieu qui ne se retire pas après la chute, mais qui cherche encore l’homme, qui pose une question bouleversante : « Où es-tu ? » C’est peut-être la plus belle réponse au mal : cette voix qui ne condamne pas d’abord, mais qui cherche, qui appelle.
Dans cette lumière, la Bible ne dit pas que le mal est facile à comprendre. Elle montre plutôt comment il agit, comment il séduit, comment il enferme. Et surtout, elle montre qu’il n’a pas le dernier mot.
Le libre arbitre : pourquoi la liberté humaine change tout
Dans beaucoup d’explications chrétiennes sur le mal, un mot revient souvent : liberté. Et plus précisément, le libre arbitre. Ce pouvoir que chacun a — ou aurait — de choisir. De dire oui ou non. D’aimer ou de rejeter. De construire ou de blesser.
C’est une idée forte. Parce qu’elle dit quelque chose de très profond : Dieu n’a pas créé des marionnettes. Il n’a pas voulu des êtres programmés pour bien faire, mais des êtres capables d’aimer librement. Et pour cela, il faut un vrai choix. Sinon, ce n’est plus de l’amour, c’est de l’automatisme.
Mais la liberté est une lame à double tranchant. Elle permet la tendresse, la justice, le pardon… mais aussi la haine, la violence, l’égoïsme. Et c’est là que le mal entre. Pas comme une volonté divine, mais comme une possibilité liée à notre propre liberté. Si nous pouvons faire le bien, alors nous pouvons aussi faire le mal.
Ce raisonnement peut sembler théorique — surtout quand on parle d’un tsunami, d’un cancer ou d’un accident injuste. Ce mal-là ne vient pas d’une décision humaine. Et pourtant, même là, la question du libre arbitre reste présente, indirectement. Parce que certains choix, parfois collectifs, peuvent aggraver les souffrances : des politiques injustes, des négligences, des refus d’agir.
Le libre arbitre ne “justifie” pas le mal. Mais il aide à comprendre pourquoi Dieu ne l’annule pas automatiquement. Parce qu’annuler toute possibilité de mal reviendrait à supprimer aussi la possibilité d’un amour vrai, d’une responsabilité, d’un lien libre.
C’est un pari risqué, celui de la liberté. Dieu aurait pu choisir un monde sans douleurs… mais aussi sans relations profondes. Il a choisi un monde où chacun peut, à sa manière, participer à l’histoire. Par ses choix, ses actes, ses silences aussi. Et c’est peut-être là que réside une partie de notre dignité : dans cette liberté qui peut faire mal, mais qui rend aussi possible ce qu’il y a de plus beau. Si vous désirez approfondir la question du libre arbitre, je vous suggère de lire notre article « le libre arbitre sous la loupe ».
Jésus face au mal : non pas une explication, mais une réponse
Dans toute la Bible, il n’y a pas de chapitre où Dieu se mettrait à expliquer rationnellement le mal. Il n’y a pas non plus de discours théorique pour résoudre la douleur humaine comme on résoudrait une équation. À la place, il y a une histoire. Celle d’un homme cloué sur une croix. Et pour les chrétiens, c’est là que Dieu parle vraiment du mal — pas avec des mots, mais avec sa propre chair.
Jésus ne se tient pas à distance du mal. Il ne le commente pas de loin, comme un philosophe. Il le traverse. Il est trahi, abandonné, torturé, exécuté. Et pas parce qu’il l’aurait mérité. Mais justement parce qu’il a aimé, jusqu’au bout, jusqu’à déranger l’ordre établi. Dans cette souffrance injuste, le mal se dévoile dans toute sa brutalité. Mais aussi — et c’est le mystère — dans toute sa défaite.
Parce que le message chrétien ne s’arrête pas au vendredi de la crucifixion. Il passe par le silence du samedi, puis par la lumière du dimanche. Ce que beaucoup de croyants appellent la résurrection. Cela ne nie pas la croix. Cela ne fait pas comme si le mal n’avait jamais existé. Mais cela ouvre une brèche : la possibilité que même ce qui semble perdu, brisé, écrasé… puisse être relevé.
Ce que Jésus offre face au mal, ce n’est pas une réponse intellectuelle. C’est une présence. Une proximité. Un compagnonnage dans la douleur. Et pour ceux qui croient, une promesse : celle que le mal n’aura pas le dernier mot. Que l’amour peut se tenir debout même dans l’ombre la plus noire. Et qu’il existe un sens, non pas à toutes les souffrances, mais au fait de continuer à aimer, à croire, à avancer malgré elles.
Cette manière d’aborder le mal n’enlève pas toutes les questions. Mais elle en transforme le poids. Elle ne dit pas pourquoi le mal arrive. Elle dit que, quand il arrive, Dieu n’est pas loin. Il est là, dans les larmes, dans les mains qui soignent, dans les silences partagés. Et c’est peut-être ça, la vraie réponse.
Les formes modernes du mal : ce que les temps actuels nous obligent à voir autrement
Quand on parle du mal, on pense souvent à des choses anciennes : la guerre, le meurtre, la trahison. Mais aujourd’hui, les formes que prend le mal ont évolué. Ou plutôt, elles se sont multipliées, complexifiées, parfois dissimulées sous des apparences anodines. Et cela oblige à une nouvelle lucidité.
Il y a bien sûr le mal visible : les conflits, les massacres, les violences. Mais il y a aussi un mal plus diffus, plus silencieux : l’indifférence, l’exploitation lente, les choix collectifs qui nuisent sans qu’un seul coupable soit pointé du doigt. Un système économique qui écrase les plus fragiles, une pollution qui détruit des vies à petit feu, des inégalités qui enferment des générations entières dans l’absence d’avenir.
Ce sont des formes de mal plus complexes à nommer. Parce qu’il ne s’agit pas d’une seule personne qui agit mal, mais d’un enchaînement de décisions, d’intérêts croisés, de lâchetés répétées. Ce mal systémique, invisible parfois, devient d’autant plus difficile à combattre qu’il semble “normal”.
Et puis il y a les nouvelles technologies, qui soulèvent des enjeux inédits. Quand des algorithmes décident qui aura un prêt, qui sera surveillé, qui sera “pertinent” ou non dans une recherche d’emploi, sans que personne ne comprenne vraiment comment cela fonctionne, est-ce encore un monde juste ? Quand des fake news manipulent les esprits, quand des réseaux propagent la haine ou l’humiliation, où commence la responsabilité ? Où finit le choix libre ?
Face à cela, la théologie chrétienne n’apporte pas une solution technique. Mais elle pose une question simple, dérangeante : à quoi suis-je appelé, moi, ici et maintenant, face à ce mal-là ? Elle rappelle que le mal n’est pas seulement un concept lointain, mais une réalité à laquelle on participe — parfois sans s’en rendre compte — ou contre laquelle on peut résister.
Il ne suffit plus de dire “le monde va mal”. Il faut oser dire : “Et moi, où suis-je dans ce monde ? Qu’est-ce que je laisse faire ? Qu’est-ce que je refuse, même discrètement ?” Le mal moderne n’est pas moins réel que le mal ancien. Il est juste plus difficile à regarder en face. Et c’est pour cela qu’il est urgent de le penser autrement.
Et maintenant ? Foi, résistance et espérance dans un monde brisé
Une fois qu’on a reconnu le mal, qu’on a tenté de le penser, de le nommer… que faire ? Car rester dans la sidération ne suffit pas. Et vivre avec le mal sous les yeux sans se durcir ou se résigner demande une force intérieure que seule une foi vivante peut parfois nourrir.
La foi chrétienne, dans sa tradition la plus profonde, n’a jamais nié la souffrance. Mais elle a toujours affirmé qu’elle pouvait être traversée, accompagnée, parfois transformée. Pas effacée. Pas rendue “acceptable”. Mais tenue, portée, traversée. Et cela change tout.
Résister au mal, ce n’est pas devenir un héros. C’est commencer, souvent dans l’ombre, par ne pas collaborer à l’injuste. Par ne pas céder à la facilité de l’indifférence. Par soigner une blessure au lieu de détourner les yeux. Par pardonner, là où tout pousse à se venger. Par poser un acte simple, qui répare.
Et l’espérance ? Elle n’est pas naïveté. Elle n’est pas une manière de croire que tout finira bien à coup sûr. C’est plutôt une manière de se tenir debout même quand rien ne garantit l’issue. De croire que le bien, même petit, même invisible, a un poids. Et qu’il ne se perd jamais tout à fait.
Dans les Évangiles, Jésus ne donne pas une théorie du mal. Il guérit, il pleure, il écoute, il se tient près. Il vit. Et il aime. Jusqu’au bout. C’est là que l’espérance chrétienne puise sa source : dans une présence, non pas dans une explication. Dans une lumière, non pas dans une fuite. Dans une promesse, non pas dans une solution.
Ce n’est pas une réponse facile. Mais c’est une réponse habitée. Celle de millions de personnes, hier et aujourd’hui, qui ont choisi de répondre au mal par une vie donnée, par un geste de bonté, par un refus têtu de haïr. Et ce choix-là, même s’il est discret, même s’il ne fait pas la une, est peut-être le vrai miracle.
FAQ : Questions qu’on se pose souvent sur le mal… mais qu’on n’ose pas toujours formuler
1. Est-ce que Dieu souffre quand on souffre ?
C’est une question que posent beaucoup de croyants, surtout dans la détresse. Dans la tradition chrétienne, la réponse est oui. Jésus pleure dans l’Évangile, il tremble à Gethsémani, il crie sur la croix. Dieu n’est pas indifférent à la souffrance humaine : en Jésus, il l’a même partagée de l’intérieur. On ne croit pas en un Dieu froid ou lointain, mais en un Dieu vulnérable, touché dans sa chair par le mal. Cette image change tout dans la prière et dans la relation au divin.
2. Pourquoi Dieu ne supprime-t-il pas tout simplement le mal ?
C’est une des grandes interrogations spirituelles. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne pas intervenir ? Une des réponses classiques est celle du respect de la liberté : si Dieu supprimait tout mal, il supprimerait aussi toute liberté réelle. Ce serait un monde sans choix, donc sans amour véritable. Mais cette explication ne suffit pas toujours, surtout face à la souffrance des innocents. C’est là que la foi chrétienne parle non d’un Dieu qui empêche, mais d’un Dieu qui accompagne, qui soutient, et qui promet une rédemption, même si elle reste encore invisible.
3. Est-ce qu’il y a des souffrances qui n’ont aucun sens ?
Oui. Et il faut oser le dire. Tout ne trouve pas de justification. Certaines souffrances ne sont pas “utiles”, elles ne “servent” à rien. Les justifier à tout prix, c’est risquer d’être violent envers ceux qui les vivent. Le christianisme ne dit pas que toute douleur a une cause compréhensible. Il dit seulement qu’aucune n’échappe à l’amour de Dieu. Et que, même dans l’absurde, il est possible d’être rejoint, consolé, aimé. Pas compris. Aimé.
4. Peut-on croire en Dieu après une tragédie ?
Beaucoup de personnes perdent la foi après un deuil, une catastrophe, une injustice. Et c’est normal. Le choc peut faire vaciller toutes les certitudes. Mais d’autres, au contraire, découvrent Dieu dans l’épreuve : pas comme une réponse, mais comme une présence. Croire après une tragédie, ce n’est pas dire que tout est logique ou voulu. C’est dire : “Je ne comprends pas, mais je ne suis pas seul.” Ce n’est pas une foi qui explique. C’est une foi qui tient, malgré tout.
5. Comment aider quelqu’un qui perd la foi à cause du mal ?
Certainement pas en lui répondant trop vite. Ni avec des phrases toutes faites. Ce dont une personne blessée a besoin, ce n’est pas d’un raisonnement, c’est d’une écoute. D’une présence vraie, silencieuse parfois. Ce n’est qu’avec le temps, si elle le souhaite, qu’on peut évoquer le chemin spirituel, le sens, la foi. Et si vous-même croyez encore, vous pouvez prier pour elle, discrètement, humblement. Cela a du poids, même si elle ne le sait pas.
Pour aller plus loin sur la question du mal en théologie chrétienne
Si vous souhaitez creuser cette question complexe du mal à la lumière de la foi chrétienne, plusieurs ressources solides permettent d’enrichir votre regard, entre perspectives théologiques, philosophiques et spirituelles.
Un bon point de départ consiste à lire l’article proposé par Évangile 21, qui explore en détail comment le mal est souvent perçu comme un obstacle à la foi, et comment la tradition chrétienne y répond, notamment en soulignant la responsabilité humaine et l’espérance en une rédemption.
Dans une approche plus académique, la Nouvelle Revue Théologique consacre un article à la manière dont la Bible et la théologie expliquent la présence du mal, sans pour autant nier la bonté et la toute-puissance de Dieu. Le texte propose une lecture nuancée des différents visages du mal : punition, épreuve, ou encore réalité provisoire.
Si la question de la souffrance vous interroge plus spécifiquement, la Revue des Sciences Religieuses aborde la théologie de la souffrance à travers une déconstruction du mal comme puissance autonome, tout en rappelant que le christianisme ne sacralise jamais la douleur.
Pour une lecture plus classique, vous pouvez également consulter cette réflexion de la Revue Thomiste, qui s’appuie sur la pensée de Thomas d’Aquin. Le texte revisite la fameuse question : « Si Dieu existe, pourquoi le mal ? », en montrant que la réponse ne peut être simplement logique, mais doit intégrer une vision de la bonté divine comme dynamique.
Enfin, la Nouvelle Revue Théologique propose aussi une réflexion sur les risques d’un dualisme implicite (type manichéisme) dans certaines interprétations, tout en soulignant que le mal demeure un mystère dans lequel la foi chrétienne préfère proposer une réponse incarnée plutôt qu’un raisonnement clos.