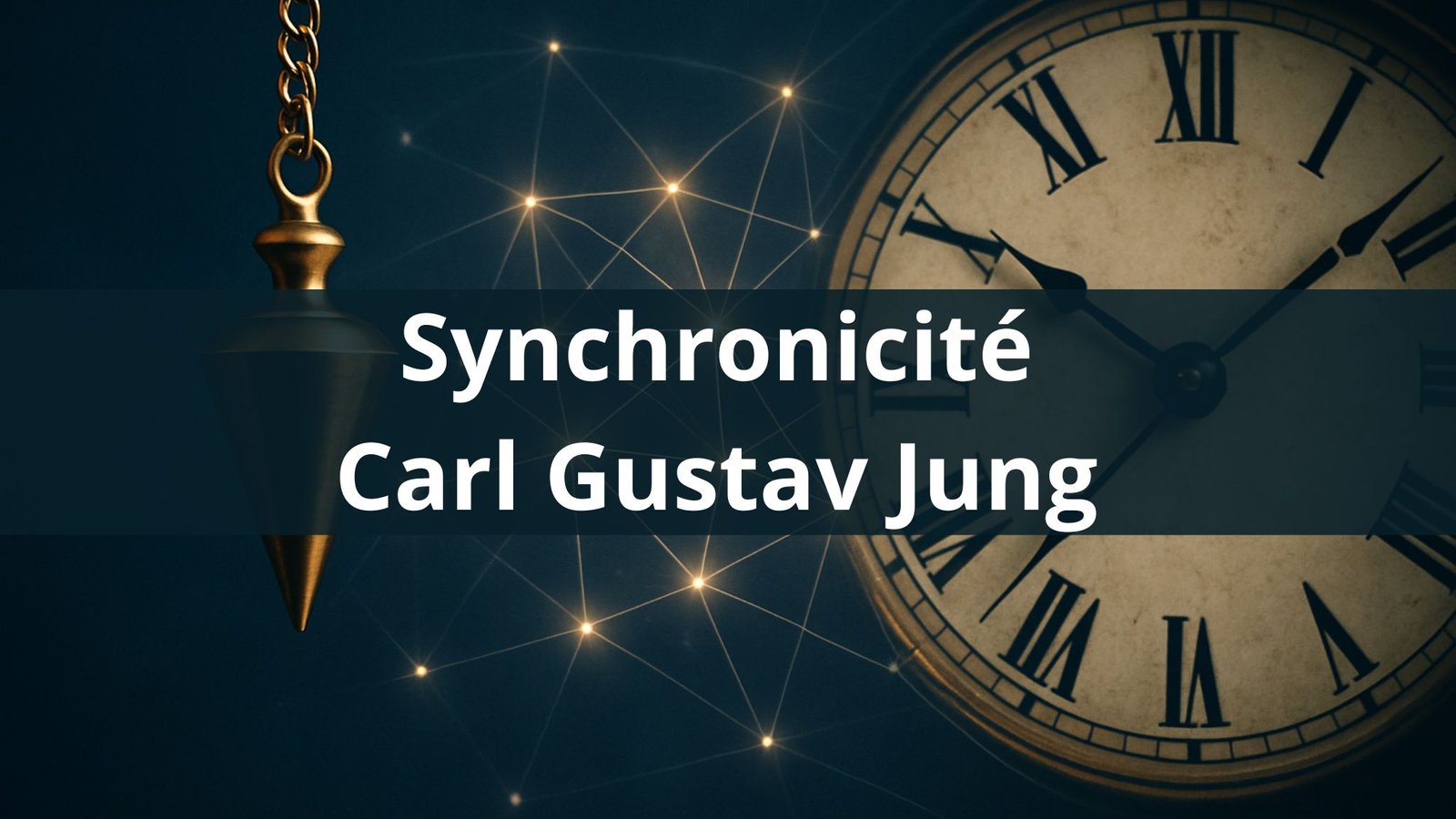Quand on parle de synchronicités, il est difficile de ne pas évoquer Carl Gustav Jung.
Psychiatre suisse du début du XXe siècle, il est le premier à avoir donné un nom et une structure à ce phénomène que beaucoup vivaient sans pouvoir l’expliquer.
Pour Jung, la synchronicité n’est pas un simple hasard ni une superstition.
C’est un dialogue discret entre notre monde intérieur et les événements extérieurs, une manière pour la vie de nous parler dans un autre langage que celui de la logique ordinaire.
À travers ses recherches, ses observations cliniques et ses échanges avec des scientifiques de son temps, Jung a bâti une réflexion profonde sur la manière dont certains événements, bien que dénués de lien causal, prennent sens dans l’expérience personnelle.
Dans cet article, nous allons découvrir comment il a forgé cette notion, ce qu’il en disait réellement, et pourquoi son approche reste aujourd’hui encore une clé précieuse pour mieux comprendre les synchronicités qui jalonnent parfois notre chemin.
Jung et la synchronicité : ce qu’il faut retenir
Carl Gustav Jung est à l’origine du concept de synchronicité. Voici les clés pour comprendre sa pensée sans tout lire.

Par Unbekannt — Cette image provient d’une collection de la bibliothèque de l’École polytechnique fédérale de Zurich et a été publiée sur Wikimedia Commons
Qui était Carl Gustav Jung ?
1. Ses grandes étapes de vie en lien avec sa pensée
Carl Gustav Jung est né en 1875 en Suisse, dans une famille marquée par la théologie et la médecine.
Très tôt, il montre une curiosité vive pour les rêves, les symboles, et les forces invisibles qui animent la vie humaine.
Après des études de médecine et de psychiatrie, il se tourne vers l’étude de l’inconscient.
Son expérience auprès de patients atteints de troubles psychiques l’amène à explorer des terrains que la psychiatrie classique délaisse.
Chaque grande étape de sa vie — ses premières recherches, sa rencontre avec Freud, son propre cheminement intérieur — contribue à forger une approche profondément originale, où la psyché n’est pas seulement un ensemble de mécanismes, mais un espace vivant, porteur de sens.
2. Sa rupture avec Freud et la naissance d’une autre approche de l’inconscient
Au début de sa carrière, Jung collabore étroitement avec Sigmund Freud, qu’il considère comme un mentor.
Ils partagent la conviction que l’inconscient joue un rôle central dans la vie humaine.
Mais rapidement, leurs chemins divergent.
Freud voit l’inconscient principalement comme un réservoir de pulsions refoulées, lié aux traumatismes personnels.
Jung, de son côté, pressent que l’inconscient est beaucoup plus vaste, riche d’images universelles, de mythes, d’archétypes communs à tous les êtres humains.
Cette rupture marque le début d’une quête personnelle où Jung ne cessera d’explorer la dimension symbolique, spirituelle et transpersonnelle de la psyché.
3. Son intérêt pour les symboles, les mythes et l’expérience intérieure
Jung est convaincu que les rêves, les contes, les mythologies anciennes et les expériences spirituelles sont des expressions d’une réalité intérieure profonde.
Pour lui, l’homme moderne a besoin de retrouver ce lien avec les grandes images de l’âme pour ne pas se perdre dans un monde purement rationnel.
Les synchronicités s’inscrivent naturellement dans cette perspective : elles sont des signes vivants que le monde extérieur et l’univers intérieur ne sont pas séparés.
Tout au long de sa vie, Jung cherchera à bâtir un pont entre la science, la psychologie et les grandes traditions spirituelles, avec le souci constant de respecter l’expérience vécue, dans toute sa subtilité.
La naissance de l’idée de synchronicité
1. Les observations qui ont conduit Jung à questionner le simple hasard
Au fil de ses recherches cliniques, Jung observe un phénomène étrange : certains de ses patients vivent des coïncidences frappantes qui semblent étroitement liées à leur état intérieur, mais sans qu’il y ait de lien de cause à effet.
Un rêve sur un scarabée, par exemple, est suivi, le jour même, par l’apparition inattendue d’un scarabée vivant pendant une séance.
Ces événements, rares mais marquants, poussent Jung à réfléchir : et si le monde intérieur et extérieur pouvaient parfois se répondre sans passer par les liens classiques de la causalité ?
Peu à peu, il devient évident pour lui que certains événements « tombent juste » d’une manière qui ne peut être expliquée uniquement par le hasard statistique.
2. L’influence de sa collaboration avec le physicien Wolfgang Pauli
Dans les années 1930, Jung entame une correspondance profonde avec Wolfgang Pauli, l’un des grands physiciens de son temps, connu notamment pour son travail en mécanique quantique.
Pauli, de son côté, avait vécu des expériences troublantes, où des rêves et des phénomènes extérieurs semblaient se répondre.
Le dialogue entre le psychologue et le physicien permet à Jung d’enrichir sa réflexion : la réalité pourrait être tissée de liens non seulement causaux, mais aussi symboliques.
Cette collaboration donne à Jung l’audace de penser que la synchronicité n’est pas une aberration subjective, mais une manifestation subtile de l’ordre du monde, où psyché et matière peuvent être liés par le sens, et non par la cause.
3. Pourquoi Jung a cherché à relier psychologie et phénomènes inexplicables
Jung n’a jamais voulu réduire l’humain à des schémas mécaniques.
Pour lui, l’expérience de la vie intérieure, avec ses rêves, ses intuitions, ses coïncidences troublantes, mérite d’être reconnue dans toute sa richesse.
La théorie de la synchronicité lui permet de donner un cadre à ces expériences sans les dénaturer.
Pas pour les expliquer de manière scientifique au sens strict, mais pour leur rendre leur légitimité psychologique et symbolique.
À travers ce concept, Jung propose un regard nouveau :
celui d’un monde où l’esprit et la matière peuvent, parfois, se répondre dans un langage silencieux que seule l’âme attentive peut entendre.
Comment Jung définit la synchronicité
1. Un événement extérieur lié à un état intérieur sans lien causal
Pour Jung, une synchronicité se produit lorsqu’un événement extérieur coïncide avec une situation intérieure, une pensée, un sentiment, mais sans qu’il y ait de relation de cause à effet.
Ce n’est pas parce que vous pensez à quelqu’un qu’il décide de vous appeler à ce moment-là.
Ce n’est pas non plus un simple hasard mathématique.
C’est une coïncidence qui porte un sens particulier pour la personne qui la vit.
La synchronicité établit donc un lien par le sens, et non par une explication matérielle.
2. La notion de « coïncidence signifiante »
Jung parle de « coïncidence signifiante » pour désigner ces rencontres entre le monde intérieur et le monde extérieur.
Le fait qu’elles aient du sens pour la personne est essentiel : sans cette résonance intime, il n’y a pas synchronicité, seulement événement fortuit.
Il ne s’agit pas de prouver que l’événement est extraordinaire objectivement.
Ce qui compte, c’est l’impact intérieur qu’il déclenche.
Un signe silencieux qui valide un cheminement intérieur, éclaire un doute ou renforce une intuition.
C’est pourquoi deux personnes vivant le même événement n’en feront pas forcément la même lecture.
3. Le rôle du sens vécu dans la reconnaissance d’une synchronicité
Tout dans l’approche de Jung souligne l’importance du vécu subjectif.
La synchronicité est reconnue non par un raisonnement logique, mais par un mouvement intérieur : un étonnement, une émotion, une impression de justesse profonde.
Ce n’est pas l’événement seul qui fait la synchronicité, mais la rencontre entre cet événement et l’état intérieur de la personne.
Jung insiste : la synchronicité n’est pas une superstition ni une magie.
C’est un phénomène de sens, où la vie intérieure et la vie extérieure se croisent sans que l’on puisse dire que l’une a provoqué l’autre.
Synchronicité, inconscient et transformation intérieure
1. Le lien entre synchronicité et processus d’individuation
Dans la pensée de Jung, l’individuation est ce chemin par lequel une personne devient pleinement elle-même, en intégrant les différentes parts conscientes et inconscientes de son être.
Les synchronicités jouent un rôle discret mais précieux dans ce processus.
Elles surviennent souvent aux moments où un tournant intérieur est en cours : une prise de conscience, une décision importante, une transformation profonde.
Elles ne guident pas de manière autoritaire, mais elles accompagnent subtilement le cheminement de l’âme, comme des balises qui signalent que l’on avance dans une direction intérieure juste.
2. Comment les synchronicités révèlent des mouvements profonds de l’âme
Quand une synchronicité se produit, elle met parfois en lumière ce qui était caché en nous.
Un désir ancien, une peur refoulée, une intuition encore floue.
L’événement extérieur agit comme un miroir.
Il reflète un mouvement intérieur que nous n’avions pas encore pleinement reconnu.
Par exemple, une rencontre inattendue peut venir souligner un besoin de changement que l’on n’osait pas formuler.
Un objet trouvé « par hasard » peut réveiller un souvenir enfoui et libérer un nouvel élan.
À travers ces signes, c’est l’inconscient lui-même qui cherche à dialoguer avec la conscience, en utilisant le monde extérieur comme support.
3. L’apparition des signes dans les grandes étapes de changement personnel
Jung remarque que les synchronicités surgissent souvent dans des périodes de crise, de transition ou de grande ouverture intérieure.
Lorsqu’une personne traverse un deuil, une maladie, un changement de vie, ou une quête spirituelle, elle est plus perméable aux signes.
Son inconscient est en mouvement, prêt à émerger à la surface sous des formes variées.
Dans ces moments, la synchronicité agit comme un fil conducteur discret, reliant ce qui se passe en nous à ce qui se passe autour de nous, sans violence, mais avec une précision étonnante.
Les limites et la prudence selon Jung
1. Ne pas voir des synchronicités partout
Même s’il reconnaît l’importance des synchronicités, Jung insiste sur la nécessité de garder une certaine réserve.
Tout ce qui semble étrange ou marquant n’est pas forcément une synchronicité.
Il est facile, surtout quand on découvre ce phénomène, de vouloir tout interpréter comme un signe.
Mais Jung rappelle que la véritable synchronicité se distingue par la profondeur du vécu intérieur, pas par le simple étonnement face à une coïncidence.
Un excès d’interprétation peut rapidement conduire à une vision déformée du réel.
2. Le danger d’une inflation du sens
Pour Jung, il existe un risque particulier lorsqu’on attribue un sens exagéré à chaque événement : l’inflation psychique.
C’est-à-dire le gonflement du moi qui se croit soudainement « élu », « guidé » à chaque instant de manière extraordinaire.
Cette dérive coupe la personne de la simplicité de l’expérience et l’enferme dans une bulle où tout semble devoir être lourd de signification.
Jung invite au contraire à accueillir les synchronicités avec humilité : comme des clins d’œil de la vie, et non comme des preuves de grandeur ou de pouvoir personnel.
3. La nécessité d’un discernement intérieur et d’une intégration consciente
La juste attitude face aux synchronicités est une forme de discernement.
Il ne s’agit pas de nier ce qui est vécu, ni de se méfier systématiquement.
Mais d’intégrer l’expérience avec conscience, de l’accueillir sans l’exagérer.
Un signe marquant peut ouvrir une réflexion, confirmer une intuition, encourager un cheminement.
Mais il ne doit jamais remplacer votre discernement personnel, ni devenir une excuse pour fuir vos responsabilités.
Pour Jung, la véritable richesse de la synchronicité n’est pas de « savoir » ce qu’elle signifie, mais de la laisser nourrir silencieusement votre transformation intérieure.
Pour aller plus loin dans la découverte de la pensée de Jung
Carl Gustav Jung n’a jamais enfermé la vie dans des théories rigides.
À travers sa réflexion sur la synchronicité, il a ouvert un chemin où psychologie, symboles et mystères du réel se rencontrent sans s’exclure.
Si vous souhaitez approfondir cette exploration, d’autres articles peuvent prolonger votre lecture :
Différence entre synchronicité et hasard : comment reconnaître un vrai signe
Un éclairage pour discerner ce qui relève du simple hasard et ce qui peut être accueilli comme un écho de votre cheminement intérieur.Les types de synchronicités les plus fréquentes et leur signification possible
Un parcours à travers les formes que prennent souvent ces clins d’œil du réel : chiffres, animaux, rencontres, objets.Synchronicités et moments de transformation : pourquoi elles surgissent quand la vie change
Une plongée dans les périodes de transition où ces phénomènes se manifestent avec plus de force.Comment favoriser la venue des synchronicités dans votre quotidien
Des gestes simples et profonds pour rendre votre vie intérieure plus attentive aux signes sans tomber dans l’excès.
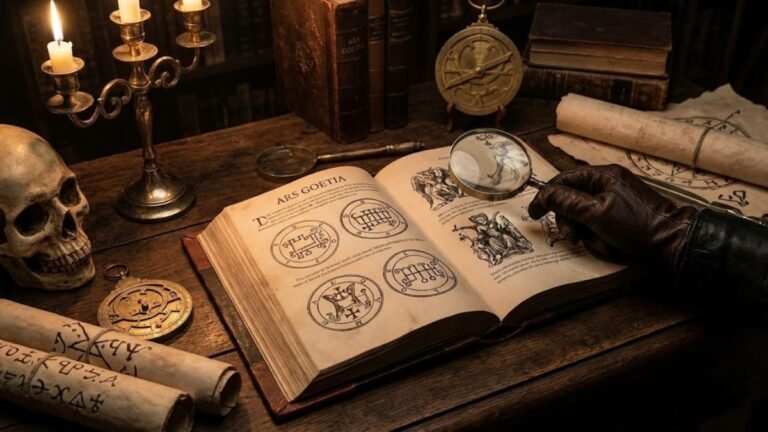
Hiérarchie Infernale : Les 10 démons qui font trembler les exorcistes
D’autres grands auteurs qui ont exploré la question de la synchronicité
Carl Gustav Jung est à l’origine du concept moderne de synchronicité, mais il n’est pas le seul à s’être intéressé à ces liens mystérieux entre le monde intérieur et les événements extérieurs.
D’autres penseurs ont prolongé, enrichi ou questionné cette approche à leur manière.
Parmi eux, Wolfgang Pauli, célèbre physicien et lauréat du prix Nobel, a joué un rôle majeur dans l’élaboration du concept aux côtés de Jung.
Pauli était fasciné par les correspondances entre l’infiniment petit (le monde quantique) et les phénomènes psychiques.
Son échange avec Jung est aujourd’hui reconnu comme un moment-clé du dialogue entre science et expérience intérieure.
Pour en savoir plus sur sa contribution, vous pouvez découvrir son parcours sur l’Encyclopædia Britannica.
Un autre grand nom à mentionner est Marie-Louise von Franz, proche collaboratrice de Jung, qui a travaillé en profondeur sur les contes, les rêves et les symboles.
Elle a prolongé la réflexion sur la synchronicité, notamment en montrant comment les récits traditionnels véhiculent ces coïncidences significatives sous forme d’images collectives.
Ses travaux sont abordés avec clarté dans cette page qui lui est consacrée sur C.G. Jung Center.
Dans un registre plus contemporain, Jean-François Vézina, psychologue québécois, a proposé une lecture moderne de la synchronicité à travers ses ouvrages, en particulier sur l’importance des rencontres imprévues dans notre parcours de vie.
Son approche, plus accessible au grand public, éclaire avec simplicité et profondeur ce phénomène.
Vous pouvez explorer son travail présenté sur son site officiel.
Enfin, David Peat, physicien et penseur interdisciplinaire, a cherché à lier la synchronicité avec les lois de la physique moderne.
Son livre « Synchronicity: The Bridge Between Matter and Mind » tente d’établir des passerelles entre les découvertes scientifiques et les expériences subjectives.
Une présentation de ses travaux est disponible sur le site Pari Center.