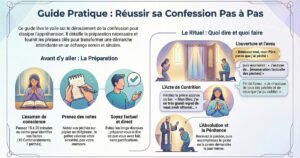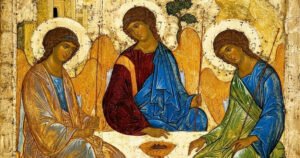Comment un pape est-il choisi ? Une procédure unique au monde
L’élection du pape intrigue souvent, même parmi ceux qui suivent l’actualité religieuse. Qui vote ? Comment se déroule le conclave ? Quelles règles sont suivies ? Derrière l’image solennelle de la fumée blanche, il existe un processus bien plus complexe, profondément ritualisé et strictement encadré.
Cet article vous propose de découvrir le déroulement précis de l’élection pontificale, depuis la vacance du siège jusqu’à l’annonce du nouveau pape. Une plongée dans une tradition unique, entre prière, isolement, et responsabilité historique.
ℹ️ Mise à jour importante – Élection du pape Léon XIV
Le 8 mai 2025, l’Église catholique a élu un nouveau souverain pontife : le cardinal américain Robert Francis Prevost, qui devient le 267ᵉ pape sous le nom de Léon XIV.
Un conclave décisif
Le conclave, convoqué après le décès du pape François, s’est tenu les 7 et 8 mai 2025. Après quatre tours de scrutin, le cardinal Prevost a été élu avec 89 voix sur 133, surpassant le favori initial, le cardinal italien Pietro Parolin, qui s’est retiré après le troisième tour. L’annonce officielle a été faite par le cardinal Dominique Mamberti depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre.
Un pape aux origines américaines et péruviennes
Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prevost est le premier pape originaire des États-Unis. Il a passé plus de vingt ans au Pérou en tant que missionnaire et évêque de Chiclayo, obtenant la citoyenneté péruvienne en 2015. Avant son élection, il était préfet du Dicastère pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine.
Une vision pastorale centrée sur la paix et la justice sociale
Dès ses premiers mots en tant que pape, Léon XIV a appelé à une Église synodale, proche des pauvres et engagée pour la paix. Il a exprimé sa volonté de poursuivre les réformes de son prédécesseur, notamment en matière de justice sociale et de dialogue interreligieux. Sa première messe pontificale, célébrée le 9 mai dans la chapelle Sixtine, a été marquée par un appel fort à remettre Dieu au centre, dénonçant « l’idolâtrie de la technologie, de l’argent et du pouvoir ».
Une inauguration solennelle à venir
L’inauguration officielle de son pontificat est prévue pour le 18 mai 2025, lors d’une messe solennelle sur la place Saint-Pierre.
ℹ️ Décès du pape François
Le pape François, dernier souverain pontife en fonction, est décédé en avril 2025. Voici les éléments à connaître.
Le décès du pape François : une page se tourne
Le lundi 21 avril 2025, le pape François s’est éteint à l’âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, à la Casa Santa Marta. Né Jorge Mario Bergoglio, il était devenu le 266ᵉ pape de l’Église catholique en 2013, après la renonciation de Benoît XVI. Son élection avait marqué plusieurs premières : il était le premier pape jésuite, le premier issu du continent sud-américain, et le premier à choisir le nom de François — en référence à saint François d’Assise.
Son pontificat, long de plus de douze ans, a été marqué par sa simplicité, son engagement en faveur des plus pauvres et son insistance sur les enjeux sociaux, écologiques et interreligieux. Jusqu’à ses derniers jours, il est resté actif, célébrant encore la bénédiction Urbi et Orbi le dimanche de Pâques, la veille de son décès.
Sa mort a été annoncée officiellement par le cardinal Kevin Farrell, camerlingue, qui a salué son humilité, son courage et sa fidélité à l’Évangile. Une période de deuil de neuf jours, appelée novemdiales, a été ouverte. Le conclave pour élire son successeur s’est tenu dans les semaines suivantes, selon la tradition, dans la chapelle Sixtine.
Mort du pape François : infos du Vatican
Les premières paroles du pape Léon XIV : infos sur Vatican News
L’élection du pape : les clés pour comprendre
Entre tradition millénaire et procédure rigoureuse, le conclave fascine par son mystère autant que par sa précision. Voici l’essentiel à savoir.
Un événement unique, entre tradition, prière et organisation rigoureuse
L’élection d’un pape est l’un des moments les plus solennels et symboliques de la vie de l’Église catholique. Elle attire l’attention du monde entier, bien au-delà du cercle des croyants, tant elle est chargée de sens, de rituels et d’histoire.
Mais que se passe-t-il réellement lorsque le siège du pape devient vacant ? Comment les cardinaux procèdent-ils pour désigner celui qui deviendra l’évêque de Rome, successeur de saint Pierre et chef spirituel de plus d’un milliard de catholiques dans le monde ?
Contrairement à une idée répandue, il ne s’agit pas simplement d’un vote secret comme dans une élection classique. L’élection du pape obéit à un protocole très ancien, à la fois spirituel, symbolique et organisé dans ses moindres détails. Elle se déroule dans un lieu bien précis, selon des règles précises, à l’abri du regard extérieur, dans un climat de prière et de silence.
Pour mieux comprendre ce moment exceptionnel, il faut entrer dans le fonctionnement du conclave, en suivre les étapes, et découvrir aussi les anecdotes historiques qui ont marqué certaines élections.
Si l’élection d’un pape vous intéresse, je vous propose également de découvrir ou redécouvrir les mystères qui entourent le vatican dans notre article connexe.
Qui peut devenir pape ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, aucun texte canonique n’impose que le pape soit nécessairement un cardinal. En théorie, tout homme baptisé, catholique, et jugé apte peut être élu. Toutefois, dans la pratique actuelle, les électeurs choisissent toujours parmi les cardinaux présents au conclave, car ce sont eux qui connaissent le mieux les enjeux de l’Église et les personnalités du collège.
Les conditions de fond
Pour être élu pape, il faut :
Être de sexe masculin (la papauté est une fonction sacerdotale, réservée dans l’Église catholique aux hommes) ;
Être baptisé dans la foi catholique ;
Être jugé apte à gouverner l’Église au regard des responsabilités pastorales, doctrinales et diplomatiques.
Il n’est pas nécessaire d’être évêque au moment de l’élection. Si le candidat élu ne l’est pas encore, il doit être ordonné évêque immédiatement après son acceptation, car la papauté implique d’être évêque de Rome.
Une pratique concentrée sur les cardinaux
En pratique, depuis plusieurs siècles, seuls des cardinaux ont été élus. Cela s’explique par le fait que le collège électoral est lui-même composé de cardinaux, qui choisissent en majorité parmi leurs pairs. Ils connaissent les profils, les sensibilités, les capacités de discernement et les expériences de chacun.
Mais rien n’empêcherait, juridiquement, l’élection d’un prêtre ou même d’un laïc (qui devrait alors recevoir successivement l’ordination diaconale, sacerdotale puis épiscopale avant de devenir effectivement pape). Ce cas est hautement improbable aujourd’hui.
Une élection libre, sans candidature
Il est important de noter que personne ne peut se présenter, faire campagne ou poser sa candidature. L’élection du pape est une désignation, non une compétition. Tout cardinal entrant au conclave le fait dans un esprit de prière et de discernement, avec le devoir de choisir celui qui semble être le plus à même de guider l’Église dans les temps présents.
Le nouveau pape n’est donc pas “nommé”, encore moins “promu” : il est élu, puis accepte librement la charge, dans un esprit de service.
Références officielles sur qui peut être élu pape
1. Universi Dominici Gregis (Jean-Paul II, 1996)
Le texte principal est la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, qui organise le déroulement du conclave moderne.
Voici ce qu’elle dit (n° 83) :
« Je déclare et établis que l’élection du Souverain Pontife appartient exclusivement aux cardinaux de la sainte Église romaine. Toutefois, aucun cardinal électeur ne pourra être exclu de l’élection active et passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit. Il est en outre permis d’élire comme Pontife non seulement un membre du Collège des cardinaux, mais aussi un ecclésiastique appartenant à un autre ordre, pourvu qu’il soit baptisé et de sexe masculin. »
Cela signifie :
L’élection peut concerner tout homme baptisé et catholique, pas nécessairement un cardinal.
S’il n’est pas encore évêque, il doit être immédiatement ordonné évêque avant de devenir pape.
(Source : Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, § 83)
2. Code de droit canonique (1983)
Le Code de droit canonique, bien qu’il ne détaille pas directement le processus d’élection, indique dans le canon 332 §1 que :
« Le Pontife romain acquiert son pouvoir en acceptant légitimement son élection ; dès lors, il a plein pouvoir et juridiction suprême sur l’Église universelle. »
Le Code suppose donc qu’une élection valide est suffisante pour que la fonction soit assumée.
Et, traditionnellement, l’éligibilité repose uniquement sur :
être baptisé,
être catholique,
être homme.
Qui élit le pape ?
L’élection d’un pape n’est pas ouverte à tous les membres du clergé, ni même à tous les évêques. Elle est confiée à un groupe très précis : les cardinaux électeurs.
Ce sont eux qui composent le collège des électeurs du conclave, une institution ancienne qui joue un rôle essentiel dans la continuité de l’Église.
Le collège des cardinaux
Le collège des cardinaux est un groupe de hauts dignitaires de l’Église, nommés par le pape au fil du temps. Ils ont pour mission de conseiller le pape, de collaborer avec lui dans le gouvernement de l’Église universelle, et surtout, lorsqu’il décède ou renonce à sa charge, d’élire son successeur.
Tous les cardinaux n’ont pas le droit de vote. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans au jour du début du conclave peuvent participer à l’élection. C’est ce que prévoient les règles établies par Paul VI puis précisées par Jean-Paul II et Benoît XVI. Ceux qui ont dépassé cet âge conservent leur titre et leurs responsabilités honorifiques, mais ne prennent pas part au scrutin.
Le nombre de cardinaux électeurs est normalement limité à 120, bien que ce chiffre ait pu être légèrement dépassé à certaines occasions. Tous sont convoqués à Rome dès que le siège du pape devient vacant.
Des cardinaux venus du monde entier
Les cardinaux électeurs sont issus de différentes régions du monde. Certains résident à Rome et occupent des fonctions dans la Curie romaine (le gouvernement central de l’Église), d’autres sont archevêques dans leurs pays respectifs.
Cette diversité géographique reflète la dimension universelle de l’Église. Lors des derniers conclaves, les électeurs provenaient de tous les continents, ce qui donne à l’élection une portée véritablement mondiale.
Une mission spirituelle, pas politique
Même si l’élection est entourée de discussions, d’influences et parfois de tensions, il ne s’agit pas d’un vote politique au sens habituel. Les cardinaux prêtent serment de chercher ensemble, dans la prière et sous l’inspiration de l’Esprit Saint, celui qu’ils estiment le plus apte à guider l’Église dans le contexte présent.
Ce cadre solennel et spirituel donne toute sa force au conclave, et en fait un moment à la fois profondément humain et ouvert à une dimension de discernement que les croyants considèrent comme sacrée.
À lire aussi: Les preuves de l’existence de Jésus
Quand le processus d’élection se met-il en marche ?
L’élection d’un nouveau pape n’est lancée que dans une situation bien précise : lorsque le siège de l’évêque de Rome devient vacant. Cela peut arriver dans deux cas : à la mort du pape en fonction, ou — plus rarement — lorsqu’il choisit librement de renoncer à sa charge.
La vacance du siège apostolique
Traditionnellement, le pape est élu à vie. Pendant des siècles, la mort du souverain pontife était donc le seul événement déclenchant un nouveau conclave. C’est ce qui s’est produit, par exemple, en 2005 avec le décès de Jean-Paul II.
Mais depuis 2013, un autre scénario est désormais bien connu : la renonciation volontaire. Ce fut le cas de Benoît XVI, qui a annoncé son retrait pour des raisons de santé, marquant une première dans l’histoire moderne de l’Église.
Qu’il s’agisse d’un décès ou d’une démission, l’Église entre alors dans ce qu’on appelle la sede vacante : le siège apostolique est vacant, et aucun pape n’est en fonction. Durant cette période, aucun texte officiel ne peut être promulgué au nom du pape. L’administration courante est assurée, mais tout ce qui relève de décisions importantes est suspendu.
Le rôle du camerlingue
Durant cette période de transition, c’est le camerlingue, un cardinal désigné par le pape en exercice, qui veille sur les affaires courantes du Vatican. Il a pour tâche d’assurer l’intérim sans empiéter sur les décisions du futur pape.
Le camerlingue organise les préparatifs du conclave, vérifie l’identité du pape décédé (dans le cas d’un décès), supervise la fermeture de ses appartements, et coordonne les réunions des cardinaux.
Le délai avant le conclave
Les règles prévoient que le conclave ne peut pas commencer immédiatement après la vacance du siège. Un délai de 15 jours minimum est généralement observé, afin de permettre aux cardinaux du monde entier de rejoindre Rome. Ce délai peut aller jusqu’à 20 jours si nécessaire, selon la décision du Collège des cardinaux.
Pendant cette période, les cardinaux se réunissent chaque jour pour ce qu’on appelle les congrégations générales. Ce sont des rencontres préparatoires où ils peuvent échanger librement sur l’état de l’Église, les défis à venir, et le profil souhaitable pour le futur pape.
C’est dans ce contexte que se prépare, dans la prière et la réflexion, l’un des événements les plus singuliers et chargés de sens de la tradition catholique : le conclave.
Où a lieu l’élection du pape ?
Le moment décisif de l’élection pontificale se déroule dans un lieu à la fois symbolique, sacré et chargé d’histoire : la chapelle Sixtine, au cœur du Vatican. Ce n’est pas un choix anecdotique. Ce lieu exceptionnel incarne à lui seul la solennité, la continuité et le mystère de la mission confiée au futur pape.
Un lieu fermé, protégé et hautement symbolique
Le conclave — du latin cum clave, qui signifie littéralement « sous clé » — se tient à huis clos, dans des conditions extrêmement strictes. Aucun contact n’est autorisé avec l’extérieur pendant toute la durée de l’élection. Cela inclut l’interdiction de tout appareil électronique, téléphone, internet ou communication de quelque nature que ce soit.
Les cardinaux sont logés à proximité, dans la résidence Sainte-Marthe, un bâtiment du Vatican aménagé pour l’occasion. Ils se rendent chaque jour à la chapelle Sixtine pour voter, selon un protocole précis.
Des mesures techniques sont également mises en place pour garantir le secret absolu des délibérations : brouilleurs d’ondes, contrôles de sécurité renforcés, personnel limité et assermenté.
La chapelle Sixtine : entre art et spiritualité
La chapelle Sixtine n’est pas qu’un décor prestigieux. C’est un lieu de prière et de discernement, surmonté de fresques mondialement célèbres, notamment le Jugement dernier de Michel-Ange, qui domine le mur derrière l’autel.
Pour les cardinaux réunis là, cette fresque n’est pas un simple chef-d’œuvre artistique : elle est aussi un rappel fort de leur responsabilité. Leur décision engage l’avenir de l’Église. Elle est censée être guidée non par des logiques humaines ou politiques, mais par la recherche sincère de la volonté divine.
Ce décor solennel, ce silence imposé, cette rupture temporaire avec le monde extérieur… tout cela contribue à faire du conclave un moment à part, où chaque geste, chaque parole, chaque vote est chargé de sens.

Par User Maus-Trauden on de.wikipedia — Originally from de.wikipedia; description page is (was) here, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=593698
Le déroulement du conclave, étape par étape
Une fois les cardinaux réunis à Rome et les derniers préparatifs achevés, le conclave peut commencer. C’est un moment solennel, codifié, qui obéit à un rituel précis. Voici comment il se déroule.
1. La messe pour l’élection du pape
Avant toute chose, une messe solennelle est célébrée dans la basilique Saint-Pierre de Rome :
la messe pour l’élection du pontife, en latin Missa pro eligendo Romano Pontifice.
Tous les cardinaux — électeurs et non électeurs — y participent. Cette messe est publique, et elle marque l’ouverture spirituelle du processus électoral. On y invoque l’Esprit Saint pour qu’il guide le discernement des électeurs.
2. L’entrée en conclave
Le jour même, les cardinaux électeurs se rendent en procession jusqu’à la chapelle Sixtine, en chantant la litanie des saints. Une fois entrés, ils prennent place chacun à son pupitre.
Vient alors le moment symbolique et décisif : le cérémoniaire prononce la formule « Extra omnes ! », ce qui signifie « tous dehors ! ». Toutes les personnes non autorisées quittent alors les lieux. Les portes sont fermées. Le conclave est officiellement ouvert.
3. Les scrutins
Le processus électoral peut débuter. Le conclave prévoit jusqu’à quatre votes par jour : deux le matin, deux l’après-midi. Voici comment se déroule chaque scrutin :
Chaque cardinal reçoit un petit bulletin sur lequel il écrit, en latin, le nom du candidat de son choix.
Il avance ensuite à l’autel et dépose le bulletin dans une urne, en prononçant un serment.
Les bulletins sont ensuite mélangés, puis comptés à voix haute par les scrutateurs.
Si le résultat est valide (sans erreur de procédure), les bulletins sont lus un à un.
Les bulletins sont ensuite perforés, enfilés sur une ficelle, puis brûlés dans un poêle spécial installé dans la chapelle.
4. La règle de la majorité qualifiée
Pour être élu, un candidat doit obtenir au moins deux tiers des voix. Ce seuil est volontairement élevé, afin d’assurer un large consensus au sein du collège électoral.
Tant que cette majorité n’est pas atteinte, les scrutins se poursuivent. Il peut y avoir plusieurs jours de vote si nécessaire. Si l’élection tarde, des mesures sont prévues pour favoriser une issue : temps de prière supplémentaire, possibilité de restreindre les choix à deux noms, etc.
5. La fumée noire ou blanche
À la fin de chaque session de vote, les bulletins sont brûlés. La fumée qui s’élève de la cheminée installée au sommet de la chapelle Sixtine indique au monde extérieur ce qui s’est passé :
Fumée noire (fumata nera) : aucun pape n’a encore été élu.
Fumée blanche (fumata bianca) : un nouveau pape a été choisi.
Cette fumée est le seul signe visible de l’extérieur tant que l’élection n’est pas officiellement annoncée. Il arrive d’ailleurs que l’interprétation soit difficile : des fumées grises ont parfois semé le doute.
Après l’élection : l’annonce du nouveau pape
Lorsque le seuil des deux tiers est atteint et qu’un cardinal obtient le nombre requis de voix, l’élection est considérée comme valide. Mais le processus ne s’arrête pas là. Il reste plusieurs étapes cruciales avant que le monde entier ne découvre l’identité du nouveau pape.
L’acceptation de l’élu
Le doyen des cardinaux électeurs — ou le plus ancien en cas d’absence — s’approche alors du cardinal élu et lui pose deux questions solennelles, en latin :
« Acceptes-tu ton élection canonique comme Souverain Pontife ? »
« Quel nom choisis-tu ? »
Si le cardinal répond par l’affirmative, il devient immédiatement évêque de Rome et pape, même s’il n’est pas encore sorti à la loggia. Le choix du nom n’est pas anodin : il donne souvent une indication sur l’intention ou l’inspiration du pontificat à venir.
La salle des larmes
Après avoir accepté, le nouveau pape est conduit dans une pièce attenante à la chapelle Sixtine, appelée de façon informelle la “salle des larmes”. Elle tient ce nom de l’émotion que certains papes y ont manifestée, face à la responsabilité immense qui vient de leur être confiée.
C’est là qu’il revêt pour la première fois la soutane blanche, préparée à l’avance en plusieurs tailles. Il reçoit également l’anneau du pêcheur, l’un des symboles de sa fonction.
L’annonce officielle au monde
Une fois le pape prêt, le cardinal protodiacre — c’est-à-dire le cardinal diacre le plus ancien — se rend au balcon central de la basilique Saint-Pierre. Il s’adresse à la foule rassemblée et aux médias du monde entier avec la célèbre formule latine :
Habemus Papam !
« Nous avons un pape ! »
Il annonce alors le prénom de l’élu, son nom de cardinal, et le nom qu’il a choisi.
Quelques instants plus tard, le nouveau pape apparaît à son tour, salue la foule et donne sa première bénédiction apostolique Urbi et Orbi (« à la ville et au monde »). Ce moment, souvent très attendu et très émouvant, marque le début effectif de son pontificat.
Est-il possible de destituer un pape ?
La question de la destitution d’un pape est délicate, car elle touche directement au statut unique du pontife romain dans l’Église catholique.
En droit canonique, le pape n’a aucun supérieur humain sur terre.
Cela signifie que personne, pas même un concile d’évêques, ni même l’ensemble des cardinaux réunis, n’a le pouvoir de le destituer.
Le pape tient son autorité directement du Christ, et il exerce une juridiction suprême, plénière, immédiate et universelle sur toute l’Église (canon 331 du Code de droit canonique).
Il n’est donc pas « révocable » comme un chef d’État ou un président d’organisation humaine.
La seule voie : la renonciation volontaire
Le seul moyen par lequel un pape cesse d’être pape est par sa renonciation librement consentie.
Le canon 332 §2 du Code de droit canonique précise :
« Si le Pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit libre et qu’elle soit dûment manifestée, mais non qu’elle soit acceptée par qui que ce soit. »
En d’autres termes, le pape peut démissionner volontairement, comme l’a fait Benoît XVI en 2013.
Sa décision doit être totalement libre, sans contrainte, et exprimée de manière claire.
Cas hypothétique de l’incapacité grave
Si un pape devenait gravement incapable (par exemple en cas de coma prolongé ou de perte complète de ses facultés mentales), la situation serait extrêmement complexe, car le droit canon ne prévoit pas explicitement de procédure pour destituer un pape devenu inapte.
Certains théologiens estiment qu’un consensus exceptionnel des cardinaux pourrait alors constater un état d’empêchement, mais ce serait un cas de figure inédit et sans base juridique formelle.
Dans l’état actuel du droit de l’Église, cette question reste donc en grande partie théorique.
Quelques situations historiques de contestation papale
Si aujourd’hui, le droit canonique est clair sur l’impossibilité de destituer un pape, l’histoire de l’Église montre que certains cas anciens ont mis cette réalité à rude épreuve.
Le cas du pape Benoît IX (XIᵉ siècle)
Benoît IX, élu très jeune, mena un pontificat marqué par de nombreux scandales.
Il finit par vendre sa charge à son successeur Grégoire VI — un acte évidemment contraire à l’esprit de l’Église.
Pour résoudre ce désordre, un synode fut convoqué en 1046 à Sutri, sous l’autorité de l’empereur Henri III.
Le synode força la démission de Benoît IX et d’autres prétendants, mais historiquement, ces renoncements furent obtenus par des moyens plus politiques que juridiques.
Le schisme d’Occident (XIVᵉ- XVᵉ siècles)
Le schisme d’Occident a vu plusieurs papes et antipapes se disputer la légitimité.
Le concile de Constance (1414-1418) mit fin au schisme en obtenant la démission de plusieurs prétendants et en élisant Martin V.
Mais cette crise a surtout montré la difficulté extrême à résoudre une situation où plusieurs autorités pontificales rivales existent, sans que l’on puisse techniquement « destituer » un pape en titre.
Une règle jamais remise en cause
Même dans ces épisodes troublés, l’Église n’a jamais modifié son principe fondamental :
le pape ne peut être déposé par une autorité humaine.
Les solutions sont toujours passées par des renoncements, souvent négociés, jamais par une destitution imposée.
Combien de papes ont été élus depuis saint Pierre ?
Depuis saint Pierre, considéré comme le premier évêque de Rome, 266 papes se sont succédés à la tête de l’Église catholique. Chacun a marqué son époque à sa manière, entre grandes réformes, crises, conciles et périodes de stabilité.
Pour découvrir leur nom, leurs dates de pontificat et replacer chaque pape dans son contexte historique, vous pouvez consulter la liste complète disponible ici.
Le confinement des cardinaux pendant le conclave : comment cela se passe ?
Pendant le conclave, les cardinaux électeurs vivent un isolement strict au Vatican.
Mais au-delà de l’image d’un enfermement symbolique, comment cette période se déroule-t-elle vraiment au quotidien ?
Voici ce qu’il faut savoir pour comprendre ce confinement très particulier.
Pourquoi les cardinaux sont-ils enfermés ?
L’enfermement des cardinaux pendant le conclave vise à garantir la liberté et la confidentialité de l’élection du pape.
En les isolant du monde extérieur, l’Église s’assure que leur choix est fait sans pression politique, médiatique ou populaire.
Depuis des siècles, ce principe d’isolement est respecté avec une grande rigueur.
Où vivent-ils pendant le conclave ?
Depuis 2005, les cardinaux ne dorment plus dans des cellules improvisées autour de la Chapelle Sixtine.
Ils résident dans la Maison Sainte-Marthe, une résidence moderne située dans l’enceinte du Vatican.
Chaque cardinal dispose d’une chambre simple, confortable mais sans luxe particulier, avec un lit, un bureau et une salle de bain privée.
Se déplacent-ils librement ?
Les cardinaux ne peuvent circuler qu’entre deux lieux précis :
Leur résidence à Sainte-Marthe,
Et la Chapelle Sixtine, où se déroulent les votes.
Des chemins sécurisés sont balisés pour éviter tout contact avec le monde extérieur.
Ils n’ont pas accès aux jardins du Vatican, ni à d’autres bâtiments, sauf en cas de nécessité absolue et autorisée.
Comment font-ils pour manger ?
Tous les repas sont organisés sur place à la Maison Sainte-Marthe.
Un service de restauration interne, sous surveillance stricte, prépare les repas.
Le personnel chargé de la cuisine et du service est choisi avec soin et doit prêter serment de confidentialité avant l’ouverture du conclave.
Les repas sont pris dans une salle commune, mais sans réception extérieure ni possibilité d’envoyer ou de recevoir des messages.
Ont-ils des moments de détente ?
Oui, mais dans des limites très précises.
Lorsqu’ils ne sont pas en session de vote, les cardinaux peuvent se reposer dans leurs chambres, méditer, lire ou prier.
Ils n’ont accès ni à la télévision, ni à la radio, ni à internet, pour préserver le silence nécessaire au discernement.
De quelle heure à quelle heure sont-ils enfermés chaque jour ?
Les cardinaux ne sortent pas de leur isolement pendant toute la durée du conclave.
Chaque jour, le rythme est structuré autour de deux sessions de vote le matin, puis deux l’après-midi.
Entre les sessions, ils peuvent retourner à leur chambre pour se reposer, mais restent toujours à l’intérieur de la zone contrôlée.
Il n’existe pas d’horaires « d’ouverture » ou « de fermeture » au sens habituel :
l’isolement est continu, 24 heures sur 24, jusqu’à l’élection du nouveau pape.
Qui surveille le respect de l’enfermement ?
La Garde suisse pontificale, assistée par la gendarmerie vaticane, veille à ce que personne n’entre ou ne sorte sans autorisation.
Tous les accès sont contrôlés et surveillés en permanence.
De plus, des techniciens spécialisés s’assurent qu’aucun moyen de communication clandestin (téléphones, appareils connectés…) ne puisse être utilisé.
Que se passe-t-il si un cardinal sort ou rompt le secret pendant le conclave ?
Le secret du conclave est une règle absolue, qui ne tolère aucun écart.
Chaque cardinal, avant même d’entrer dans la Chapelle Sixtine, prête serment de confidentialité totale.
Ce serment engage non seulement leur parole, mais aussi leur responsabilité morale et spirituelle devant Dieu.
Si un cardinal enfreint cet engagement — en divulguant ce qui se dit à l’intérieur, en communiquant avec l’extérieur ou en quittant sans autorisation l’enceinte réservée —, plusieurs conséquences graves peuvent s’appliquer.
1. Sanctions spirituelles et ecclésiales
La constitution apostolique Universi Dominici Gregis, qui régit le déroulement du conclave, prévoit que tout cardinal qui viole le secret encourt automatiquement l’excommunication latae sententiae.
Cela signifie qu’il est excommunié de manière automatique, sans besoin d’un procès ecclésiastique.
Cette sanction est extrêmement lourde : elle le coupe de la communion avec l’Église jusqu’à ce qu’il obtienne éventuellement l’absolution par une autorité compétente.
2. Invalidité des actes posés sous influence extérieure
Si une tentative d’influence extérieure sur un cardinal est détectée — pression politique, médiatique ou autre —, le vote qui en découlerait serait considéré comme invalide.
Le conclave pourrait même être suspendu ou annulé en cas de situation grave, bien que cela n’ait jamais été nécessaire dans l’histoire récente.
3. Contrôle strict pour éviter toute tentation
Pour éviter toute possibilité de rupture du secret, des mesures sont mises en place dès l’entrée en conclave :
Toutes les communications électroniques sont interdites et bloquées,
Les lieux sont inspectés régulièrement,
Le personnel chargé du service est soumis aux mêmes exigences de confidentialité.
En résumé, tout est organisé pour empêcher qu’un cardinal puisse, volontairement ou non, enfreindre les règles sacrées du conclave.
Et en cas d’infraction, les conséquences sont immédiates et très sévères.
Les favoris pour succéder au pape François (mise à jour avril 2025)
À l’approche du conclave prévu entre le 6 et le 11 mai 2025, plusieurs cardinaux émergent comme candidats potentiels pour devenir le prochain pape.
Le Collège des cardinaux électeurs, composé de 135 membres de moins de 80 ans, reflète aujourd’hui une diversité géographique et idéologique sans précédent.
Voici un aperçu des principaux « papabili » identifiés par les observateurs.
1. Cardinal Pietro Parolin (Italie)
Secrétaire d’État du Vatican depuis 2013, Pietro Parolin est reconnu pour sa diplomatie et sa connaissance approfondie de la Curie romaine.
Il est considéré comme un candidat de continuité, même si certaines critiques pointent sa gestion prudente des affaires financières du Vatican.
2. Cardinal Luis Antonio Tagle (Philippines)
Ancien archevêque de Manille et actuel préfet du Dicastère pour l’Évangélisation, Luis Antonio Tagle est souvent surnommé le « François asiatique ».
Son engagement envers les pauvres et son approche pastorale en font un favori pour ceux qui souhaitent poursuivre l’élan du pontificat actuel.
3. Cardinal Matteo Zuppi (Italie)
Archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne, Matteo Zuppi est connu pour son travail en faveur de la paix et du dialogue.
Proche de la communauté de Sant’Egidio, il incarne une option plus progressiste au sein de l’Église.
4. Cardinal Fridolin Ambongo (République démocratique du Congo)
Archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo est respecté pour sa défense des droits humains et de l’environnement.
Sa stature en Afrique et son engagement social pourraient peser dans le choix des électeurs.
5. Cardinal Jean-Marc Aveline (France)
Archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, Jean-Marc Aveline est apprécié pour son ouverture au dialogue interreligieux et sa sensibilité aux questions migratoires.
Il représente un profil modérément progressiste.
6. Cardinal Robert Sarah (Guinée)
Ancien préfet de la Congrégation pour le Culte Divin, Robert Sarah est une figure conservatrice respectée pour son attachement à la tradition catholique.
Il est soutenu par de nombreux fidèles attachés à une vision plus classique de l’Église.
7. Cardinal Jean-Claude Hollerich (Luxembourg)
Archevêque de Luxembourg et rapporteur général du Synode sur la synodalité, Jean-Claude Hollerich est connu pour ses positions ouvertes sur plusieurs sujets contemporains.
Il est souvent cité parmi les voix progressistes du Collège des cardinaux.
8. Cardinal Péter Erdő (Hongrie)
Archevêque d’Esztergom-Budapest, Péter Erdő est un intellectuel reconnu, très attaché à la rigueur doctrinale et à la discipline ecclésiastique.
Son profil conviendrait à ceux qui souhaitent un retour à une ligne plus conservatrice.
9. Cardinal Robert Francis Prevost (États-Unis)
Préfect du Dicastère pour les Évêques, Robert Prevost est apprécié pour sa capacité à construire le consensus.
Son profil pourrait séduire ceux qui cherchent un pape gestionnaire, capable d’unifier diverses sensibilités.
10. Cardinal Pierbattista Pizzaballa (Israël)
Patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa est reconnu pour son travail dans le dialogue interreligieux au Moyen-Orient.
Son expérience dans une région complexe est vue comme un atout important par certains observateurs.
Quelques anecdotes étonnantes sur les conclaves passés
L’élection du pape suit un rituel ancien et très organisé… mais cela n’a pas empêché l’histoire de connaître quelques épisodes insolites, symboliques ou même dramatiques. Voici quelques faits réels, peu connus du grand public, qui ont marqué l’histoire des conclaves.
Le conclave le plus long de l’histoire
En 1268, à la mort du pape Clément IV, les cardinaux mettent près de trois ans à s’accorder sur un successeur. Le conclave se déroule à Viterbe, et la situation s’enlise complètement.
Les habitants, excédés par cette lenteur, finissent par enfermer les cardinaux à double tour, réduire leur nourriture et même enlever le toit du bâtiment pour accélérer la décision.
Finalement, Grégoire X est élu en 1271. C’est à la suite de ce conclave que naît l’expression cum clave — « sous clé » — et que les règles d’isolement sont instituées.
Deux conclaves la même année
L’année 1978 est exceptionnelle dans l’histoire moderne : deux papes sont élus à quelques semaines d’intervalle.
En août, Jean-Paul Ier succède à Paul VI. Il est chaleureusement accueilli, mais son pontificat ne dure que 33 jours.
Sa mort soudaine provoque un second conclave en octobre, qui conduit à l’élection de Jean-Paul II, premier pape non italien depuis plus de 450 ans.
La fumée… grise ?
En 2005, lors du conclave qui élit Benoît XVI, la première fumée dégagée par le poêle est… grise. Ni blanche, ni noire, elle laisse les observateurs perplexes.
Les produits chimiques utilisés pour la rendre bien visible n’ont pas réagi comme prévu. Depuis, le Vatican a amélioré le procédé pour éviter toute confusion entre fumée d’échec et fumée d’élection.
Le plus court pontificat élu par conclave
En 1503, le cardinal Piccolomini est élu sous le nom de Pie III. Il est très malade au moment de son élection, mais les cardinaux espèrent un compromis rapide. Il meurt 26 jours plus tard, sans avoir eu le temps de gouverner véritablement l’Église.
Un pape élu mais… qui refuse
En 1513, le cardinal Giovanni de’ Medici est élu et devient Léon X. Mais ce n’est pas lui qui refusa. Il y a un cas plus étonnant : en 1032, un cardinal, Jean Gratien (futur Grégoire VI), aurait été proposé comme pape mais aurait refusé l’élection à plusieurs reprises avant d’accepter, considérant qu’il n’était pas digne de cette charge.
Un autre cas plus documenté concerne le cardinal Giovanni Colombo, pressenti comme successeur de Paul VI. Il aurait obtenu la majorité des voix, mais aurait demandé aux autres électeurs de retirer leur soutien.
FAQ sur l’élection du pape et le conclave
1. Pourquoi les cardinaux doivent-ils être enfermés durant le conclave ?
Les cardinaux sont enfermés pour garantir la confidentialité absolue des débats et des votes.
L’objectif est d’éviter toute pression extérieure, toute influence politique ou médiatique, et de favoriser un choix libre et guidé uniquement par leur conscience.
2. D’où vient le mot « conclave » ?
Le terme « conclave » vient du latin cum clave, qui signifie « avec clé ».
Il désignait à l’origine le fait de « cadenasser » la salle où étaient enfermés les cardinaux jusqu’à ce qu’ils élisent un pape.
3. Quel est le rôle précis du doyen du Collège des cardinaux ?
Le doyen préside les discussions pendant le conclave et guide les cardinaux sur les règles à suivre,
mais il n’a pas de pouvoir de décision supérieur aux autres électeurs.
Il est simplement « premier entre égaux ».
4. Pourquoi les cardinaux portent-ils du rouge ?
Le rouge symbolise le sang et rappelle que les cardinaux doivent être prêts à verser leur sang pour défendre la foi et l’Église.
C’est une couleur de sacrifice, pas de pouvoir.
5. Combien de cardinaux participent réellement au conclave ?
Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent voter.
Leur nombre varie, mais il est normalement limité à 120 électeurs.
Ce chiffre peut cependant légèrement fluctuer en fonction des situations particulières.
6. Que deviennent les cardinaux qui ont plus de 80 ans ?
Ils restent membres du Collège des cardinaux, conservent leur titre, mais n’ont plus le droit de participer au vote pour l’élection d’un nouveau pape.
7. Est-il possible qu’un non-cardinal soit élu pape ?
Oui, théoriquement, n’importe quel baptisé catholique homme peut être élu pape.
Mais depuis plusieurs siècles, dans la pratique, seuls des cardinaux sont élus.
8. Où exactement les cardinaux résident-ils pendant le conclave ?
Depuis 2005, les cardinaux résident dans la maison Sainte-Marthe, une résidence située à l’intérieur du Vatican.
Ils se déplacent entre cette résidence et la Chapelle Sixtine pour les votes.
9. Comment communiquent-ils avec l’extérieur pendant le conclave ?
Ils n’ont aucun contact avec l’extérieur.
Tous les moyens de communication sont coupés : pas de téléphone portable, pas d’internet, pas de courrier.
Même les employés du Vatican présents sont tenus au secret.
10. Pourquoi utilise-t-on de la fumée pour annoncer le résultat des votes ?
La fumée qui s’échappe de la Chapelle Sixtine est un signal destiné aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre.
Noire si aucun pape n’a été élu, blanche lorsqu’un nouveau pape est choisi.
11. Que contient le serment prêté par les cardinaux avant le conclave ?
Ils jurent de garder le secret absolu sur tout ce qui se passe pendant le conclave,
et de respecter les règles fixées pour l’élection du pape.
12. Combien de votes peuvent avoir lieu par jour ?
Quatre votes sont possibles chaque jour : deux le matin et deux l’après-midi.
Si aucun pape n’est élu, on continue jusqu’à obtention de la majorité requise.
13. Quelle majorité est nécessaire pour élire un pape ?
Il faut atteindre les deux tiers des votes des cardinaux électeurs pour qu’un pape soit élu.
Ce n’est pas une simple majorité absolue.
14. Pourquoi certains conclaves ont-ils duré des années autrefois ?
Dans l’histoire, les luttes politiques et les divisions internes ont parfois tellement bloqué les votes qu’il a fallu plusieurs années pour aboutir.
Depuis, les règles ont été renforcées pour éviter ces blocages prolongés.
15. Est-ce que le conclave commence immédiatement après la mort ou la démission du pape ?
Non.
Il y a d’abord une période appelée sede vacante où l’on organise les funérailles (en cas de décès) et où le Collège des cardinaux se réunit pour préparer l’élection.
16. Qui fabrique les urnes pour les bulletins de vote du conclave ?
Les urnes sont fabriquées spécialement pour chaque conclave, souvent par des artisans italiens, sous la supervision du Vatican,
et elles sont soigneusement vérifiées avant le début du vote.
17. Que deviennent les bulletins de vote après l’élection ?
Tous les bulletins sont brûlés immédiatement après chaque session de vote pour garantir le secret absolu.
Même après l’élection, aucun bulletin ne peut être conservé.
18. Quel rôle jouent les maîtres de cérémonie dans le conclave ?
Ils assistent aux rites et à l’organisation matérielle,
mais ils quittent la Chapelle Sixtine avant que les votes ne commencent.
Ils n’assistent jamais aux délibérations.
19. Pourquoi la Chapelle Sixtine est-elle toujours choisie pour le vote ?
Parce qu’elle est un symbole fort de l’unité de l’Église et de son histoire.
Son décor grandiose, avec notamment la fresque du Jugement dernier, rappelle aux cardinaux la gravité de leur tâche.
20. Peut-il y avoir des surprises pendant le conclave ?
Oui.
Même si certains cardinaux sont pressentis à l’avance, il arrive que l’Esprit Saint guide l’élection vers un candidat inattendu.
C’est ce qui donne au conclave une part de mystère et d’humanité qui ne peut jamais être entièrement prévue.

Le Nouvel An Chinois est un acte de guerre contre l’hiver
Comprendre l’élection d’un pape et le conclave : ressources complémentaires
Pour approfondir votre compréhension du processus d’élection papale et du conclave, voici une sélection de ressources officielles et documentées :
Constitution apostolique Universi Dominici Gregis (1996)
Ce document établit les règles actuelles régissant l’élection du Souverain Pontife, y compris les procédures du conclave, les conditions de vote et les responsabilités des cardinaux électeurs.Code de droit canonique – Canons 349 à 359
Ces canons détaillent le rôle et les fonctions du Collège des cardinaux, notamment en ce qui concerne l’élection du pape et l’administration de l’Église pendant la période de sede vacante.Déroulement du conclave de 2013
Une analyse complète du conclave qui a conduit à l’élection du pape François, incluant les étapes clés, les participants et les circonstances particulières de cette élection.Élection pontificale de 1268-1271
Un regard historique sur l’élection la plus longue de l’histoire de la papauté, qui a duré près de trois ans et a conduit à des réformes majeures dans le processus électoral.Homélie de la messe pour l’élection du Souverain Pontife (2005)
Cette homélie, prononcée avant le conclave de 2005, offre une perspective spirituelle sur l’importance et la solennité de l’élection papale. Dernier article publié
Dernier article publiéDark Romance : quand la fiction sert d’alibi à l’insoutenable
Lire l’article →AnnoncesÀ propos de l’auteur Chroniqueur spécialisé en histoire des croyances et symbolisme, Philippe Loneux explore les frontières du visible. Il décrypte aussi bien les traditions religieuses que les phénomènes ésotériques et les grands mystères, en cherchant toujours le sens caché sous le prisme de l’analyse historique.